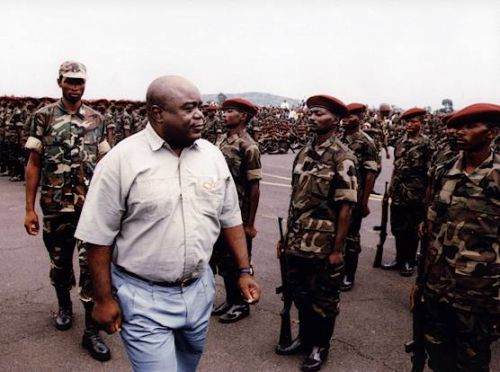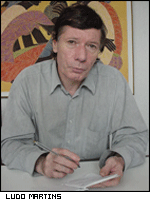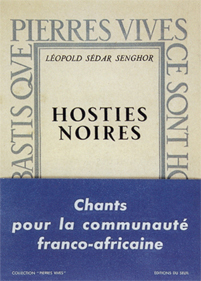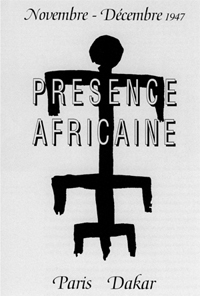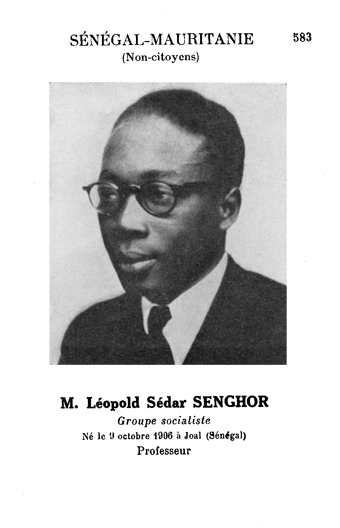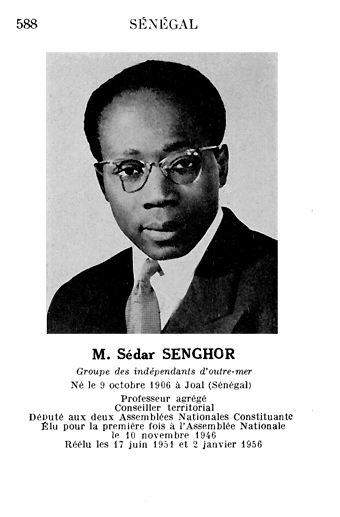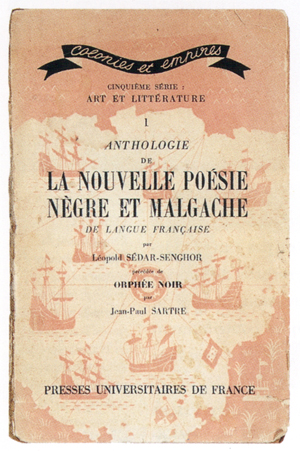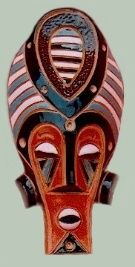Plus qu'un simple ouvrage littéraire, « Ma vie et mes luttes » à cette autre valeur d'être une sorte de compilation des curriculums vitae de son auteur. Le livre raconte, non sans intrigues, la vie d'Antoine Gizenga et ses combats menés dans le but d'instaurer la liberté et conquérir l'indépendance de la RD-Congo. Parce que l'environnement est aussi la source d'inspiration des écrivains, Antoine Gizenga a été motivé par la situation dans l'ex-Zaïre, après son retour d'exil en 1992.
Dans son ouvrage, Antoine Gizenga précise que tout est parti de la suggestion qui lui a été faite lors de son long séjour depuis 1966 dans l'ex-Union soviétique. L'ouvrage est subdivisé en deux grandes parties et comprend 8 chapitres.
La première partie part de 1925 à 1966 et comporte 7 chapitres. Ici Gizenga parle de sa naissance, enfance et études ; sa renonciation à la vocation sacerdotale, sa vie laïque et professionnelle ; ses débuts en politique et sa lutte pour l'indépendance du Congo ; la lutte pour l'unité et la défense du Congo, la lutte pour de la légitimité et de la légalité républicaines; le Gouvernement Adoula, lutte pour l'unité, son arrestation et son emprisonnement ; la création du Parti lumumbiste unifié (Palu) et la lutte pour la démocratie et la liberté.
La deuxième partie qui comprend uniquement le chapitre 8 et le dernier part de 1966 à 1992. Ce chapitre est axé sur sa vie en exil. Ici, il s'atèle à relater l'événement depuis son départ en exil et ses luttes pour la libération et la démocratie.
Antoine Gizenga constitue une icône de la politique congolaise. Personnage historique et figure de légende, cet homme, né le 5 octobre 1925, que beaucoup vénèrent comme un dieu, est auréolé du prestige d'avoir été l'ami personnel et l'adjoint de l'illustre Patrice-Emery Lumumba dans le premier gouvernement du Congo indépendant que ce dernier forma et dirigea.
Quand ce gouvernement, issu de la volonté populaire, fut brutalement limogé le 5 septembre 1960 à Léopoldville (Aujourd'hui Kinshasa), le Vice-Premier ministre Gizenga, avec la bénédiction de son chef le Premier ministre Lumumba, le restaura le 14 octobre suivant à Stanleyville (Kisangani) et le fit reconnaître par 21 nations du monde progressiste. A la mort violente, le 17 janvier 1961, de Lumumba, Gizenga devint son successeur idéologique et son légendaire testamentaire.
A Stanley, sa résistance contre l'illégalité, lui coûta la prison en janvier 1992. Libéré le 15 juillet 1964, il fonda le 22 août suivant, le Parti Lumumbiste unifié (Palu) qu'il dirige toujours. Placé en résidence surveillée, le 1er octobre 1964, il retrouva sa liberté le 25 novembre 1965.
Mais, à la suite d'un attentat contre sa personne perpétré par le nouveau régime, il fut contraint, dès le 19 février 1966, d'entamer un long et pénible exil, pendant lequel il mena un rude combat contre la dictature instaurée au Congo, un exil qui ne prit fin que le 7 février 1992. C'est toute cette histoire pathétique qu'Antoine Gizenga raconte dans le présent ouvrage. Il a voulu la narrer lui-même, afin, assure-t-il, "de bien indiquer qu'il s'agit de mes souvenirs, de mes actions et de mon regard sur certains événements que j'ai vécu personnellement.
« Il désire que » ce récit soit un témoignage, que j'espère utile pour la jeunesse congolaise et africaine et pour les historiens intéressées et travaillant avec ardeur pour contrecarrer la falsification de l'histoire de l'Afrique, en général, et celle du Congo, en particulier". Egalement, il souhaite vivement que ce livre inspire les jeunes Congolais dans leur engagement noble et déterminé en faveur de la mère-patrie, le Congo".
Laurel Kankole/Forum des As
Devoir de Memoire:Afrique
DEVOIR DE MEMOIRE:AFRIQUE!
CONSCIENCE:
Connaissance plus ou claire de notre existence et du Monde.
Avoir la connaissance de son histoire; c'est comprendre le monde d'alors; pour prendre
conscience sur le présent afin de remédier au futur...
Ici, nous archivons certains documents historiques pour notre memoire! Le Monde étant un tout, l'histoire nous aide à comprendre notre passé, présent et le sens à notre futur après avoir retenu instruction sur le passé. Devoir de Memoire, parle de l'histoire de l'Afrique dans cette Rubrique...
Eveil de la conscience incite à ce que l'on prenne connaissance de notre passé,présent et le Monde extérieur qui nous entoure.Ainsi,sondons notre passé historique et trouvons au travers ces histoires,ce que fût notre Monde d'Atan.
Ammafrica world ,la passion de l'histoire fait notre style de comprendre le Monde d'alors...Le monde d'autrefois!
DISCOURS TESTAMENTAIRE LAISSE AU PEUPLE CONGOLAIS PAR M'ZEE LD KABILA!
A LA MEMOIRE DE M'ZEE LAURENT DESIRE KABILA
Feu Mzee Laurent Désiré Kabila, Président de la RD, héros national livrera un discours qui nous sert de repères et surtout d'engagement sacré pour le contrôle de tous les territoires du pays!
Ammafrica vous livre ce discours que nous qualifions de "Testamentaire" par son contenu!
Testament laissé au peuple congolais (Bonana 2001)
Mes cher compatriotes,
Ce premier jour de l’an 2001, m’offre l’occasion de vous adresser mes très vives et sincères félicitations à vous tous mes compatriotes, pour la résistance active que vous avez menée, tout au long de l’anneé écoulée contre les agresseurs de la République Démocratique du Congo. Je relève donc votre glorieuse et opiniâtre résistance qui a permis à la nation de n’être occupée, ni totalement ni entièrement, par les agresseurs et esclavagistes rwandais, ougandais et burundais.
Que chacun d’entre vous trouve ici l’expression de ma profonde gratitude, pour les sacrifices immenses consentis et sans lesquels, les fossoyeurs de notre pays auraient pu déjà ouvrir une brèche au sein de notre peuple, pour nous entraîner irréversiblement dans l’ornière d’humiliation, d’assujettissement et d’exploitaion systématique et malheureux.
Fort heureusement, vous avez défait et triomphé des intentions de ceux qui, au loin, n’ont cessé de porter régulièrement secours à nos agresseurs.
La nation aurait pu faire mieux n’eût été, d’une part, en raison des visées de nos agresseurs, les agissements ignobles des nôtres qui ne pouvaient assouvir leurs appétits de pouvoir que par ce biais et, de l’autre, le comportement anti-patriotique de ceux des Congolais qui avaient choisi de diaboliser le gouvernement de leur propre pays, auprès de la communauté internationale, escomptant obtenir ainsi un appui total, pour leur parachutage dans les structures du pouvoir d’Etat.
Je suis convaincu qu’à la fin de l’an 2000, au début du 21ème siècle et au premier jour du troisième millénaire, nos efforts vont tendre à chasser du territoire national les envahiseurs qui, du reste, ne nous veulent nullement du bien. Ces agresseurs ont assassiné plus de 2.300.000 Congolais et ont élu littéralement domicile dans nos mines d’or et de diamant, dans nos plantations de café et de cacao, dans nos parcs, dans nos forêts et nos bois.
Ainsi, ces rapaces confirment, au fil des jours, ce que nous savions déjà et que nous n’avons jamais cessé de clamer haut et fort, toujours et partout. Ils mènent, à la fois une guerre de rapine, une guerre économique, une guerre de tentative de balkanisation de notre pays.
C’est pour chasser ce cauchemar de démembrement de notre nation, que je vous convie, filles et fils du grand Congo démocratique, à une résistance encore plus active et à une lutte, sans merci, contre nos ennemis, jusqu’au jour où nous recouvrerons totalement l’intégrité territoriale, l’indépendance nationale, et la souveraineté internationale de notre pays.
Pour atteindre ce noble et légitime objectif, la République Démocratique du Congo a besoin de sa cohésion interne, sans la moindre fissure. Ce dont les anti-régimes, devant le danger que court pourtant la mère patrie, ne veulent nullement comprendre.
Mes chers compatriotes,
Nous sommes, malgré tout, confiant de pouvoir surmonter nos difficultés économiques conjoncturelles, au cours de cette année 2001, avant d’entreprendre enfin une marche fulgurante, pour la reconstruction de notre pays. Aussi malgré les vicissitudes graves que vit notre pays, nous restons plus que jamais confiants, en l’avenir de notre patrie.
La République Démocratique du Congo est un pays choisi par Dieu et le plan divin se réalisera totalement sur cette terre africaine du Congo démocratique, quelle que soient les tentatives humaines intérieures et extérieures.
A toutes et à tous, je souhaite mes voeux de bonheur, de prospérité et d’engagement patriotique, en vue de la libération totale de notre pays.
«BONANA»!
LE M'zee Laurent DÉSIRÉ KABILA
LES TROIS HOMMES QUI ONT COMBATTU LE SYSTEME NEOCOLONIALISME AU CONGO RDC:LUMUMBA Patrice Emery, MULELE, KABILA Laurent Désiré

La Rédaction
AMMAFRICA WORLD

La FEMME apportera toujours plus dans la societé car elle en est le SOCLE !
------------------------------------------------------------------
PATRICE LUMUMBA: HISTOIRE D'UNE VIE EXEMPLAIRE!
Patrice Lumumba, histoire d'une vie exemplare
Ci-dessous vous trouvez les chapitres de la brochure "Patrice Lumumba, histoire d'une vie exemplare". Vous pouvez parcourir ce texte en cliquant sur les liens.
L'Histoire de la vie de Patrice Emery Lumumba : Introduction
Patrice Lumumba
Lumumba, l'histoire d'une vie exemplaire
Lumumba, qui a arraché l'indépendance mais qui n'est resté que deux mois et demi à la tête du Congo, est devenu un grand révolutionnaire, le héros national du peuple congolais. Pourquoi lui? Parce qu'il a été le premier à comprendre que la seule force capable de réaliser l'indépendance totale était celle de la grande masse des exploités et des opprimés.Né le 2 juillet 1925 à l'intérieur du pays, à Katako-Kombé, il a aussi vécu à Kisangani et Kinshasa : il connaissait bien les masses de son peuple. L'histoire de la lutte héroïque menée par Lumumba est très peu connue par la jeunesse congolaise. Et pour cause: Mobutu, qui a régné sur le Congo à partir du 14 septembre 1960, a été le principal responsable de l'assassinat de celui qui a été le véritable Père de la Nation congolaise. Nous retraçons ici l'histoire de Lumumba depuis le 10 octobre 1958, date de la fondation du Mouvement National Congolais, jusqu'au 17 janvier 1961, date de son assassinat au Katanga. Nous publions aussi les textes essentiels produits par Patrice-Emery Lumumba.En suivant l'histoire de Lumumba et en lisant ses déclarations politiques, le lecteur méditera sans doute souvent sur la situation politique actuelle. Laurent-Désiré Kabila est non seulement le continuateur de l'oeuvre de Lumumba, il bravait déjà la mort en luttant pour la cause lumumbiste au cours de cette année cruciale 1960. Aujourd'hui, les ennemis de Lumumba sont toujours là et ils s'attaquent à Kabila avec des tactiques qui ne sont guère différentes de celles qu'ils utilisaient dans les mois qui ont suivi l'indépendances.
La colonie, une prison pour les Congolais
------------------------------------------------------------------------
Après la période de terreur et de destructions qui a caractérisé le mobutisme, certains présentent la colonisation belge comme une " période díor ". A tort. Le Congo a été conquis par Léopold II par le feu et le sang. Le pouvoir colonial fut un pouvoir absolu et tyrannique, basé sur la violence et les armes. Les travailleurs étaient exploités au maximum pour que les entreprises capitalistes coloniales fassent des bénéfices fabuleux.
La conquête: "Pas de prisonniers, que des morts"
De 1887 à 1893, Isidore Tobback était le principal représentant de l'Etat du Congo au Bas-Congo. Voici ce quíil dit dans une lettre: "Mars 1888. Pendant un mois, j'ai marché et combattu avec cinquante hommes, jour et nuit. Les villages conquis ont été pillés et entièrement anéantis. Il me suffit de raconter l'assaut et la prise d'un seul village pour les avoir racontés tous. Je vais donc vous raconter la prise du village de Kimbanza. Une salve collective de mon second groupe sème la peur et la mort dans les rangs des indigènes qui jettent leurs armes pour fuir plus vite et plus sûrement, car ils savent que je fais fusiller tous ceux qui ont les armes à la main. Trois prisonniers portaient des armes lorsquíils ont été arrêtés. Cinq minutes plus tard, ils ont été abattus de douze balles. Tous les vivres, les légumes, les poulets, les chèvres ont été emportés et nous avons quitté le village dans la lueur des huttes en feu. Ainsi le veut la guerre africaine." ... "26 avril 1891. J'ai dû affronter les indigènes dans les environs de l'embouchure du Lomani. ... J'ai tué quatre-vingts personnes et fait autant de blessés. Pas de quartier, donc pas de prisonniers."
(Extrait traduit de "E.D. Morel tegen Leopold II en de Kongostaat, A.M. Delathuye", EPO, 1985, p.11)
Une dictature personnelle
Léopold II, roi des Belges et roi de l'Etat indépendant du Congo, écrit le 3 juin 1906: "Le Congo a été et n'a pu être qu'une oeuvre personnelle. Or, il n'est pas de droit plus légitime que le droit de l'auteur sur sa propre oeuvre, fruit de son labeur. Mes droits sur le Congo sont sans partage, ils sont le produit de mes peines et de mes dépenses. Le mode d'exercice de la puissance publique au Congo ne peut relever que de l'auteur de l'Etat. C'est lui qui dispose légalement, souverainement, et qui doit forcément continuer à disposer seul, dans l'intérêt de la Belgique, de tout ce qu'il a créé au Congo." Mobutu n'a fait qu'imiter la dictature personnelle de Léopold II, roi des Belges.
Exploités à outrance
La force de travail des Noirs a été mise à la disposition des grandes sociétés par la violence et la contrainte exercées par líEtat colonial. La Compagnie du Katanga a reçu la pleine propriété díun territoire díune superficie six fois supérieure à celle de la Belgique. Le roi Léopold II et une poignée de grands capitalistes fondent en 1900 le Comité Spécial du Katanga (CSK) qui obtient le droit díadministrer la plus grande partie du Katanga, díy percevoir líimpôt et díy organiser un corps de police.
Ce CSK devient le principal actionnaire de líUnion Minière en 1906. Cette société est devenue une des plus importantes sociétés capitalistes de Belgique. En 1924, le vice-gouverneur Moulaert, évalue le coût annuel díun travailleur de líUnion Minière entre 8.000 et 9.000 francs, alors quíil en rapporte 50.000. Quand le capitaliste paie un franc à líouvrier qui est durement exploité, le capitaliste empoche 6 francs sans rien faire.
Dans la colonie, 25.000 salariés blancs gagnent autant que 1.200.000 salariés noirs.
En septembre 1925, un administrateur territorial du Kwilu écrit: ëLes administrateurs territoriaux savent à quel point les exactions se font chaque jour plus nombreuses et ne laissent aux populations ni répit, ni liberté. Peut-être peut-on pardonner au fonctionnaire de se sentir envahi díamertume parce que les villages se vident à son approche comme à líarrivée díun marchand díesclaves.í Lors de la répression de la révolte populaire entre le Kwilu et le Lutshima en 1931, 4.000 villageois ont été massacrés. Chargé díenquêter sur les causes de la révolte, le fonctionnaire Jungers écrit: ëOn peut dire que la quasi-totalité des coupeurs de fruits sont partis pour Leverville contraints et forcés, soit par leurs chefs médaillés soit directement par les fonctionnaires et agents du service territorial. Comment en serait-il autrement? Il níest pas un colon qui admettra les que indigènes, alors que fort peu de choses leur manquent dans leur village, aillent travailler à cinq ou six jours de marche du village, en abandonnant pour six mois leurs femmes et leurs enfants, pour aller vivre dans des conditions qui sont abominables.í LíUnion Minière a été fondée en 1906 avec 10 millions de francs belges. Entre 1950 et 1959, elle réalise un bénéfice net de 31 milliard de francs. En 1959 elle domine le Katanga dont elle organisera la sécession en 1960.
La doctrine catholique: l'arme idéologique du colonialisme
Un des pionniers de la conquête militaire du Congo, le commandant Michaux, déclare en 1910: "Les missionnaires sont les éducateurs naturels des sauvages. Les missionnaires seuls feront que notre colonie deviendra un jour le prolongement de la Mère Patrie." (1)
Le président de la CSC, le syndicat chrétien belge, Henri Pauwels explique en 1949 la doctrine catholique de la colonisation aux ouvriers. Voici ce texte officiel."Nous parlons d'abord des fondements généraux du droit à la colonisation. La première donnée est la conquête. En général, les indigènes ont été privés de leurs droits par la volonté unilatérale de la puissance colonisatrice. Voyons les raisons qui ont été invoquées pour justifier de telles expropriations. Il y a notamment les actes de violence commis par les indigènes contre ceux qui voulaient s' établir dans leur pays; leurs crimes contre la nature; leur opposition à la prédiction de l'Evangile. Toutes ces raisons sont essentiellement bonnes pour justifier l'intervention armée des pays qui se sentent lésés dans leurs droits ou qui se présentent comme les défenseurs du droit naturel et divin. L'humanité ne peut pas tolérer que, par ignorance, par paresse ou par négligence, les richesses naturelles que Dieu a offertes au monde pour satisfaire les besoins humains, restent en friche. Lorsque des territoires sont mal gérés par leurs propriétaires légitimes, les autres pays, qui sont lésés de ce fait, ont le droit de prendre la place des mauvais gestionnaires et d'exploiter ces biens. Il est légitime que les peuples à coloniser soient obligés, sous la contrainte si nécessaire, à collaborer à l'|uvre civilisatrice dont ils seront bénéficiaires. L'|uvre éducatrice qui incombe à la nation colonisatrice est très lourde et coûteuse. Aucune nation ne voudrait en assumer la charge si elle n'y trouvait pas son profit. Le fait de demander une rémunération équitable pour les prestations accomplies dans le cadre de l'|uvre colonisatrice est logique. Qu'en est-il des peuples colonisés qui, grâce à la tutelle dont ils ont pu bénéficier, ont acquis la capacité de se gouverner eux-mêmes? Peuvent-ils revendiquer leur indépendance? Un véritable contrat a été conclu entre la mère patrie et la colonie. Il serait injuste que l'une des parties soit privée des fruits légitimes d'une |uvre civilisatrice de longue haleine. La prise de conscience nationale d'un peuple soumis va, en effet, de pair avec des aspirations séparatistes. La mère patrie doit donc veiller à désamorcer ces aspirations en faisant en temps voulu les concessions nécessaires." (2) Voilà en quels termes l'Eglise catholique, qui avait justifié pendant trois siècles la traite des Nègres, a justifié la domination coloniale.
1)Pourquoi et comment nous devons coloniser, Michaux, Bruxelles, 1910, pp. 196-197; 2) "Le syndicalisme et la colonie" par Henri Pauwels, cité dans L'argent du PSC-CVP, Ludo Martens, EPO, pp. 91-94.
A cette époque, les dirigeants congolais modernes, les « évolués », sont presque tous conciliants envers les colons. Lumumba lui-même écrit encore en 1956 :
« Le désir essentiel de l'élite congolaise est d'être des 'Belges' et d'avoir droit à la même aisance et aux mêmes droits ».(1) En 1956 toujours, Ileo et Ngalula publient le « Manifeste de la Conscience Africaine ». Ces deux hommes sont très liés à l'Eglise catholique qui fut la première institution coloniale à préparer le passage au néocolonialisme. La Belgique commence à comprendre que pour maintenir sa domination économique et politique sur le Congo, il faut désormais s'appuyer sur des Congolais dévoués aux intérêts belges. Le Manifeste dit : « Notre volonté est que l'émancipation du Congo se réalise dans l'ordre et la tranquillité. Les Européens doivent bien comprendre que notre désir légitime d'émancipation n'est pas dirigé contre eux. Nous prévoyons de créer une organisation qui se fera en pleine légalité et en se conformant aux lois ».(2)
Le 10 octobre 1958, Iléo, Ngalula, Adoula et Lumumba fondent le Mouvement National Congolais. C'est un parti qui se veut loyal vis-à-vis de la Belgique et regroupe des Congolais proches des courants catholique, libéral et social-démocrate belges.
La naissance d'un révolutionnaire
Du 5 au 13 décembre 1958, a lieu à Accra, capitale du Ghana, une Conférence Panafricaine historique. Le Ghana, sous la direction de Kwame Nkrumah, a été le premier pays d'Afrique noire à briser les chaînes du colonialisme. C'était le 6 mars 1957. A Accra, Lumumba rencontre les dirigeants africains les plus expérimentés et les plus radicaux dont Nkrumah qui deviendra son père spirituel. Lumumba déclare à Accra : « Malgré les frontières qui nous séparent, nous avons la même conscience, les mêmes soucis de faire de ce continent africain un continent libre, heureux, dégagé de toute domination colonialiste. Nous sommes heureux de constater que cette conférence s'est fixé comme objectif: la lutte contre tous les facteurs internes et externes qui constituent un obstacle à l'émancipation de nos pays et à l'unification de l'Afrique. Parmi ces facteurs, on trouve le colonialisme, l'impérialisme, le tribalisme et le séparatisme religieux qui, tous, constituent une entrave sérieuse à l'éclosion d'une société africaine harmonieuse et fraternelle. »(3) A Accra, Lumumba a cessé d'être un « évolué » pour devenir un nationaliste africain radical.
Le 28 décembre 58, Lumumba tient son premier meeting politique sur la place de la Victoire à Matonge, Kinshasa, devant plus de 10.000 personnes. C'est la première fois que Lumumba sent l'énergie bouillante de la masse et qu'il comprend que seule la masse constitue une force capable de réaliser les idéaux d'une indépendance totale. Mais ses compagnons, Iléo, Adoula, Kalonji et Ngalula, ne l'entendent pas de cette oreille. Ils estiment que Lumumba est devenu un «démagogue dangereux»S Peu après ce meeting, Lumumba leur dit : « Vous êtes tous endormis. Vous pensez que l'indépendance vous sera offerte sur un plateau d'argent, mais il faudra lutter pour l'obtenir et je suis décidé à me battre pour arracher notre indépendance.» (4)
Les massacres du 4-5 janvier 1959
Le 4 janvier, l'ABAKO de Kasavubu annonce un meeting place de la Victoire. Il faut absolument dépasser le succès que Lumumba a obtenu, une semaine auparavant. L'ABAKO considère Lumumba comme un « étranger » dans la province du Congo Central !
L'ABAKO était le parti tribaliste des Bakongo et avait l'avantage d'opérer dans la partie la plus développée et la plus connue du Congo: la capitale et ses environs. Les masses du Bas-Congo et de Kinshasa étaient très révoltées contre la domination coloniale. Mais l'ABAKO détournait cette révolte vers des objectifs tribaux.
Or le meeting est interdit par l'administration et l'affaire tourne à l'insurrection. La Force Publique massacre 300 Congolais, surtout des travailleurs, des chômeurs et des « irréguliers », venus à Kinshasa sans autorisation. Des dizaines de milliers de Congolais ont pris part aux « émeutes », c'est-à-dire au combat ouvert pour l'indépendance. Le colonisateur expulse alors des milliers d'irréguliers vers leur village d'origine. Là-bas, ces jeunes révoltés racontent comment la masse a osé attaquer les colonialistes. Dans tous les villages du Bas-Congo, du Kwilu et du Kwango, les masses commencent à se soulever, à l'exemple des héroïques combattants du 4 janvier.
Suite aux « émeutes » du 4 janvier, Kasavubu est arrêté et emprisonné. Mais le gouvernement belge, effrayé devant la lutte révolutionnaire, décide très vite de changer de tactique. Connaissant la faiblesse des partis nationalistes, l'administration coloniale les prend de court en accordant l'indépendance dans un bref délai. Ainsi, la Belgique veut s'assurer que le Congo « indépendant » soit gouverné par ses amis et ses fidèles. Le 13 janvier 1959, le roi Baudouin déclare : «Notre résolution est aujourd'hui de conduire les populations congolaises à l'indépendance.»
Le 13 mars, le ministre Van Hemelryck fait libérer Kasavubu et l'envoie en Belgique. Van Hemelrijck affirme que Kasavubu s'est rallié à la nouvelle politique définie le 13 janvier. Kasavubu déclare : «Nous demandons au peuple congolais de rester calme, d'oublier le passé et de préparer l'avenir dans l'esprit de la nouvelle politique qui conduit le Congo à l'indépendance.» (5)
L'administration coloniale était déjà arrivée à la conclusion que l'ABAKO, parti tribaliste et séparatiste, pouvait être « apprivoisé ». Le 21 avril, face au radicalisme des masses qui balaie toutes les institutions coloniales, l'administrateur Saintraint indique une nouvelle piste : «La situation générale est critique et, sous certains aspects, dramatique. L'Administration, rejetée, n'a plus les moyens de diriger le pays ni d'y maintenir l'ordre. L'ABAKO a un plan détaillé de mise en place d'une nouvelle administration. Il vaut mieux qu'elle procède très rapidement à ce remplacement.» (6)
Poussé par son esprit tribaliste, l'ABAKO tourne le dos à la lutte anticolonialiste pour s'orienter vers la lutte pour l'« indépendance » de sa province. Le 21 juin 1959, Kasavubu exige « la création d'un Etat autonome, la République du Congo Central, dont le président sera élu par les originaires de cette République ». (7) Ainsi, les nombreux Congolais nés dans les autres provinces seront des « étrangers » dans la capitale de leur pays.
« Une période pré-révolutionnaire »
Le 1er juillet 1959, Lumumba tient un meeting devant 1.500 personnes. Il entame son discours en demandant « cinq minutes de silence à la mémoire des Congolais victimes du colonialisme tombés le 4 janvier ».
« C'est de la provocation ! » clame un haut fonctionnaire belge. « Cet homme est un démagogue dangereux », disent, le 17 juillet 1959, Iléo, Ngalula, Adoula, et Kalonji, les chefs « respectables » du MNC. (8) Ils excluent Lumumba du MNCS sur quoi Lumumba exclut tous ces « évolués » favorables au maintien de la domination extérieure. C'est la première scission dans les rangs des « évolués » nationalistes : les lumumbistes veulent une indépendance totale s'appuyant sur les masses, les opportunistes veulent « réformer » le système économique et politique colonial.
Après la scission, Victor Nendaka est nommé vice-président du MNC-Lumumba, Jean-Pierre Finant devient la troisième personnalité du parti et un certain Joseph Mobutu se lie d'amitié avec Lumumba.
En fait, les « émeutes » du 4 janvier ont éveillé les masses sur l'ensemble du territoire congolais. Pendant toute l'année 1959, des campagnes de désobéissance aux autorités coloniales se développent. Il y a de fréquentes confrontations entre les forces de l'ordre et la population qui refuse de payer les impôts. Le sang coule à Matadi, Mbanza Ngungu, Luozi, Lukula, Jadotville. En août 59, le vice-gouverneur général Schöller parle de « la masse fanatisée » qui est en « état de rébellion ouverte ». (9) « Dans le Bas- et Moyen-Congo, on se trouve en période pré-révolutionnaire. Nous risquons d'être entraînés dans une guerre de type Algérie.» (10)
Les masses, qui exigent l'indépendance totale et un changement radical de leur situation, poussent une partie des « évolués » à gauche. Ils se regroupent essentiellement dans le MNC Lumumba et dans le Parti Solidaire Africain de Mulele et Gizenga. Ils comprennent que l'essence du colonialisme est la domination économique et qu'à la base des malheurs du Congo se trouve la soif du profit des grands capitalistes.
Le « Parti des Nègres Payés »
Dans l'autre camp, l'administration coloniale met désormais tout en oeuvre pour créer et soutenir des partis prêts à accepter une indépendance de pure forme. Il y a le Parti National du Progrès, le PNP de Bolya, Dericoyard et Delvaux; le Mouvement National Congolais-K, le MNC-K de Kalonji et Iléo; la Confédération des Associations tribales du Katanga, la CONACAT de Tshombé et Munongo; le Parti de l'Unité Nationale, le PUNA de Bolikango ; l'Association des Bakongo, l'ABAKO de Kasavubu et Kisolokela et l'Union des Mongo, l'UNIMO, de Bomboko.
En fait, la majeure partie des « évolués » commencent à craindre le radicalisme des masses: ils veulent « vivre comme les Blancs » et comptent y arriver en laissant intactes les structures économiques du régime colonial.
Le ministre Ganshof Van der Meersch déclarera plus tard : « L'administration fondait sur le PNP de grands espoirs. Mais le MNC-L disposait, en la personne de Lumumba, d'un atout supérieur à celui du PNP. Lumumba était seul à faire preuve de dynamisme ». (11)
Colonialisme et « élections libres »
Fin 1959, la Belgique veut toujours déterminer unilatéralement les conditions de l'indépendance pour que rien de fondamental ne change. Elle rejette la revendication des partis nationalistes d'une Conférence où les modalités de l'indépendance immédiate seraient fixées de commun accord entre les parties belge et congolaise. Et la Belgique pense que des «élections libres» peuvent donner une légitimation à ses complots néocoloniaux.
Le 7 octobre 1959, l'administration coloniale annonce la tenue d'élections communales en décembre. Elle croit qu'à ce niveau, les forces pro-colonialistes, et notamment les chefs coutumiers, gagneront les élections.
Au congrès du MNC-L, tenu du 23 au 29 octobre 1959, Lumumba demande l'indépendance immédiate et décide de boycotter les élections. Lorsque l'administration veut arrêter Lumumba, des affrontements entre les masses nationalistes et la gendarmerie font 20 morts. Le gouverneur de Kisangani, M. Leroy déclare : «Lumumba a provoqué des émeutes pour empêcher les élections. Il a reçu d'un étranger des leçons de technique révolutionnaire.» (12) Lumumba est emprisonné le 31 octobre.
Lumumba, vainqueur inattendu des élections
Dans un climat social qui se dégrade très vite, une Table ronde est organisée à Bruxelles du 20 janvier au 20 février 1960. Sous la pression des délégués congolais, la Belgique doit libérer Lumumba qui arrive à la Table ronde pour y faire un triomphe. La date de l'indépendance est fixée au 30 juin.
Les élections nationales ont lieu le 22 mai 1960. La Belgique est convaincue que la victoire des partis pro-impérialistes est assurée grâce au soutien de l'Etat colonial, à l'aide financière des grandes entreprises belges, et grâce à l'appui de la puissante Eglise catholique.
Et pourtant, le PNP, le « Parti des Nègres Payés », comme on dit à l'époque, perd les élections, malgré les moyens formidables mis à sa disposition, malgré la campagne virulente de l'Eglise catholique contre les nationalistes.
Les nationalistes s'imposent haut la main. Le MNC-L obtient 35 sièges à la Chambre et le PSA, avec 13 sièges, devient le principal parti de la Province de Léopoldville (Congo Central, Kwilu, Kwango et Lac Mai Ndombe). Personne ne s'attendait à ce que l'ABAKO, parti renommé à Kinshasa, puisse être battu dans « sa » province par le PSA, le parti nationaliste le plus radical. Le CEREA de Kashamura, avec 10 sièges, et le Balubakat de Sendwe, avec 7, rejoignent la coalition MNC-L et PSA.
Le dernier complot du colonisateur
Après les élections, la puissance colonisatrice continue à comploter contre les nationalistes.
Elle engage l'ABAKO pour mettre sur pied une coalition anti-nationaliste. Le 17 juin, elle charge Kasavubu de former le premier gouvernement congolais. S'appuyant principalement sur le PNP, le MNC-Kalonji et l'ABAKO, le projet de gouvernement de Kasavubu ne comprend aucun membre du MNC-Lumumba ni du PSA-Gizenga !
Mais, n'ayant pas trouvé de majorité pour soutenir ce complot, la Belgique se résigne à ce que Lumumba forme le gouvernement. Et elle redouble d'efforts pour briser Lumumba et les partis nationalistes.
(1)Congo, terre d'avenir,p.29; (2) Chronique de politique étrangère, vol. XII, n°4-6, juillet-nov. 1960, p.443-445; (3) La Pensée politique de Lumumba, p.l 1-12; (4) Pierre De Vos, Vie et mort de Lumumba, p.78-79; (5) Congo,1959,p.71-72; (6) Congo 60,I,p.144; (7) Congo 1959,p. 81 85; (8) De Vos,p.138-140; (9) Congo 1959, p.100; (10) De Vos,p.146; (11) Congo mai-juin 1960, p.80; (12) De Vos, p.154;
Le 30 juin 1960 représente une journée exceptionnelle, non seulement pour l'histoire du Congo, mais pour l'histoire de l'Afrique entière. Jamais l'affrontement entre l'oppresseur et l'opprimé n'a été exprimé avec une telle force. Jamais un Africain n'a résumé en si peu de mots 80 années de terreur, d'exploitation et d'humiliation. Il faut lire les trois discours prononcés ce jour mémorable. Trois, en effet. Puisque entre le Maître et le Patriote s'est glissé le Laquais. Il faut relire ces discours, puisque des laquais, il y en a toujours. Et puisque les Patriotes qui veulent suivre la voie de Lumumba sont de plus en plus nombreux.
Le Maître
Le Roi Baudouin: "Pas en conquérant, mais en civilisateur"
" L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'oeuvre conçue par le génie du roi Léopold II. Pendant 80 ans, la Belgique a envoyé sur votre sol les meilleurs de ses fils, d'abord pour délivrer le bassin du Congo de l'odieux trafic esclavagiste; ensuite pour rapprocher les unes des autres les ethnies, jadis ennemies.
Lorsque Léopold II a entrepris la grande oeuvre qui trouve aujourd'hui son couronnement, il ne s'est pas présenté à vous en conquérant mais en civilisateur.
Ne compromettez pas l'avenir par des réformes hâtives, et ne remplacez pas les organismes que vous remet la Belgique, tant que vous n'êtes pas certains de pouvoir faire mieux.
N'ayez crainte de vous tourner vers nous. Nous sommes prêts à rester à vos côtés pour vous aider de nos conseils,
L'Afrique et l'Europe se complètent mutuellement. Je souhaite que le peuple congolais conserve et développe le patrimoine des valeurs spirituelles, morales et religieuses qui nous est commun."
Le Laquais
Kasavubu : " les racines que la civilisation chrétienne a poussées en nous"
"Sire, Excellences, Mes chers compatriotes,
L'aube de l'indépendance se lève sur un pays dont la structure économique est remarquable, bien équilibrée et solidement unifiée. Mais l'état d'inachèvement de la conscience nationale parmi les populations a suscité certaines alarmes que je voudrais dissiper aujourd'hui en rappelant tous les progrès qui ont été déjà acomplis en ce domaine et qui sont les plus sûrs garants des étapes qui restent à parcourir.
La Belgique a eu la sagesse de ne pas s'opposer au courant de l'histoire et, comprenant la grandeur de l'idéal de liberté qui anime tous les coeurs congolais, elle a su faire passer directement notre pays de la domination étrangère à l'indépendance.
Nous saurons dans tout le pays développer l'assimilation de ce que quatre-vingts ans de contact avec l'occident nous a rapporté de bien : la langue, la législation et enfin surtout la culture. Le contact de la civilisation chrétienne et les racines que cette civilisation a poussées en nous, permettront au sang ancien revivifié de donner à nos manifestations culturelles une originalité et un éclat tout particuliers.
Sire, la présence de votre Auguste Majesté constitue un éclatant et nouveau témoignage de Votre sollicitude pour toutes ces populations que vous avez aimées et protégées. Elles sont heureuses de pouvoir dire aujourd'hui à la fois leur reconnaissance pour les bienfaits que Vous et Vos illustres prédécesseurs leur avez prodigués et leur joie pour la compréhension dans laquelle Vous avez rencontré leurs aspirations."
Le Patriote
Lumumba : " Fiers de cette lutte qui fut de sang, de larmes et de feu. "
"Congolais et Congolaises, Combattants de la liberté aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais.
A vous tous, nos amis qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce trente juin 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos coeurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants.
Cette indépendance du Congo, nul Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier que c'est par la lutte qu'elle a été conquise, une lutte de tous les jours, une lutte ardente et idéaliste, une lutte dans laquelle, nous n'avons ménagé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang.
Cette lutte, qui fut de larmes, de feu et de sang, nous en sommes fiers jusqu'au plus profond de nous-mêmes, car ce fut une lutte noble et juste, une lutte indispensable, pour mettre fin à l'humiliant esclavage qui nous était imposé par la force.
Ce fut notre sort en 80 ans de régime colonialiste ; nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire, car nous avons connu le travail harassant exigé en échange de salaires qui ne nous permettaient ni de manger à notre faim, ni de nous vêtir ou nous loger décemment, ni d'élever nos enfants comme des êtres chers.
Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des "nègres".
Nous avons connu les souffrances atroces des relégués pour opinions politiques ou croyances religieuses; exilés dans leur propre patrie, leur sort était vraiment pire que la mort même.
Nous avons connu qu'il y avait dans les villes des maisons magnifiques pour les Blancs et des paillottes croulantes pour les Noirs,
Qui oubliera enfin les fusillades où périrent tant de nos frères, les cachots où furent brutalement jetés ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation.
Nous qui avons souffert dans notre corps et dans notre coeur de l'oppression colonialiste, nous vous le disons tout haut : tout cela est désormais fini.
La République du Congo a été proclamée et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants.
Ensemble, mes frères, mes soeurs, nous allons commencer une nouvelle lutte, une lutte sublime qui va mener notre pays à la paix, à la prospérité et à la grandeur.
Nous allons établir ensemble la justice sociale et assurer que chacun reçoive la juste rmunération de son travail.
Nous allons montrer au monde ce que peut faire l'homme noir lorsqu'il travaille dans la liberté, et nous allons faire du Congo le centre de rayonnement de l'Afrique toute entière.
Nous allons veiller à ce que les terres de notre patrie profitent véritablement à ses enfants.
Nous allons revoir toutes les lois d'autrefois et en faire de nouvelles qui seront justes et nobles.
Et pour tout cela, chers compatriotes, soyez sûrs que nous pourrons compter non seulement sur nos forces énormes et nos richesses immenses, mais sur l'assistance de nombreux pays étrangers dont nous accepterons la collaboration chaque fois qu'elle sera loyale et ne cherchera pas à nous imposer une politique quelle qu'elle soit.
Ainsi, le Congo nouveau que mon gouvernement va créer sera un pays riche, libre et prospère.
Je vous demande à tous d'oublier les querelles tribales qui nous épuisent et risquent de nous faire mépriser à l'étranger.
Je vous demande à tous de ne reculer devant aucun sacrifice pour assurer la réussite de notre grandiose entreprise.
L'indépendance du Congo marque un pas décisif vers la libération de tout le continent africain.
Notre gouvernement fort - national - populaire, sera le salut de ce pays.
J'invite tous les citoyens congolais, hommes, femmes et enfants de se mettre résolument au travail, en vue de créer une économie nationale prospère qui consacrera notre indépendance économique.
Hommage aux combattants de la liberté nationale !
Vive l'Indépendance et l'Unité africaine !
Vive le Congo indépendant et souverain !"
(d'après Congo mai-juin 1960, Ganshof Van der Meersch, pp. 235-244)
Défendre l'indépendance contre l'agression belge et américaine
En tant que dirigeant du premier gouvernement du Congo libre, Lumumba proclame fièrement l'indépendance du Congo, le 30 juin 1960! Mais voulant réaliser l'union nationale autour de son gouvernement nationaliste, Lumumba demande à ses députés d'offrir le poste de président à Kasavubu, son principal adversaire. Ensuite, Lumumba accepte des ministres qui lui sont hostiles, comme Bomboko et Delvaux.
L'avenir lui montrera qu'il est dangereux de faire des alliances trop larges quand on ne dispose pas d'une base assez solide.
Le cinquième jour de l'indépendance, le 5 juillet, la Belgique provoque des troubles au sein de la Force publique. Ce jour-là, à 8h00, le lieutenant-général Janssens, qui commande toujours l'armée, écrit sur un tableau au quartier général: « Avant indépendance = après indépendance ». Ensuite, il se permet d'envoyer une lettre à Lumumba, Premier ministre d'un pays souverain, pour lui donner « un dernier et solennel avertissement ». Et il dénonce « la déclaration faite le 30 juin 1960 (qui) a étonné le cadre et la troupe ». (1)
En fait, Janssens provoque les soldats de l'Armée nationale congolaise afin d'obtenir un prétexte pour une intervention militaire. La bourgeoisie belge la prépare depuis plusieurs mois.
Le 8 juillet, des troupes belges partent de Bruxelles pour occuper Kitona et Kamina.
Le 10 juillet, elles interviennent à Lubumbashi où elles désarment les soldats nationalistes. Bomboko et Delvaux, deux ministres du gouvernement Lumumba qui sont parmi les principaux agents du colonisateur, font appel aux forces belges pour maintenir l'ordre.
Tshombé et le front anti-nationaliste
Le 11 juillet, Tshombé, sur instruction de l'Union Minière, proclame l'indépendance du Katanga et fait appel aux troupes belges. Le même jour, Lumumba demande l'aide de l'ONU pour mettre fin à l'agression belge.
Le lendemain, l'hystérie anti-Lumumba atteint son comble en Belgique. La Libre Belgique, journal proche du gouvernement, écrit: « Plusieurs ministres lumumbistes se sont conduits comme des sauvages primaires et imbéciles ou comme des créatures communistes.» (2)
Le 13 juillet, le gouvernement congolais déclare qu'un « état de guerre existe entre le Congo et la Belgique » et décide la rupture des relations diplomatiques avec la Belgique. Le Conseil de sécurité adopte une résolution sur l'assistance militaire au Congo.
L'agression belge contre le Congo prend les proportions d'une occupation militaire.
Le ministre belge de la Défense, Gillon, déclare devant le parlement que l'armée belge est intervenue dans 23 villes du Congo. « L'ensemble des forces belges engagées au Congo s'est élevé à près de 10.000 hommes. » (3)
Le 17 juillet, Lumumba écrit à Ralph Bunche, représentant du secrétaire-général, pour exiger une intervention rapide de l'ONU. Son message : « Mettez dehors les troupes d'agression belges, sinon je serai obligé de faire appel à l'URSS pour mettre fin à l'agression ».
Le 24 juillet 1960, Tshombé s'oppose à l'envoi de troupes de l'ONU au Katanga et demande à la Belgique de maintenir ses forces armées. Il fait appel à Kasavubu et Iléo pour créer une confédération des Etats du Congo. Dans le but de briser le gouvernement central nationaliste, tous les agents du néocolonialisme se mettent d'accord pour réclamer le « fédéralisme ». C'est une simple tactique pour détruire les forces patriotiques. Une fois le pouvoir central révolutionnaire brisé, les « fédéralistes » deviendront partisans d'un pouvoir central pro-impérialiste fort. Bientôt Tshombé, Iléo, Kasavubu, Bolikango, Kalonji soutiendront tous le pouvoir central fasciste de Mobutu.
La mainmise américaine
La Belgique avait l'intention de maintenir un contrôle de type néo- colonial sur « son » Congo. En occupant militairement le Katanga, elle se créait une base pour la reconquête de tout le Congo. Mais la vieille Belgique juge mal les changements. Les Etats-Unis sont devenus la superpuissance du monde impérialiste. Ils veulent leur « juste part » des richesses congolaises.
Bien sûr, les Etats-Unis soutiennent la Belgique dans sa guerre contre Lumumba. Ainsi, le 30 juillet 1960, le Département d'Etat américain déclare : «La Belgique avait le droit d'envoyer des troupes au Congo pour protéger des vies humaines en danger.» D'ailleurs, dans les mois à venir, les Etats-Unis enverront trois équipes de tueurs à Kinshasa pour éliminer Lumumba. Dans une de ces tentatives, un agent devait s'introduire chez Lumumba, chercher une occasion pour se rendre dans sa salle de bain et mettre un produit contenant un virus mortel sur sa brosse à dents ! (4)
La Belgique veut reconquérir militairement le Congo à partir du Katanga alors que les Etats-Unis s'appuient principalement sur les réactionnaires de Kinshasa - les Mobutu, Kasavubu et Adoula - pour obtenir « leur part » du Congo. Les Etats-Unis utilisent les troupes de l'ONU -appelées par Lumumba pour chasser les agresseurs belges ! - pour imposer leur domination à partir de Kinshasa.
L'ONU : « de l'aversion pour Lumumba »
Le Congo est indépendant depuis un mois, et tous les partis pro-impérialistes s'unissent pour abattre le gouvernement de Lumumba.
Ainsi, le 7 août, le comité central de l'ABAKO vote une motion de défiance à l'égard du gouvernement Lumumba et demande la création d'une Confédération des Etats du Congo. Le lendemain, la Puna de Bolikango demande l'indépendance de la province de l'Equateur. Et un jour plus tard, Albert Kalonji proclame l'indépendance de l'Etat minier du Kasaï ! C'est une alliance de fait entre Kasavubu, Bolikango, Kalinji et Tshombé contre le gouvernement Lumumba.
L'ONU, c'est-à-dire les Etats-Unis, essaient de réconcilier toutes ces forces antinationalistes. Le 12 août, Hammarskjöld arrive à Lubumbashi pour négocier avec Tshombé.
Le 14 août, le général suédois von Horn, commandant des troupes de l'ONU, arrive à Kinshasa. Officier réactionnaire à la solde de la CIA, il écrira six ans plus tard dans ses Mémoires : «Il n'était pas à dissimuler que nous tous, à commencer par Dag Hammarskjöld, nous nourrissions une profonde méfiance et de l'aversion pour Lumumba.» «Personnellement, je nourrissais une grande considération pour Mobutu. Contrairement à Lumumba, il me semblait un patriote authentique qui ne perdait pas son temps à jouer avec des théories communistes.» (5)
L'Eglise catholique part en guerre
L'Eglise catholique est la principale force dans le combat contre Lumumba. Le 17 juillet déjà, Malula écrit dans une lettre épiscopale:
«Quand dans un pays la liberté de presse n'existe plus, on ne parle plus de démocratie mais de dictature. Or, la dictature mène à l'esclavagisme.» (6) Exactement comme ses maîtres belges, Malula défend la presse coloniale et la « démocratie » coloniale et il accuse le gouvernement anticolonialiste de pratiquer la dictature et l'esclavagisme ! Malula fait allusion au journal catholique Courrier d'Afrique, qui compte Iléo et Bolikango dans son conseil d'administration. Le 18 juillet, ce journal évoque « la possibilité de l'implantation du communisme au Congo, par suite de la politique de Lumumba.» (7) Le syndicat catholique, la CSC, joue également un grand rôle dans le combat contre le gouvernement nationaliste. Il écrit que, par la faute de Lumumba, «le Congo s'engage dans la voie de la misère» et il rend le gouvernement nationaliste responsable de «la fermeture des entreprises, l'accroissement du chômage et l'augmentation des prix.» (8)
Grâce à sa mainmise sur l'enseignement, l'Eglise catholique peut contrôler l'esprit des Congolais. On comprend donc pourquoi, le 16 août 1960, Lumumba fait la proposition de nationaliser l'université de Lovanium. Cinq jours plus tard, dans son avant-projet de programme gouvernemental, il écrit : « L'enseignement doit avoir une 'qualité scientifique' et doit inculquer 'un idéal national '. Le gouvernement veut l'instruction primaire pour tous et la gratuité de l'enseignement à tous les échelons.» C'est une déclaration de guerre au pouvoir idéologique de l'Eglise catholique.
Ensuite, Lumumba attaque la base du pouvoir colonial, le pouvoir économique: «L'expansion économique du pays nécessite une industrie importante de transformation . Le gouvernement prendra comme critère le plus grand avantage collectif et combinera les apports du secteur privé, les possibilités du secteur public et de l'effort économique interne. Sa sollicitude se tournera particulièrement vers les milieux ruraux.» (9)
1) Congo,60,I,373-374; 2) Heinz et Donnay,p.30; 3) Congo, 1960, II, p.515; 4) Les complots de la CIA, The Church commission, éd.Stock, 1976, p.140 ; 5) von Horn, Karl : Soldat de la Paix, éd. Presses de la Cité, Paris, 1966, p.194 et 228; 6) Courrier d'Afrique, 19 juillet 60,p.1; 7) Congo,1960,II,p.685; 8) Congo 1960,II,p.681; 9) 1960,II,580 et 696.
"L'Afrique est irrésistiblement engagée, pour sa libération, dans une lutte sans merci contre le colonialisme et l'impérialisme. Le Congo ne peut-être considéré comme une colonie ni d'exploitation ni de peuplement et son accession à l'indépendance est la condition de la paix. L'objectif du Mouvement National Congolais est d'unir et d'organiser les masses congolaises dans la lutte pour l'amélioration de leur sort, la liquidation du régime colonialiste et de l'exploitation de l'homme par l'homme."
Discours d'Accra, 5-14 décembre 1958
"Au Katanga, ce sont quelques colons qui disent: 'Ce pays devient indépendant et toutes ses richesses vont servir à cette grande nation, la nation des Nègres. Non, il faut que le Katanga devienne un Etat indépendant'. Ainsi, demain, c'est le grand capitalisme qui va économiquement dominer les Africains. Nous allons redoubler d'efforts pour que cette indépendance soit réelle, pour que cette indépendance profite aux populations, pour améliorer les conditions de vie des populations."
(La pensée politique de Patrice Lumumba, Présence Africaine, Paris. Textes recueillis par Jean Van Lierde, p.141)
"L'impérialisme, c'est la domination économique"
" L'indépendance politique étant conquise, nous voulons maintenant l'indépendance économique. Le patrimoine national nous appartient. L'indépendance politique étant conquise, nous voulons maintenant l'indépendance économique. Le patrimoine national nous appartient "
(La pensée politique de Lumumba, p.298)
" Je vous assure qu'avec notre foi, avec notre dynamisme, avec notre fierté nationale, le Congo sera dans cinq ans un pays fortement développé. Ce n'est pas en mendiant des capitaux que nous allons développer le pays. Mais en travaillant nous-mêmes, par nos propres mains, par nos efforts. Le seul slogan pour le moment: le progrès économique. Les cadeaux, on n'apprécie pas. L'indépendance cadeau, ce n'est pas une bonne indépendance. L'indépendance conquise est la vraie indépendance ".
(Congo 1960, 2,pp.202)
" La Banque centrale belge s'est accaparée non seulement de notre argent, mais également de nos réserves d'or. Le gouvernement vient d'annoncer que, si dans un délai de 15 jours, le gouvernement belge ne les restituait pas, nous confisquerions tous les biens appartenant aux Belges. Le peuple attend le bonheur, l'amélioration de ses conditions de vie. Pour nous, il n'y a pas d'indépendance tant que nous n'aurons pas une économie nationale prospère pour relever les conditions de vie de nos frères ".
(Annales Parlementaires, Sénat du Congo, septembre 1960, !p.14-15, 21)
" Les Occidentaux savent qu'avec ce gouvernement, ils ne peuvent pas avoir la moindre mainmise sur l'économie de notre pays. Nous devons contrôler notre économie à la Banque nationale, à l'Otraco, à la Régideso. Dans chaque grande société il faudrait un commissaire du gouvernement doté de pleins pouvoirs politiques pour diriger ."
(La pensée politique de Lumumba, p.360)
"Ils utilisent espions et marionnettes"
"A la plupart des Belges, nous avons fait notre confiance, croyant qu'ils étaient sincères de continuer avec nous. Or nous avons gardé des espions. Jour par jour nous découvrons ce complot contre la nation. La Belgique devient maintenant comme un sous-marin. Ils agissent dans les coulisses. Ils ont établi un réseau d'espionnage."
(La pensée politique de Lumumba, p.305)
"On n'a jamais vu dans l'histoire de la colonisation en Afrique une nation qui se trahit d'une manière aussi scandaleuse vis-à-vis d'un peuple qui a toujours vécu avec elle. Et c'est grâce au Congo que la Belgique est ce qu'elle est aujourd'hui. Pour elle, ce ne sont pas des vies humaines qui comptent, c'est l'Union Minière, c'est l'argent du Congo qui compent.
Les Occidentaux ont voulu que notre gouvernement soit à la solde des impérialistes. Des traités nous ont été proposés. J'ai décidé de ne point signer ces accords, parce qu'ils ne signifient rien d'autre que la domination économique du Congo par les groupes financiers de la Belgique.
Comme nous sommes un gouvernement nationaliste, qui ne vise que l'intérêt de la patrie, ceux qui convoitent nos richesses tentent de provoquer l'anarchie, pour finalement monter la population contre nous et faire tomber notre gouvernement. Ils se serviront alors de marionnettes qui n'hésiteront pas à signer aveuglément n'importe quel accord pour placer le Congo sous une domination étrangère. Voilà la vérité."
(La pensée politique de Lumumba, pp. 286)
Sur l'impérialisme américain et l'ONU
"Les Etats-Unis! Ce pays approuve que la Belgique maintienne ses bases au Congo, parce qu'il y possède des intérêts économiques. Puisque les Belges ne peuvent plus rester, ils font appel à leurs alliés à l'ONU pour les relayer. Je propose le retour immédiat des forces de l'ONU, s'il est exact qu'elles viennent opérer conformément aux arrangements pris avec la Belgique. "
"Certains ont voulu utiliser l'ONU, soi-disant pour placer le Congo sous le statut international. Le Congo ne deviendra jamais une colonie de l'ONU et ne sera jamais un pays sous la tutelle de l'ONU. Et nous renonçons à toute assistance de l'ONU. Ceux qui croyaient s'introduire encore au Congo sous le couvert de l'ONU ne vont plus entrer. Les portes du Congo sont hermétiquement fermées aux exploitants et aux chercheurs de l'or."
"Nous voulons que l'ONU retire du Congo toutes les troupes blanches. Les troupes africaines qui ont été mises à la disposition de l'ONU sont suffisantes. J'ai dénoncé les manoeuvres qui consistaient à n'envoyer au Katanga que des troupes de Suède."
(La pensée politique de Lumumba, p.232, 287-288, 306-307)
Deux coups d'Etat pour éliminer un seul homme
Nous sommes maintenant fin août 1960 et Lumumba a de plus en plus l'adhésion des masses populaires. Le peuple comprend que le Katanga et le Kasaï sont occupés par l'armée belge dans le but de continuer le système colonial abhorré. Le peuple se rend compte que les troupes de l'ONU, aux mains des Américains, loin de soutenir le gouvernement nationaliste de Lumumba, complotent avec ses ennemis.
Toutes les forces anti-nationalistes sentent le besoin de renforcer leur alliance.
Le 20 août 1960, une délégation de la Jeunesse de l'ABAKO, de la Puna de Bolikango et du MNC-Kalonji est reçue à Lubumbashi par Tshombé.
A Brazzaville, des émissaires de l'ABAKO sont en contact permanent avec le président Foulbert Youlou et avec des agents secrets français. Le 21 août, le vice-président de l'ABAKO, Moanda, déclare : «Il faut débarrasser le Congo de Lumumba par des moyens légaux ou illégaux.» (1)
Mais le 27 août 1960, la montée des forces nationalistes révolutionnaires se concrétise. Les troupes lumumbistes prennent Bakwanga, la capitale du pseudo-Etat du Sud-Kasaï. Sur d'autres fronts aussi, l'armée nationaliste avance vers le Katanga.
Le gouvernement Lumumba reçoit un soutien de plus en plus net de la part des Etats nationalistes africains et des Etats socialistes. Le 3 septembre, L'Union soviétique met 15 avions Iliouchine et 100 camions à la disposition du gouvernement Lumumba pour le transport de ses troupes. La lutte pour la défense de l'indépendance du Congo contre les complots de l'impérialisme belge et américain arrive à son point culminant. Lumumba a maintenant la force pour éliminer les deux créations des colonialistes belges: l'Etat «Indépendant» du Katanga, où les impérialistes belges comptent garder la main sur le cuivre, le cobalt et l'uranium, et l'Etat «Indépendant» du Sud-Kasaï, où les voleurs belges veulent garder le contrôle sur les diamants Les impérialistes doivent maintenant jouer le tout pour le tout.
Le coup d'Etat de Kasavubu
Soutenu aussi bien par les Etats-Unis que par la Belgique et la France, Kasavubu déclare le 5 septembre: «Lumumba a trahi la tâche qui lui était confiée, il jette le pays dans une guerre civile atroce, j'ai jugé nécessaire de révoquer immédiatement le gouvernement.» (2)
Une heure et demi plus tard, Lumumba réagit sur les ondes de la radio nationale: «Kasavubu a publiquement trahi la nation. Il veut détruire le gouvernement nationaliste qui a lutté avec acharnement contre les agresseurs belges, contre les ennemis de notre indépendance nationale.» Le lendemain, le gouvernement de Lumumba prend une décision historique : «Les Ministres, réunis en conseil extraordinaire, déclarent déchu le Chef de l'Etat.» (3)
Le même jour, monsieur Iléo ordonne, sur instruction de Kasavubu, l'arrestation de Lumumba. Le même Iléo forme un gouvernement où se retrouvent les principaux agents du néocolonialisme: Bomboko, Adoula, Bolikango, Kalonji, Dericoyard, Kisolokela et Delvaux. (4) Iléo, l'homme de l'Eglise catholique, déclare à propos de la courte période du gouvernement Lumumba : «C'étaient deux mois d'angoisse, d'inquiétude et de misère.» (5)
Au même moment, la Mission technique belge à Lumumbashi envoie un rapport à Bruxelles : «La révocation de Lumumba a fortifié le leadership que Tshombé détient comme défenseur de la reconstruction politique de l'ancien Congo belge sur une base confédérale. La réussite de l'expérience katangaise provoquera vraisemblablement la reconstruction du Congo à partir de Lubumbashi.» (6) C'est un bon résumé de la politique néocoloniale belge: à partir de l'Etat sécessionniste katangais, reconquérir tout le Congo.
Mais très vite, cela tourne mal pour les politiciens pro-impérialistes. Le 6 et le 8 septembre, la chambre soutient Lumumba contre Kasavubu par 60 voix contre 19 et le sénat fait de même par 41 voix pour, 2 contre et 7 abstentions. Le 13 septembre, les Chambres réunies votent les pleins pouvoirs au gouvernement Lumumba. (7)
Le même jour, Lumumba renforce son contrôle sur l'armée en nommant Mpolo lieutenant-général.
Le 14 septembre, désespéré, Kasavubu réagit en désignant Mobutu comme commandant en chef de l'armée.(8) C'est ainsi que Kasavubu a ouvert le chemin vers la dictature mobutiste.
Le coup d'Etat de Mobutu
En effet, à peine quelques heures plus tard, à 20h30, Mobutu exécute son coup d'Etat. Il déclare la « neutralisation » des politiciens et affirme : « Il ne s'agit pas d'un coup d'Etat mais d'une simple révolution pacifique ». (9) C'est par ces paroles qu'ont commencé 37 années de dictature et de destruction. Mobutu ferme les ambassades des pays socialistes, l'Union soviétique et la Tchécoslovaquie. Ensuite, il réclame « le retrait des troupes ghanéennes et guinéennes à cause de leur soutien direct à Lumumba ». Ainsi, dès le début, Mobutu, agent de la CIA, lutte contre les pays socialistes et contre les pays africains nationalistes.
Mobutu instaure le Collège des Commissaires généraux. Bomboko en est le président, Ndele, le vice-président, Ferdinand Kazadi, le ministre de la Défense, Lihau et Tshisekedi, ministre et vice-ministre de la Justice. Ce Collège est installé officiellement par Kasavubu, agissant en tant que chef de l'Etat et complice du coup d'Etat de Mobutu.
Lumumba réagit le 15 septembre au matin en déclarant : « Le colonel Mobutu a été corrompu par les impérialistes pour jouer un coup d'Etat contre le gouvernement légal et populaire. Peuple, vous êtes les témoins oculaires de ces manuvres tendant à faire retomber le Congo, terre de nos ancêtres, sous la domination d'une organisation internationale ». (10)
C'est le tournant de l'histoire congolaise: le coup d'Etat de Mobutu, ce 14 septembre 1960, place le Congo, pour 37 ans, sous la dictature conjointe de l'impérialisme américain et belge.
La grande bourgeoisie noire prend le pouvoir
La plupart des intellectuels d'avant 1960, les « évolués », voient surtout l'indépendance comme un moyen pour s'enrichir, pour arriver à « vivre comme des Blancs ». Ils ne contestent pas le capitalisme au Congo, ni la domination impérialiste qui est la garantie de son maintien. Ils ne mettent pas non plus en cause l'appareil d'Etat colonial, cette machine d'oppression contre les masses congolaises. En fait, ils veulent simplement « reprendre » cet Etat oppresseur et s'en servir pour s'enrichir. Après l'indépendance, l'Etat néocolonial a été le lieu où s'est formée la grande bourgeoisie noire.
Avant l'indépendance, certains « évolués » sont déjà ouvertement pro-belges et pro-impérialistes, des hommes comme Bomboko, Edindali, Lopes, Delvaux et Tshombé. On les retrouve dans des partis de collaboration comme le PNP et la CONACAT.
Les « évolués » qui ont créé des partis nationalistes s'étaient déjà divisés avant l'indépendance. Ceux qui veulent seulement « réformer » le système existant se sont rapprochés des « pro-belges ». Il s'agit des Iléo, Kalonji, Ngalula et Adoula qui avaient fait éclater le MNC, et aussi de l'ABAKO de Kasavubu.
Mais une fois au gouvernement, les partis nationalistes radicaux éclatent à leur tour. Mobutu a été le secrétaire de Lumumba. Lorsqu'il fait son coup d'Etat, il reçoit le soutien du vice-président du MNC-L, Nendaka, qu'il nomme chef de la sécurité. Le ministre Songolo et 8 parlementaires du MNC-L soutiennent également Mobutu. (11)
Après le coup d'Etat de Mobutu, une alliance s'est formée entre ces trois groupes d' « évolués ». Ensemble, ils formeront la grande bourgeoisie congolaise, étroitement liée à l'impérialisme américain et belge.
Entre septembre 1960 et novembre 1965, différents personnages joueront le rôle de chef à différents moments - Kasavubu, Ileo, Bomboko, Adoula, Tshombé et Mobutu - mais tous représentent la même classe, la grande bourgeoise congolaise, et tous sont liés au même maître, l'impérialisme américain et belge.
1) Congo 1960,II,p.672; 2) Congo, 1960, II, p.818; 3) Congo, 1960, II, p.820 et p.823; 4) Heinz et Donnay : Les cinquante derniers jours de Lumumba, éd. CRISP, 1966, p.33 ; Congo, II, p.855 5) Congo, 1960, II, p.853; 6) Congo, 1960, II, p.963; 7) Congo, 1960, II, p.850 et 861; 8) Chronique, XII, n‰4-6, p.949; 9) Congo, 1960, II, p.869; 10) Congo, 1960, II, p.870; 11) Congo, 1960, II, p.997.
Au cours de la lutte pour l'indépendance, puis pendant ses deux mois et demi au gouvernement, Lumumba a été un homme seul, entouré d'une poignée de compagnons de lutte. Il n'avait pas une organisation solide derrière lui, il n'a pas eu le temps de donner une conscience politique au peuple opprimé. Comment alors expliquer son extraordinaire impact, sa stature de grand homme politique? Lumumba a réussi à donner une expression au radicalisme des masses urbaines et villageoises qui étaient à bout à cause de l'oppression, de l'exploitation et des humiliations coloniales. C'est ce point essentiel qu'ont toujours oublié ceux qui abusent du nom de Lumumba "pour occuper des postes" et pour "bouffer à leur tour."
Avec la masse, lutter contre le colonisateur
22 avril 1959. "La masse est beaucoup plus révolutionnaire que nous. Quand nous sommes avec la masse, c'est la masse même qui nous pousse, elle voudrait aller beaucoup plus rapidement que nous."
((La pensée politique de Lumumba, p.45)
13 août 1959. Une délégation parlementaire belge rencontre M. Mabé Sabiti, qui se présente comme 'le chef des arabisés'. Sabiti déclare : " Lumumba se met surtout du côté des ouvriers, parce qu'ils forment la masse".
(Procès-verbaux des entretiens officiels. Sénat. 1959, p.264)
Juin 1960. Bientôt l'indépendance. Qui sera ministre, qui aura un poste, qui aura du pouvoir ? Lumumba ne compte pas sur " ceux d'en haut ", sur les colonisateurs. Il ne cherche pas son intérêt personnel en se vendant aux puissants. Il ne se laisse pas corrompre par les puissances impérialistes. Il a juré de rester du côté du peuple.
"Je ne vise pas du tout mon intérêt personnel mais seulement l'intérêt supérieur du pays. Le gouvernement belge veut se retirer de la scène politique congolaise mais entend remettre la gestion du Congo dans les mains des leaders ayant toutes ses sympathies. Je n'ai pas la sympathie du gouvernement belge, pas plus que celle d'autres milieux officiels. Je suis considéré comme un homme dangereux parce que je refuse de me laisser corrompre. Je puis vous dire qui si j'avais accepté de "jouer le jeu", comme l'ont fait certains leaders congolais opportunistes, je serais aujourd'hui soutenu par la Belgique et considéré comme son plus grand ami. On veut créer un gouvernement de marionnettes mais on craint aussi la réaction populaire. Au train où nous allons, il n'y aura pas le moindre changement dans ce pays à la date de l'indépendance et les Congolais auront l'impression d'être dupés. On aura alors le choc en retour, et alors que les leaders seront satisfaits des quelques portefeuilles que la Belgique leur aura confiés, ce sera le peuple qui fera sa révolution."
(Pourquoi Pas, juin 1960 pp.)
"Les ministres doivent manger avec le peuple."
“Le Patrimoine national nous appartient (…) Nous-mêmes, les ministres, nous allons dans les milieux ruraux, nous allons labourer la terre pour montrer au pays commnt nous devons faire nos cooperative (…) Nous ne voudrons jamais tromper le peuple et le peuple sait très bien que depuis nous sommes au pouvoir aucun minister a été payé (…) Nous mangeons avec le peuple, nous n’avons pas besoin d’argent (conference de presse 9 août, cite dans “Congo 1960, 2, pp 593-594)
“Les ministres doivent vivre avec le peuple (…). Nous ne devons pas passer aux yeux de la population comme les remplaçants des colonialistes. (Annales de la Chambre des Représentants de la République du Congo. 1960, 12, Séance du 15 juillet 1960 p.15)
"Nous voulons une vraie indépendance."
“Nous allons mettre tous nos travailleurs au travail, après le depart des troupes belges (…) Chacun aura du travail, avec des salaries modestes. Et je vous assure, qu’avec notre foi, avec notre dynamisme, avec notre fierté nationale, le Congo sera dans cinq ans un pays fortement développé. Ce n’est pas en mendiant des capitaux que nous allons developer le pays. Mais en travaillant nous-mêmes, avec nos propres mains, par nos efforts (…) le seul slogan pour le moment: le progress économique, tout le monde au travail, mobiliser toute la jeunesse, toutes nos femmes, toutes les energies du pays. Les cadeaux, on n’aprrécie pas. L’indépendance cadeau, ce n’est pas une bonne indépendance. L’indépendaance conquise est la vraie indépendance.” (conference de presse 9 août, cite dans “Congo 1960, 2, pp 593-594)
“La Banque centrale belge s’est accaparée non seulement de notre argent, mais également de nos reserves d’or..; Le gouvernement vient d’nnoncer que, si dans un délai de 15 jours le Gouvernemnt belge ne les restituait pas, nous confisquerons tous les biens appartenant aux Belges. Le people attend le bonheur, l’amélioration de ses conditions de vie. Pour nous, il n’y a pas d’indépendance tant que nous n’aurons pas une économie nationale prospère pour relever les conditions de vie de nos frères.”
(Annales Parlementaires. Sénat de la République du Congo. 1960, 8 septembre pp 14-15)
Ainsi donc, le 19 septembre, Mobutu place Bomboko et ses Commissaires généraux à la tête du Congo. Ces Commissaires sont les ennemis mortels des nationalistes congolais qu'ils accusent d'être des « communistes ». Pourquoi une telle accusation ?
La raison en est simple : leurs maîtres, les impérialistes américains et belges, craignent avant tout les communistes, ces hommes et ces femmes qui mènent de façon conséquente le combat contre l'exploitation capitaliste. Et les impérialistes savent que les nationalistes congolais peuvent trouver dans les pays socialistes de puissants alliés. Voilà pourquoi, le 19 septembre, les Commissaires lisent une proclamation rédigée en concertation avec Mobutu lui-même: « Le colonel Joseph Mobutu est aujourd'hui l'homme qui nous a délivrés du colonialisme communiste et de l'impérialisme marxiste-léniniste. Grâce à l'armée nationale congolaise, nous ne passerons pas d'un esclavage à un autre. » (Congo 60,II,p.871)
L'anti-communisme, arme idéologique de la colonisation
Depuis le début de la colonisation, l'anticommunisme a été l'arme idéologique la plus puissante de toutes les forces anti-congolaises. Le colonisateur et l'Eglise catholique n'ont jamais permis que des écrits marxistes pénètrent dans la colonie. En recourant à des mensonges dégoûtants, les colonialistes décrivent le communisme comme l'uvre du diable. Et en 1960, ils publient des caricatures de Lumumba représenté comme diable.
En fait, l'anticommunisme constitue un écran de fumée. L'objectif véritable est celui-ci : les grands capitalistes veulent sauvegarder leurs intérêts économiques, ils veulent continuer à exploiter au maximum les richesses du Congo et la force de travail de ses ouvriers et paysans.
Les alliés naturels
En ce début des années soixante, comment les Etats africains qui veulent une indépendance réelle, comme le Ghana de Nkrumah et la Guinée de Sékou Touré, peuvent-ils réussir? Ils ont besoin d'alliés et d'amis pour développer rapidement leur propre économie, pour soustraire leur économie à la mainmise des puissances impérialistes. Les pays communistes sont leurs alliés naturels. Pour deux raisons.
D'abord, les pays communistes ont, eux-mêmes, terriblement souffert des agressions impérialistes. En 1917-1920, la Russie soviétique a connu l'agression de 9 pays impérialistes et elle a perdu 10 millions de mort à cause de la guerre et de la famine. Ensuite, l'agression nazie de 1941-1944 a coûté 23 millions de morts au peuple soviétique. La Chine, quant à elle, a subi la domination des colonialistes occidentaux et, au cours des années 20, 30 et 40, son sort a été pire que celui de l'Afrique! Agressée par l'impérialisme japonais, puis par l'impérialisme américain, La Chine a compté plus de 10 millions de morts.
Ensuite, les pays communistes veulent construire une économie indépendante et, pour cela, ils doivent se soustraire à la domination politique et économique de l'impérialisme. Pour progresser dans cette voie, ils ont intérêt à soutenir tous les pays qui, eux aussi, veulent se soustraire à la domination de ces mêmes impérialistes.
«Combattre le colonialisme et terrorisme communiste»
Voyons maintenant les choses du côté des impérialistes. Pour maintenir leur domination sur le Congo, ils doivent casser l'alliance entre le Congo et les pays africains nationalistes comme le Ghana et le Guinée. Ils doivent aussi bloquer tout rapprochement entre le Congo et les pays communistes.
C'est exactement ce qu'a fait leur principal agent, Mobutu. Celui a déclaré après son coup d'Etat: «Comme la Tchécoslovaquie et l'Union soviétique, le Ghana et la Guinée distribuaient des armes dans la cité de Kinshasa ». (1) Ces accusations sont évidemment fausses mais Mobutu et ses maîtres de la CIA doivent faire croire au peuple congolais que le Ghana et la Tchécoslovaquie sont des «Etats terroristes». Et qu'ils appuient des terroristes congolais, c'est-à-dire Patrice Lumumba et ses compagnons En effet, Mobutu prétend que Maurice Mpolo et Emmanuel Nzuzi, deux collaborateurs fidèles de Lumumba, organisent «des camps de formation terroriste» et dirigent «un groupe terroriste, la Jeunesse lumumbiste, ». (2)
Mobutu, Kasavubu et Tshombé, ces agents de l'impérialisme qui exploite le Congo depuis 80 ans, font croire que ce sont le Ghana et la Chine qui veulent «conquérir et dominer» le Congo. C'est ridicule, complètement faux, mais cela sert à détourner l'attention des véritables exploiteurs et dominateurs qui saignent le peuple congolais à blanc !
Le crime du Ghana et de la Chine est de souhaiter la réussite de l'expérience congolaise. Le 23 juillet 1960, Théodore Bengila, l'ami de Pierre Mulele, assiste, à Beijing, à un rassemblement de 10.000 personnes qui «apportent le soutien du peuple chinois à la lutte du peuple congolais pour son indépendance » (3)
Ni l'Ouest, ni l'Est ?
A l'époque, tous les agents de l'impérialisme prétendent « dénoncer tout néocolonialisme d'où qu'il vienne, celui de l'Est aussi bien que celui de l'Ouest ». (4) On trouve cette même phrase dans la bouche de Malula, de Mobutu ou de Bomboko. Tous font croire à la population congolaise que l'indépendance formelle, accordée par la Belgique, signifie une indépendance réelle, totale. En réalité, cette fausse indépendance inaugure la continuation de la domination économique et politique de l'Occident par d'autres méthodes. Ceux qui sont de véritables agents de l'Ouest, crient que toute relation avec l'Est un crime. Ceux qui veulent la perpétuation de la domination impérialiste, font croire que les seuls alliées possibles d'un Congo indépendant, les pays communistes, veulent dominer et tyranniser le pays. L'anticommunisme barre la route à une politique d'alliances internationales capables de faciliter l'indépendance politique et économique. L'anticommunisme lie le Congo pieds et poings liés à ses pires exploiteurs, aux pires assassins, les impérialistes américains, français et belges. Le peuple en subira les conséquences catastrophiques pendant 37 ans.
1) Houart Pierre : La pénétration communiste au Congo, éd. CDI, Bruxelles, 1960,p.95; 2) ibidem, p.94-95; 3) Houart, p. 51; 4) Houart, L'Afrique aux trois visages, éd. CDI, Bruxelles, 1961,p.189.
Lumumba s'est débarrassé des idées de soumission
Comme tous les jeunes de sa génération, Lumumba a été éduqué dans le pacifisme et la soumission. Le génie de Lumumba s'est exprimé dans son amour des masses opprimées, dans sa soif de justice pour les pauvres et dans sa profonde honnêteté. Ces qualités lui ont permis de se débarrasser de toutes les fausses idées, inculquées par l'éducation coloniale. Lumumba a critiqué radicalement ses propres conceptions, pour devenir, pas à pas, dans le feu de la lutte, un véritable nationaliste et révolutionnaire. Il est un exemple pour la jeunesse congolaise d'aujourd'hui.
Oser penser, oser lutter
A propos de l'indépendance, Lumumba disait encore ceci en 1956 : "Certains Blancs, très peu recommandables, qui abusent de la crédulité des Noirs encore peu cultivés, instiguent ceux-ci à réclamer immédiatement l'indépendance. Ils vont jusqu'à insinuer que l'autonomie ne pourra être obtenue sans effusion de sang, que tous les pays occidentaux ont dû, pour obtenir leur indépendance, se battre, et que les Congolais devraient faire de même s'ils veulent se libérer des Belges. Triste mentalité! Nous devons rejeter ces idées d'où qu'elles viennent. Le Congo obtiendra son autonomie dans la dignité et non dans la barbarie. Ce serait commettre un acte de la plus grande barbarie, du banditisme que de sacrifier des vies humaines, nos membres de famille qui nous sont chers, pour la soif de l'indépendance." (Le Congo, terre d'avenir, est-il menacé?, Patrice Lumumba, pp.162-163)
Trois ans suffiront pour que la conception du monde de Lumumba soit profondément bouleversée. Il perce le caractère mensonger, hypocrite et intéressé de la propagande coloniale. En décembre 1958, Lumumba exprime à Accra sa solidarité avec la lutte armée en Algérie, au Cameroun, au Kenya, en Afrique du Sud, en Rhodésie, en Angola et au Mozambique.
Deux semaines après son retour d'Accra, a lieu l'insurrection du 4 janvier 1959 à Kinshasa. Trois cents Congolais sont tués par l'armée. Lumumba prend résolument la défense des pauvres qui ont osé se soulever contre le colonisateur.
Lors du congrès du MNC-L à Kisangani, le 28 octobre 1959, la gendarmerie attaque les nationalistes et tue 20 personnes. Ces jours-là, Lumumba apprend au peuple à ne pas avoir peur devant les fusils de l'ennemi.
"Marchez, n'ayez pas peur! Nous vous demandons si nous mourons demain de garder nos enfants convenablement. Nous allons mourir pour vous et nous ne le craignons pas. Les Belges sont venus avec leurs gros engins, avec des soldats armés de fusils pour nous tuer si nous disons que nous voulons obtenir notre indépendance. " " Eux, ils ont des fusils, nous, nous avons nos mains. Je vous le demande à vous: est-ce que vous avez peur? Nos mains suffiront!"
(La pensée politique de Lumumba, pp.108-111)
Une guerre populaire contre l'occupation belge
Quand, les jours qui suivent l'indépendance, il se voit confronté à la triple agression de l'armée belge, des gendarmes et mercenaires de Tshombé et des troupes de l'ONU, Lumumba s'engage sans hésitation dans la voie de la lutte armée patriotique.
Lumumba s'appuie principalement sur le peuple pour combattre les agresseurs et leurs laquais, Tshombé et Kalonji. Le 20 juillet 1960, il lance un appel à la radio: "Nous préférons mourir pour notre liberté plutôt que de vivre encore dans l'esclavage. Toutes les forces vives de ce pays sont mobilisées pour sauver l'honneur de la patrie et défendre courageusement son indépendance."
(La pensée politique de Lumumba, pp.252)
Lumumba soutient fermement la véritable guerre populaire que les paysans et les ouvriers livrent dans le Nord-Katanga contre les troupes belges et les gendarmes thsombistes. Le jeune Laurent Kabila parcourt la région, de village en village. Il est déjà un dirigeant reconnu et populaire de la résistance patriotique armée.
Un responsable de la Gécamines déclare: "Les 3.000 travailleurs obéissent tous aux mots d'ordre du Balubakat. Tout le pays est Balubakat et les gens d'ici n'ont qu'un Dieu, Lumumba."
(Katanga, enjeu du monde entier, P. Davister, Bruxelles, 1960, p.160)
Un sympathisant belge de Tshombé témoigne de l'ampleur des combats: "En décembre 1960, on évaluait à 7.000 environ le nombre des rebelles tués depuis le début des opérations de représailles de l'armée katangaise dans le Nord-Katanga. Normalement, il faut multiplier ce chiffre par 2, par 3, par 10. Des villages entiers ont été rasés et les armes automatiques ont fauché littéralement des rangs entiers de jeunesse." (ibidem, p.161)
S'appuyer sur les éléments patriotiques de l'armée
Pour lutter contre l'agression, Lumumba mobilise aussi les éléments nationalistes de l'ANC. Il concentre ses meilleures troupes en vue d'une opération contre les sécessionnistes du Katanga et du Sud-Kasaï.
Sur ordre des Américains, Mobutu arrête l'offensive victorieuse. Son homme de confiance, Francis Monheim, reconnaît: "Le colonel Mobutu donne ordre à ses troupes de revenir à Kinshasa. Lumumba convoque son chef d'état-major. 'Je suis ministre de la Défense nationale', dit-il à Mobutu, 'et je ne suis au courant de rien. Vous, vous n'êtes qu'un simple colonel et vous ordonnez le cessez-le-feu sans même consulter votre commandant en chef, le général Lundula'."
(Mobutu, l'homme seul, F. Monheim, Bruxelles, 1974, p.115)
Guerre révolutionnaire pour libérer le Katanga et le Kasaï
Le 5 septembre, Kasavubu fait un coup d'Etat et dissout le gouvernement Lumumba. Il exige que les soldats de l'ANC déposent les armes. Lumumba dénonce cette trahison.
"Monsieur Kasavubu accuse le Gouvernement de jeter le pays dans une guerre civile atroce, alors que le Gouvernement ne fait que défendre le pays contre l'agression brutale, déclenchée à l'égard de la République par les troupes belges. Kasavubu a demandé à l'armée nationale de cesser les luttes fratricides. Le peuple tout entier sait que les soldats congolais, voulant défendre la Patrie, n'ont fait que sauvegarder l'intégrité du territoire national. Les troupes de l'Armée Nationale ne se sont livrées à aucune lutte fratricide. Le Gouvernement et le peuple congolais leur rendent hommage pour le patriotisme et l'héroïsme avec lesquels elles ont défendu la Nation contre l'agression et contre les mouvement de sédition colportées à travers le pays par les impérialistes belges et leurs alliés. Monsieur Kasavubu demande à l'armée nationale de déposer les armes. Le Gouvernement voit dans cette déclaration l'intention de Monsieur Kasavubu de faire occuper militairement le Congo par des troupes étrangères. Il veut interdire ainsi aux troupes de l'Armée Nationale d'entrer au Katanga dans le but de libérer leurs frères opprimés et asservis par les Belges et leur homme de paille, Tshombé."
"Pour Kasavubu, le fait de vouloir intégrer le Katanga pour libérer nos frères, est une guerre atroce, parce qu'il a déjà des contacts avec Tshombé. La victoire du Gouvernement central au Katanga est une victoire sur l'impérialisme. L'Abako s'est arrangée pour dépêcher des émissaires au Katanga. Elle a constitué une délégation composée des membres de l'Abako, du Puna et du M.N.C.-Kalonji. La complicité de l'Abako est manifeste dans l'affaire Katanga."
La pensée politique de Lumumba, pp.332; Annales de la Chambre du Congo, 1960, 7 septembre, p.20)
Vers Kisangani pour diriger la guerre de liberation
Le 27 novembre, Lumumba quitte sa résidence pour rejoindre Kisangani et y prendre la tête des troupes loyalistes. Il pense que l'armée nationaliste peut prendre Kinshasa à partir de Kenge et Bolobo.
Lors de son passage à Mangaï, le 30 novembre, tous les hommes accourent, les armes à la main. Lumumba improvise un discours: "Frères, vos armes sont inutiles maintenant, mais prenez-en soin. Il faudra combattre pour la liberté. Les colonialistes ne veulent pas nous la donner pacifiquement, nous la conquerrons, les armes à la main."
(Patrice Lumumba et la liberté africaine, L. Volodine, Moscou, s.d., p.114)
L'arrivée de Lumumba à Kisangani sera le détonateur d'une guerre révolutionnaire pour libérer le Congo de toute occupation étrangère. Le commandant des troupes de l'ONU, Karl von Horn, note: "A parler franchement tout le pays aurait pu être mis à feu et à sang, si Lumumba était parvenu à Kisangani."
Le 1er décembre, les soldats de Mobutu rattrapent Lumumba et le livrent ensuite à Tshombé.
Sachant qu'il va mourir, Lumumba lance dans sa dernière lettre un ultime appel pour la lutte armée de libération: "Je sais et je sens au fond de moi-même que tôt ou tard mon peuple se débarrassera de tous les ennemis intérieurs et extérieurs, qu'il se lèvera comme un seul homme pour dire non au colonialisme dégradant et honteux et pour reprendre sa dignité sous un soleil pur."
C'est à la suite de cet appel que, trois ans plus tard, dans les premières semaines de 1964, le peuple congolais s'est levé comme un seul homme pour le combat sous la direction de Pierre Mulele et du Conseil National de Libération.
(La pensée politique de Lumumba, p. 390)
Le 9 octobre, Lumumba, qui est protégé par les soldats ghanéens de son ami Nkrumah, fait une sortie dans la Cité où il parle à plusieurs endroits devant un public enthousiaste. Bomboko est furieux et s'écrie : « L'ANC est prête à se battre contre les troupes de l'ONU pour arrêter Lumumba.» Deux cents militaires de Mobutu, envoyés pour arrêter Lumumba, sont repoussés par les soldats ghanéens. (2)
Pendant un mois, Lumumba restera enfermé dans sa résidence.
Pendant cette période, c'est à Kisangani que les choses bougent. A la mi-octobre, cette ville voit se développer un combat acharné entre partisans de Lumumba et partisans de Mobutu. Le 11 octobre, Jean-Pierre Finant, président du gouvernement et proche compagnon de Lumumba, est arrêté. Il sera massacré à Bakwanga par les bandes de Kalinji. A ses côtés, Joseph Mbuyi aura les yeux arrachés et le corps percé par des coup de baïonnettes. Mais le 23 novembre, les militaires fidèles à Lumumba chassent définitivement les soldats de Mobutu de Kisangani. Gizenga, installé dans la ville depuis le 14 novembre, prépare l'arrivée de Lumumba. (3)
Vers le 17 novembre, Lumumba reçoit une lettre de Kisangani. Elle dit que les soldats de l'ANC de l'intérieur du pays lui sont très favorables. Si Lumumba arrive à Kisangani, toute la situation du Congo peut changer. Une opération militaire à partir de Kenge au Kwilu et de Bolobo au Mai Ndombe aura toutes les changes d'aboutir à la libération de Kinshasa. Lumumba décide de partir vers l'Est. (4)
L'arrestation de Lumumba par Mobutu
Dans la nuit du 27 novembre, Lumumba quitte Kinshasa en voiture. Son convoi passe par Kenge et arrive à Masi-Manimba le lendemain à 19h00.
La CIA a immédiatement mobilisé ses hommes de confiance parmi les troupes de l'ONU et celles de Mobutu. Un câble de la CIA du 28 novembre dit : « La station travaille avec le gouvernement congolais pour bloquer les routes afin d'empêcher la fuite de Lumumba.» (5)
Karl von Horn a aussi contribué à «retrouver» Lumumba. Dans ses Mémoires, le commandant des troupes de l'ONU, se félicite de l'arrestation de Lumumba : «A parler franchement, tout le pays aurait été mis à feu et à sang si Lumumba était parvenu à Kisangani.» (6)
Lumumba traverse le Kwilu en passant par Bulungu et Mangai. Puis, on le trouve à Brabanta, Port-Franqui, Mweka et Lodi. Dans cette dernière localité, le 1er décembre, à 23h00, Lumumba passe la rivière Sankuru en pirogue en compagnie de Pierre Mulele, de Valentin Lubuma et de Mathias Kemishanga.
Un peu plus tard, le bac arrive sur l'autre rive et un groupe de soldats mettent pied à terre. Lumumba, seul, s'avance pour discuter avec eux. Après de longues palabres, il est arrêté et conduit à Port-Franqui le 2 décembre au matin. Mulele parviendra à Kisangani.
Sur instructions de Mobutu, le chef de la Sûreté, Nendaka, ordonne à Pongo de ramener Lumumba à Kinshasa. Le soir, à 17h00, un DC 3 d'Air Congo, ramène Lumumba à Ndjili. Il est ligoté et jeté ligoté sur un camion militaire, puis conduit au camp de Binza, devant Mobutu. « Le colonel Mobutu, les bras croisés, a regardé calmement ses soldats frapper et bousculer le prisonnier et le tirer par les cheveux. » (7)
Lumumba est tabassé avec une extrême violence, les militaires lui brûlent la barbe. Au matin du 3, il est enfermé au camp Hardy de Thysville.(8)
Les lumumbistes contre-attaquent
Le 7 décembre, Kasavubu se réjouit de la capture de son principal adversaire: «Je m'étonne de l'importance attachée à l'arrestation de Lumumba par un certain nombre de délégations afro-asiatiques et est-européennes; en effet, Lumumba est sous le coup d'un mandat d'arrestation depuis septembre. Il s'est rendu coupable des infractions suivantes : atteintes à la sécurité de l'Etat et organisation de bandes hostiles dans le but de porter la dévastation et le massacre.»
Kasavubu y ajoute qu'à Kisangani, où règnent les lumumbistes, les gens connaissent «le terrorisme, la torture et la suppression de toute liberté individuelle.» (9)
Mais, en réalité, à Kisangani le pouvoir lumumbiste se consolide et s'étend. Le 12 décembre, Gizenga déclare que Kisangani est désormais le siège du gouvernement légal et la capitale provisoire de la République.» (10)
Deux semaines plus tard, les lumumbistes prennent le pouvoir à Bukavu, capitale du Kivu. Le 1er janvier 1961, Pongo, l'homme qui arrêta Lumumba, échoue lamentablement dans sa tentative d'occuper Bukavu. Il est fait prisonnier. Kashamura forme un gouvernement lumumbiste à Bukavu.
Le 9 janvier, les troupes congolaises fidèles à Lumumba et dirigées par Lundula, libèrent Manono. La lutte armée pour la libération du Katanga prend de l'ampleur.
Cette montée de la lutte révolutionnaire populaire aboutirait certainement à la victoire si Lumumba, libéré, pouvait se mettre à sa tête.
Le 13 janvier, sous l'impulsion de Mulele et des militants du PSA et du MNC-L, une mutinerie éclate à Thysville pour libérer Lumumba.
La CIA veut la mort de Lumumba
La CIA comprend qu'il est urgent d'assassiner Lumumba si elle veut sauver la domination impérialiste sur le Congo.
Depuis octobre, la CIA poursuit une ligne constante : utiliser ses agents congolais pour éliminer Lumumba. Hedgman, le chef de station de la CIA à Kinshasa, câblait alors : «Station a fermement poussé leaders congolais arrêter Lumumba ; pense Lumumba continuera à être menace pour stabilité Congo jusqu'à son élimination de la scène.» (11) Le 13 janvier, après la mutinerie qui faillit libérer Lumumba, Hedgman envoie un autre message au directeur de la CIA : «La combinaison des talents de Lumumba comme démagogue, sa capacité d'utilisation de groupes de propagande assureraient presque certainement Lumumba d'une victoire au parlement. Le refus de prendre des mesures radicales maintenant conduira la politique des Etats-Unis au Congo à la défaite.» (12)
Nous avons ici la décision finale de la CIA pour l'élimination de Lumumba. A ce moment, la CIA est en relation permanente avec Mobutu, Kasavubu, Tshombé, Munongo, Nendaka, Kazadi, Adoula et tous ceux qui sont mêlés à la décision d'envoyer Lumumba à la boucherie de Lubumbashi.
Le 14 janvier déjà, la Sûreté de Nendaka envoie un télégramme à Lubumbashi: «Collège commissaires généraux se permet insister afin obtenir accord pour transférer Lumumba dans province du Katanga.» Deux commissaires, Ferdinand Kazadi et Mukamba Jonas, sont chargés d'accompagner le prisonnier dans l'avion.
L'assassinat du 17 janvier 1961
17 janvier à 16h45, trois hommes noirs, les yeux bandés et les bras ligotés derrière le dos, sortent du DC 4 qui vient d'atterrir à la Luano, Lubumbashi. Il s'agit de Lumumba, Mpolo et Okito. Ils sont immédiatement encerclés par des gendarmes katangais, encadrés par des officiers belges. Munongo assiste à la scène. Lumumba et ses deux compagnons ont été tués le même soir.
Les services de renseignement occidentaux et leurs hommes de main sont immédiatement au courant de la mort de Lumumba. Le 19 janvier déjà, des officiers congolais, assistés par le conseiller militaire de Mobutu, le colonel belge Marlière, arrivent à Lubumbashi pour discuter avec Tshombé d'un accord de coopération militaire Kinshasa-Lubumbashi et d'un commandement unique. Nendaka débarque quelques jours plus tard. Tous les défenseurs de l'impérialisme comprennent que l'annonce de la mort de Lumumba provoquera une révolution dans tout le pays. Ils veulent du temps pour se préparer à l'affronter. Ils savent que les Kasavubu, Mobutu et Bomboko à Kinshasa auront besoin de l'aide militaire des Tshombé à Lubumbashi et des Kalonji à Babwanga pour combattre le nouvel essor de la révolution populaire nationaliste.
Ce n'est que le 13 février que Munongo annonce à la presse internationale la mort de Lumumba «tué par des villageois dans un petit village près de Kolwesi.» Dans le texte qu'il a lu, il y a cette phrase : «On nous accusera de les avoir assassinés. Je réponds: Prouvez-le !» (13)
« Nous suivrons l'exemple de Lumumba ! »
Le lendemain, au Caire, Pierre Mulele fait une déclaration au nom du gouvernement légal : « Les patriotes congolais s'engagent aujourd'hui à suivre l'exemple de Lumumba et à combattre jusqu'à ce que la libération totale de leur pays soit réalisée sous la conduite du gouvernement légal congolais. L'assassinat de Lumumba a été préparé et exécuté par les colonialistes belges et leurs hommes de main congolais. M. Hammarskjöld figure parmi les responsables de la mort de l'ex-premier ministre congolais. Le secrétaire général de l'ONU est l'instrument de la politique de l'administration américaine. Le gouvernement de Kisangani va prendre les mesures nécessaires contre les colonialistes belges et leurs alliés et contre tous ceux directement ou indirectement responsables de la mort de Lumumba et de ses deux compagnons.» (14)
1) Heinz et Donnay,p.36; 2) ibidem,p.38; 3) Congo, 60, II, p.997-8 et 1042; 4) Heinz et Donnay,p.17; 5) Les Complots de la CIA,p.152; 6) von Horn,p.236; 7) AP, dans Heinz et Donnay,p.64; 8) ibidem ,p.69; 9) Congo, 60, II, pp.1060-61; 10) ibidem, p.1041; 11) Les complots,p.142; 12) ibidem, p.152-153; 13) Congo 1961,p.665; 14) Courrier Africain, 13 mars 1964, p.5.
"Le peuple doit se défendre contre ses ennemis"
Depuis le premier jour de l'indépendance, tous les " évolués " qui s'étaient vendus au colonisateur, menaient des campagnes pour détruire le gouvernement nationaliste. Souvent liés au milieux catholiques, ils avaient le plein soutien de la bourgeoisie belge et de ses différentes organisations. Ainsi, fin juillet 1960, le syndicat chrétien de Bolikango, l'UTC, publie un communiqué se plaignant de ce que "le Congo s'est engagé sur la voie de la misère." Le syndicat pro-colonialiste rend Lumumba responsable des fermetures d'usines, des augmentations de prix, de l'accroissement du chômage.
Lumumba comprend parfaitement que ces complots sont dirigés par la Belgique, qui utilise ses hommes de main, les Malula, Ileo, Bolikango, Tsombé, Kalonji, Boboliko.
Il déclare qu'un gouvernement patriotique doit avoir le courage de lutter contre les ennemis du peuple, contre les ennemis de l'indépendance.
«C'est le peuple qui, à travers son gouvernement central, va lutter contre la mauvaise propagande, contre les ennemis de la liberté, contre les ennemis de la patrie, contre les traîtres. On a distribué à travers la cité de Léo des milliers de tracts séditieux qui sont venus tout droit de Bruxelles. Ils ont été transportés à bord des avions Sabena, dans des caisses portant la mention 'Journaux'. Un de ces tracts dit: 'Congolais, Lumumba va vendre vos femmes à la Russie'. Un autre tract, texte en Lingala : 'J'ai fait le pacte avec le diable, tant pis pour les Congolais.' Les Belges ne peuvent plus distribuer eux-mêmes leurs tracts aujourd'hui, et ce sont des Noirs qui détruisent le Congo, pour avoir reçu 500 francs. Si c'est votre frère, votre fils qui vend notre pays, qui collabore avec l'ennemi, c'est à vous, au peuple, d'être juge, d'arrêter ce voyou, ce collaborateur, ce traître." "Nous avons décidé de réglementer la liberté de la presse. Personne ne peut affirmer que le Courrier de l'Afrique est un journal appartenant à un Congolais. Qui parmi vous ignore que le Courrier de l'Afrique est un organe du syndicat chrétien de la Belgique? Qu'il est un organe de propagande contre notre peuple ? Nous avons décidé de réglementer tous ces journaux qui sont contre la Nation. Ce sont tous ces milieux catholiques qui mènent leur propagande dans leurs journaux qui provoquent tous les malheurs que nous connaissons. Devons-nous permettre cet état de choses? Alors que l'on prend des mesures pour vous libérer, ils appellent cela de la dictature!» (La pensée, pp.311-312)
Sur le mauvais usage de la religion
«Des évêques abandonnent leur mission d'évangélisation pour s'ingérer dans les affaires de l'Etat. Les Missions abandonnent leur mission pour mener une campagne d'obstruction à l'égard de l'Etat. Jour après jour, nous nous voyons insultés à travers leur presse. Ils ont porté gravement atteinte à la sûreté de l'Etat, ils ont commis des infractions graves.» (La pensée, p.289)
«Ces anti-nationaux, déjà à la solde des colonialistes, touchent l'argent des colonialistes, et avec cet argent ils écrivent des saletés. Aujourd'hui, des mouvements, soi-disant des mouvements familiaux catholiques, vont jusqu'à attaquer le gouvernement au nom des ligues, des jocistes, des groupements catholiques. Ils veulent détruire la nation congolaise, nous n'allons plus tolérer cela. C'est la séparation de l'Eglise et de l'Etat. Notre gouvernement ne va jamais s'ingérer dans les affaires de l'Eglise.» (La pensée, p.290)
«Le gouvernement ne peut d'aucune façon tolérer qu'on s'immisce dans les affaires de l'Etat Nous ne regardons rien d'autre que l'intérêt du peuple, et non l'intérêt des milieux financiers ou de l'Eglise de ceci ou cela Nous ne voulons pas qu'on fasse au Congo ce qu'on fait en Belgique, la dictature de l'Eglise sur le gouvernement. Et c'est un gouvernement catholique, ce sont ces milieux catholiques qui ont, de façon systématique, durant 80 ans, retardé l'émancipation politique du Congo. Ce sont ces gens qui disaient qu'il ne fallait pas introduire la politique au Congo parce que " la politique leur permettra de voir clair." Et ce sont ces mêmes milieux catholiques et religieux qui, même récemment, pendant la campagne électorale, prêchaient contre les nationalistes.»(La pensée, p.290)
«Il fallait simplement réciter le catéchisme colonial pour qu'on vous bénisse. Le fait pour un Congolais d'avoir exprimé son idée : " C'est un anti-Blanc, c'est une mauvaise religion " Interdiction ! C'est ça qu'ils veulent faire aujourd'hui pour démontrer à travers le monde que nous sommes des communistes.» (La pensée, p.296)
«Nous allons procéder à la décolonisation mentale parce qu'on endoctrine faussement le peuple depuis 80 ans. Avec notre cerveau, avec nos mains, nous allons développer le Congo.» (La pensée, p.300)
A propos du communisme et de l'impérialisme
«En Afrique, tout ce qui est progressiste, tout ce qui tend au progrès est qualifié de communiste, de destructeur. Il faut toujours faire des courbettes et accepter tout ce que les colonialistes vous offrent. Nous sommes simplement des hommes honnêtes et notre seul objectif a été: libérer notre pays, construire une nation libre et indépendante.» (La pensée politique de Lumumba, p.272)
«On parle de communisme. Savez-vous, mes chers amis, que certains jouent le jeu des impérialistes? Pendant la campagne électorale, les missions catholiques avaient imprimé des brochures qu'elles ont distribuées partout et prêchaient même dans les églises de ne point voter Lumumba, de ne point voter Kashamura. Est-ce que le peuple les a écoutées?» (La pensée, p. 342)
«Les impérialistes disent qu'ils sont contre le communisme, qu'ils sont contre l'Union soviétique et quand nous leur demandons une aide, ils nous la refusent et préfèrent la donner à Tshombé et à tous ceux qui réalisent leurs manoeuvres Tous ces discours dans lesquels on me taxe de communiste, où l'on prétend que j'aurais l'intention de faire du Congo une Union soviétique, sont en réalité écrits par les Belges et les Français.» (La pensée, pp.344-345)
«L'Union soviétique est un peuple comme toute autre nation. Les questions d'idéologie ne nous intéressent pas. Notre politique de neutralisme positif nous recommande de traiter avec toute nation qui a des intentions nobles et qui ne viendrait pas chez nous dans le but d'instaurer une autre domination.» (La pensée, p.281)
«Quand nos frères luttaient partout, étaient-ce des Russes qui nous instiguaient à réclamer l'indépendance? Qui nous a exploités durant 80 ans, n'est-ce pas les impérialistes? Ils considèrent le Congo, avec ses richesses, comme leur réserve nationale.» (La pensée, p.366)
«En Afrique, tous ceux qui sont progressistes, tous ceux qui sont pour le peuple et contre les impérialistes, ce sont des communistes, ce sont des agents de Moscou!!! Mais tout ce qui est en faveur des impérialistes, celui qui va chercher chaque fois l'argent, le mettre en poche pour lui et sa famille, c'est un homme exemplaire, les impérialistes le loueront, le béniront.
PIERRE MULELE:HISTOIRE ET COMBAT
L'histoire fait partie de notre passion au sein de Ammafrica world!
Comprendre le passé, nous fait comprendre le présent pour bien préparer le futur....
Ammafrica world.
Qui était Pierre MULELE dans l'histoire politique du Kongo(Rdc)?
Page de Pierre Mulele

Au moment de la lutte pour l'indépendance, le Congo connaissait déjà des classes sociales bien distinctes. Certaines classes voulaient que le colonialisme reste en place. D'autres classes voulaient l'indépendance, mais différentes classes donnaient un contenu différent à cette indépendance.
Les classes sociales qui défendaient le colonialisme
Il y avait d'abord la grande bourgeoisie coloniale. C'étaient les managers des sociétés, les hauts fonctionnaires d'Etat et les dignitaires de l'Eglise qui dominaient politiquement et économiquement la colonie. L'Union minière, créée en 1906 avec un capital de 10 millions de francs, réalisa entre 1950 et 1959 un bénéfice net de 31 milliards de francs. Les cinq dernières années du régime colonial, elle comptait 21,81 milliards de bénéfices et d'amortissements. Il est évident que cette classe avait tout intérêt à maintenir en place le système colonial.
Cette grande bourgeoisie, essentiellement belge, s'appuyait sur trois autres classes:
La bourgeoisie moyenne était composée de patrons européens établis au Congo. Ceux-ci possédaient des petites et moyennes entreprises.
La petite bourgeoisie européenne était formée par l'échelon inférieur des employés blancs de l'administration et des entreprises, par des petits commerçants et par l'aristocratie ouvrière: c'est-à-dire les ouvriers blancs spécialisés et les contremaîtres européens.
Enfin l'aristocratie noire constituait un rouage important du système colonial. Dans un décret colonial de 1906, la politique à suivre vis-à-vis des chefs coutumiers est clairement décrite : "Les chefs de villages sont les intermédiaires naturels entre les autorités de l'Etat et la population indigène. Soutenus par l'Etat, les chefs formeront dans tout le Congo une classe extrêmement utile, intéressée au maintien d'un ordre des choses qui consacre leur prestige et leur autorité. » Les chefs coutumiers recevaient une prime calculée en fonction du nombre d'indigènes qu'ils administraient ainsi qu'un pourcentage sur les impôts payés par leurs sujets.
Les classes opposées au colonialisme
Du côté du peuple congolais, on pouvait discerner cinq classes sociales qui avaient, chacune pour ses propres raisons, intérêt à chasser les colonialistes. Pour renverser le colonialisme, il fallait réunir le plus possible de forces.
Une minorité de chefs coutumiers, surtout parmi ceux dont l'autorité ne s'exerçait que sur un nombre restreint d'hommes, refusa de collaborer et s'opposa au colonialisme.
Puis, il y avait la bourgeoisie nationale. En 1958, il y avait 21.683 'firmes d'indigènes' engagées dans des activités commerciales, des briqueteries, des entreprises de construction, des scieries, des garages et des hôtels. En 1958, 6.500 patrons noirs engageaient des ouvriers salariés. D'autres groupes 'd'évolués' avaient, à cause de leurs privilèges, la même position que la bourgeoisie nationale: les prêtres, les assistants médicaux, les assistants agronomes et les employés supérieurs dans les sociétés. En 1960, la bourgeoisie nationale ne comptait que 10.000 personnes. Une fraction de la bourgeoisie nationale, liée souvent aux chefs coutumiers, s'enrichit en collaborant avec les grandes sociétés étrangères. Cette fraction voulait l'indépendance pour pouvoir s'enrichir plus vite et cela par la collaboration avec les anciens colonialistes.
La petite bourgeoisie noire était composée par les employés et les fonctionnaires noirs, et par les indépendants noirs n'utilisant pas de salariés. En 1958, les entreprises européennes regroupaient 68.498 employés. En 1960, les agents congolais de l'Administration étaient au nombre de 98.000.
Les paysans produisant de manière traditionnelle représentaient 77% de la population.
Le prolétariat et le semi-prolétariat: le développement considérable des grandes entreprises capitalistes avait créé une des plus importantes classes ouvrières d'Afrique. En 1956, le Congo comptait 1.199.896 salariés (sur une population totale de 13 millions de personnes). 755.944 pouvaient être considérés comme des prolétaires.
Dans les villes existait aussi une importante légion de sous-prolétaires. En 1959, à Léopoldville, 36.000 personnes étaient officiellement enregistrées comme chômeurs, ce qui représentait presque un tiers des personnes actives. Le nombre de travailleurs sans emploi était encore plus élevé, car beaucoup de jeunes résidaient clandestinement dans la capitale. Ce sont ces jeunes qui donneront, le 4 janvier 1959, le signal de la révolte populaire qui marqua le début de la lutte ouverte pour l'indépendance.
|
|||
ANTOINE GIZENGA LIVRE SA VIE ET SES LUTTES
Vient de paraître sur le marché congolais : « Ma vie et mes luttes », une autobiographie d’Antoine Gizenga
Kinshasa, 13/01/2012
L’ouvrage du patriarche Antoine Gizenga raconte sans intrigues, la vie, les combats menés par ce dernier dans le but d’instaurer la liberté et conquérir l’indépendance de la Rdc.
COMMEMORATION DE LA DISPARITION DES DEUX HEROS NATIONAUX CONGOLAIS :LUMUMBA ET LD KABILA
DEUX HEROS NATIONAUX A DESTIN COMMUN: LUMUMBA ET LD KABILA!
Kinshasa, 13/01/2012
La caractéristique des destins des deux héros nationaux dont va être commémoré le 16 et le 17 courant les anniversaires de disparition est leur idéal commun de patriotisme et de nationalisme pour lesquels ils ont d’ailleurs sacrifié leurs vies pratiquement à la même date des cycles annuels

En pleine guerre froide entre l’Ouest et l’Est dans les années 60, Lumumba, accusé d’être « communiste » pour avoir tout simplement défendu les intérêts de son pays, en a payé de son sang. Il a été assassiné. M’Zée Laurent-Désiré Kabila, protecteur du « courant du nationalisme congolais » créé par Lumumba, est tombé en janvier 2001 dans les griffes des mêmes forces du mal, après avoir mis fin à la dictature. Les deux dates les plus rapprochées du calendrier poussent à émettre la réflexion que « la mort est la fin d’une prison obscure » que jamais les pleurs ne pourront réveiller.
Il n’existe pas de remède contre la mort. Mais l’assassinat de Lumumba et de Laurent-Désiré Kabila n’a entamé en rien le « nationalisme congolais » qu’ils ont légué à leur peuple. Aujourd’hui, ceux des Congolais ayant de loin ou de près participé à leur élimination éprouvent d’énormes difficultés à évoquer leur mémoire ou faire référence à la cause qu’ils défendaient et que le peuple congolais continue de défendre.
Le même destin attend ceux qui les ont tués. Si seulement leurs assassins savaient ce qu’Esope disait à ce sujet, déjà vers les années 550 avant Jésus-Christ, à savoir que « celui qui est mort est encore fort pour la vengeance, car la justice divine surveille tout et, rendant à chacun suivant ses œuvres, tient pour tous la balance égale », ils n’auraient pas commis ce crime. Soldat du peuple, le Président Laurent-Désiré Kabila, tout comme le Premier ministre Lumumba, lègue au peuple congolais notamment l’amour du travail, seul vrai facteur du développement du pays. Son idée-force ou sa philosophie peut se résumer en une seule phrase : « Nous devons nous prendre en charge ». M’Zée Kabila a su réveiller la conscience des Kinois sur la nécessité d’exploiter le plateau des Bateke. Car, ne cessait-il de dire, le Congo est capable de se nourrir, affirmait-il.
Soldat du peuple, le Président Laurent-Désiré Kabila, tout comme le Premier ministre Lumumba, lègue au peuple congolais notamment l’amour du travail, seul vrai facteur du développement du pays. Son idée-force ou sa philosophie peut se résumer en une seule phrase : « Nous devons nous prendre en charge ». M’Zée Kabila a su réveiller la conscience des Kinois sur la nécessité d’exploiter le plateau des Bateke. Car, ne cessait-il de dire, le Congo est capable de se nourrir, affirmait-il.
L’un de ses compagnons, Kambale Kabila Mututulo, témoignait à l’époque que la politique extérieure de M’Zée n’a pas plu aux puissances qui cherchaient à « nous exploiter ». Il a prouvé à ses concitoyens que le sol congolais suffit pour « nous épargner de la famine ». Cela a suscité la curiosité des étrangers qui ont vite réalisé que cet homme était intelligent et qu’il risquait de devenir fort au Sud du Sahara. Il n’avait en effet contracté aucune dette à l’extérieur. D’où le complot de son assassinat.
Sur le plan interne, M’Zée Laurent-Désiré Kabila a ouvert les portes de la démocratie, de la liberté et du patriotisme, appelant sans cesse ses compatriotes à « ne jamais trahir le Congo ». Soldat du peuple, il est mort au front, l’arme à la main, tué comme Patrice-Emery Lumumba pour leurs idées nationalistes.
ACP
MOSENGWO ET LE COMPLOT ANTI-NATIONALISTE PAR LUDO MARTENS
MOSENGWO ET LE COMPLOT ANTI-NATIONALISTE PAR LUDO MARTENS!
Une analyse de Ludo Martens du 5 mars 2001
qui reste d’actualité en 2006 et de nos jours...
Imposer le néocolonialisme au Congo, c’est assassiner Kabila une seconde fois
Ludo Martens, 5 mars 2001
Le discours du Président Joseph Kabila du 24 janvier est interprété de façon malveillante par tous les politiciens pro-impérialistes comme un changement fondamental de stratégie par rapport au kabilisme, comme une rupture avec « l’extrémisme » et « la dictature » de Mzee Laurent-Désiré Kabila, et non comme un réajustement de la politique nationaliste à la nouvelle situation.
Aujourd’hui, l’impérialisme spécule sur la désorganisation, le désarroi et les luttes internes dans le camp nationaliste, suite à la disparition du Président Mzee Kabila. Immédiatemment l’Occident a activé tous ses agents – les rebelles, les partis de ‘l’opposition’, certains chefs religieux et certains infiltrés dans l’entourgage de Mzee Kabila – pour présenter la voie de la soumission au néocolonialisme comme « la seule route vers la paix ».
Toutes ces forces mènent une campagne concertée à l’échelle nationale et internationale pour faire croire que Joseph Kabila a fait « des ouvertures » à leur égard et qu’il ne lui reste pas d’autre choix que de capituler devant les agresseurs et leurs commanditaires.
Ces forces néocoloniales font croire aujourd’hui à la masse que Joseph Kabila les a rejoint sur la voie du « libéralisme », de « l’ouverture » et de l’acceptation intégrale des « Accords de Lusaka ». Leur but est de préparer le terrain pour provoquer des émeutes, le jour où il apparaîtra que le nouveau Président reste fidèle au nationalisme de Mzee Laurent-Désiré Kabila.
Depuis plus de dix ans, Monsengwo est l’homme-clé de la politique américaine, française et belge au Congo. Il était à la base de la « démocratisation » du 24 avril 1990, il a présidé le bureau de la CNS fin 1991, il poussa à l’élection de Kengo en 1994, il était en mai 1997 le candidat de l’impérialisme pour assumer la Présidence de la République et priver ainsi Kabila de la victoire !
La Déclaration du 28 janvier 2001 de Monsengwo trace la ligne qui sera suivie par tous les agents de la Troïka dans les mois à venir. Elle comporte essentiellement sept thèses qui constitueront désormais « la bible » et le programme commun de toutes les forces néocoloniales au Congo. Nous les réfuterons une par une.
De la transition « démocratique » sous Mobutu à la «dictature » de Kabila ?
Première thèse de Monsengwo. « La CNS a formulé un projet de société basé sur la démocratie et l’état de droit qui a été consacré par des textes acceptés par toute la classe politique et par l’ensemble du peuple. Autour des textes de la CNS, il y avait un consensus national. » (Point 1.1.)
Réfutation. Il n’y a jamais eu d’unité entre la classe politique de l’époque de la Transition. Elle était divisée sur un problème tactique. D’un côté, il y avaient les anciens mobutistes partisans de la CNS et d’une limitation du pouvoir du président Mobutu et de l’autre côté il y avaient les mobutistes-durs-et-purs qui soutenaient le maintien des pouvoirs du Président-Fondateur.
En pleine CNS, les 23 et 27 juillet 1992, Monsengwo a conduit une délégation de la CNS et il a négocié un « compromis global » avec Mobutu . Dix jours plus tard, la CNS adopta un « Acte constitutionnel ». Les deux textes sont contradictoires sur des points essentiels et c’est la division en deux blocs de la classe politique ! L’armée refuse de reconnaître l’Acte constitutionnel. Le 5 octobre 1992, l’ancien Assemblée nationale de Mobutu se réunit contre la CNS. Du 9 au 18 mars Mobutu organise le Conclave politique dont sortira le gouvernement Birindwa. Mais Tshisekedi a toujours « son » poste de premier ministre et remanie « son » gouvernement le 22 mars. Bagarre effrayable entre deux « gouvernements zaïrois » ! Monsengwo déclare : « Ni Tshisekedi, ni Birinwa ne peuvent réconcilier la classe politique ». Et il lance un appel pour que la classe politique « reprenne le dialogue inutilement bloqué ». Cela conduira aux négociations et à l’Accord du Palais du Peuple du 13 septembre 1993. Le Haut Conseil de la République, organe créé au moment de la dissolution de la CNS… fusionne maintenant avec l’Assemblée nationale mobutiste, pour devenir le HCR-Parlement de Transition. Cette transformation fut l’œuvre de Monsengwo, Kengo, Kamanda, etc. qui avaient initié « la troisième voie ». L’année suivante Monsengwo fut chassé de son fauteuil de président du HCR-PT par ses « amis » Kengo, Tshisekedi, Kibassa, Kamanda. En 1976, l’USORAL-USORAS a saisi la Cour suprême de Justice pour contester l’élection de Kengo comme premier ministre. La même année le HCR-PT amendait les projets de Constitution et de Loi électorale dans une atmosphère de contestation généralisée.
Où était ce fameux « consensus de la classe politique autour des textes de la CNS » pendant toutes ces années ?
Monsengwo pense que le peuple congolais n’a pas de mémoire. Pour combattre Joseph Kabila et les forces nationalistes, il affirme aujourd’hui : « Tous ceux qui étaient au pays lors de la CNS se sentent liés par le consensus. Il y a des personnes arrivées en mai 1997 qui disent ne pas se reconnaître dans la CNS. La démarche consiste à convaincre les nouveaux arrivants du bien-fondé du consensus précédent, soit à actualiser ce consensus. »
Monsengwo, que les Congolais connaissent très bien comme le croque-mort et le fossoyeur de la CNS, prétend aujourd’hui que la classe politique mobutiste de la transition était unanime pour appuyer le CNS et que les nationalistes autour de Joseph Kabila n’ont qu’à les rejoindre !
Les Congolais se rappellent que pour diriger la croisade contre la CNS, Mobutu avait comme « évangélisateur » le fondateur du ministère « Amor Dei », son Conseiller Spécial pour la Sécurité, Honoré Ngbanda. Ce dernier, dans une publication qui est sortie au moment de l’assassinat de Kabila, déclara : « Croyez-moi, si nous revenions aux acquis de la Transition, issus de la Conférence nationale souveraine et qui ont reçu l’accord et le soutien de l’ensemble de la classe politique, nous pouvons obtenir des résultats et rapidement ».
C’est à l’aide de mensonges aussi grossiers que les mobutistes essaient de marteler dans la tête des Congolais que le « consensus » régnait du temps de la CNS !
Or, ce même N’Gbanda a publié en 1994 tout un livre intitulé « Afrique : démocratie piégée » dont le but était de peindre dans les couleurs les plus sombres cette farce qui s’appelait Conférence nationale et souveraine! Voici comment N’Gbanda décrit en 1994 le « consensus » de la CNS : « Au Zaïre, les conférenciers dans leur majorité, se désignaient eux-mêmes, directement ou indirectement. Leur participation devait leur revenir de droit, à eux fondateurs de partis politiques ou d’associations de circonstance, avec, souvent, des épouses, enfants et neveux, beaux-frères, copains de villages, etc » « Le concept même de conférence, dans sa concrétisation, est porteur de plusieurs éléments de division. On a vu dans la Conférence un lieu de contestation de la légitimité des dirigeants considérés comme responsables de tout le bilan négatif du passé, et un de légitimation de nouvelles forces et de nouveaux leaders. Mais quels nouveaux leaders ? Presque tous les grands ténors de l’opposition au sein de la Conférence Nationale et Souveraine sont des gestionnaires attitrés, les créateurs et les animateurs de la Deuxième République, ce régime diabolisé qu’ils prétendent, eux, juger et condamner. On ne peut être à la fois assassin et juge. …La Conférence devenait donc un cadre d’oppositions politiques exacerbées et de règlements de comptes. Les clivages entre tribus et régions se sont approfondis. »
Nous arrivons à la deuxième thèse de Monsengwo. « L’ordre de la CNS a été sacrifié au profit de la nouvelle dictature de Kabila qui a refusé le consenus national et a pris le pouvoir par la force. » (Point 1.3.)
Par cette thèse, Monsengwo se manifeste comme un des principaux idéologues du néo-mobutisme. En fait, c’est presque mot pour mot la thèse essentielle de tous les défenseurs de l’impérialisme, des mobutistes aux rebelles. Ainsi, le 13 septembre 1999, l’agent ougandais et mobutiste Jean-Pierre Bemba affirma : « Nos références sont les travaux de la grande réflexion de 1991-92 qui ont posé les bases de notre renouveau démocratique. Mais un groupe de rêveurs aux idéologies révolues a pris la lourde responsabilité d’interrompre le processus démocratique. En refusant de s’inscrire dans le schéma tracé par la CNS , Kabila entend nous ramener dans l’option de la dictature »
L’ordre de la CNS était toujours l’ordre néocolonial mobutiste, adaptée à la nouvelle situation internationale caractérisée par la disparition du socialisme en Union Soviétique et en Europe de l’Est. L’écrasante majorité des politiciens de la CNS-HCR-PT ne voulait la fin ni du mobutisme, ni du néocolialisme. Mais Monsengwo, Bemba et les autres ex-MPR nous font croire qu’entre 1990 et 1997, le peuple a connu un « renouveau démocratique » qui a été interrompu par la « dictature » de Kabila.
Oui, il y a eu « processus démocratique » pour les cliques qui s’enrichissaient grâce à la CNS-HCR-PT. Mais sous la Transition, le peuple n’a eu qu’un « processus d’appauvrissement constant ». En 1990 le Congo comptait 1.604.900 salariés dans le secteur public et privé. Au cours du « processus démocratique », entre 1990 et 1996, non moins que 610.600 emplois ont été supprimés ! Le Produit intérieur brut par habitant est tombé de 295 dollars en 1990 à environ 133 dollars en 1996. Entre le premier coup d’Etat de Mobutu en 1960 et la « démocratisation » en 1990, le produit intérieur brut avait déjà chuté de 380 dollars à 295. Que ce soit lors de la période de dictature ouverte ou celle de la « dictature démocratisée », le niveau de vie des Congolais a chuté, mais la baisse s'est notablement accélérée pendant la CNS et la transition. Et Bemba de s’indigner que des « rêveurs aux idéologies révolues » ont « interrompu le processus démocratique ». En réalité, ce sont ces « rêveurs », et eux seuls, qui ont réussi à briser le système mobutiste criminel qui s’éternisait grâce à la « transition ». Sans ces rêveurs, le « mobutisme avec Mobutu » que nous avons connu pendant les années de « transition » se serait transformé en « mobutisme sans Mobutu » après la mort du dictateur. Rien de fondamental n’aurait changé au système en place.
Voilà pourquoi, après six années d’espoirs trompés, le peuple, dans son écrasante majorité, a soutenu la guerre de libération de Kabila et s'est mobiliser pour la soutenir.
Interdiction de résister aux agresseurs ?
Troisième thèse : « La prise unilatérale du pouvoir par Joseph Kabila expose le pays aux mêmes dangers : l’oppression et la répression et la poursuite de la guerre. » (Point 1.6.)
La légitimité de Mzee Laurent-Désiré Kabila provenait de trois sources. D’abord, il a dirigé en 1996-97 la guerre de libération qui a réussi à libérer le Congo du mobutisme imposé au pays entre 1965 et 1996. Ensuite, au cours de l’année 1997-98, Kabila a entamé la reconstruction nationale qui a amélioré la situation économique des populations. Finalement, Mzee a dirigé avec énergie et de façon habille la guerre nationale de résistance contre l’agression américano-rwando-ougandaise et il a soulevé toute la population congolaise dans un élan de patriotisme.
Après l’assassinat de Mzee Laurent-Désiré Kabila, les organes de l’Etat qui incarnent la légalité et la légitimité du pouvoir nationaliste, ont décidé de continuer son œuvre en choisissant Joseph Kabila comme son successeur. Craignant la continuation de la politique nationaliste, Monsengwo, en véritable porte-parole des puissances impérialistes, déclare : « Joseph Kabila expose le pays aux mêmes dangers ».
Monsengwo mentionne un premier danger : « l’oppression et la répression » qu’organisa le défunt président.
Or, sous Mzee Kabila, la population a connu une nette amélioration de sa situation sécuritaire. Les exactions des militaires et des ‘forces de l’ordre’ contre la population ont fortement diminué quoique, inévitablement, certains habitudes du temps de Mobutu ont continué. Sous Kabila, la répression était essentiellement dirigée contre les forces qui complotaient avec l’impérialisme, avec les agresseurs et avec la rébellion. Cette répression était nécessaire pour sauver l’indépendance et la souveraineté du Congo. L’assassinat de Kabila vient confirmer qu’il n’y a pas eu une vigilance et une fermeté comme il fallait envers ces forces du mal.
Puis, parmi « les dangers » que le Congo court sous Joseph Kabila, Monsengwo cite aussi « la poursuite de la guerre » ! C’est absolument ignoble. L’ONU a reconnu que le Congo est agressé, occupé et pillé par le Rwanda et l’Ouganda. Le gouvernement congolais a le devoir sacré de continuer le combat militaire et diplomatique jusqu’à ce que les agresseurs se retirent sans conditions.
Pas d’agression au Congo mais un « conflit interne » ?
Quatrième thèse : « La seule solution, c’est le Dialogue inter-congolais dans le cadre des Accords de Lusaka en vue de récréer le consensus national de la CNS rompu par Kabila. » (1.7.)
La position fondamentale de Monsengwo est sa négation de la guerre d’agression criminelle qui a déjà tué 3.000.000 de Congolais. Monsengwo reprend ce que les Rwandais, Ougandais et Américains et les rebelles disaient au début de la guerre : il n’y a pas d’agression extérieure, il y a un conflit intérieur entre les forces « démocratiques » et la « dictature de Kabila ».
Mais heureusement, grâce aux enseignements de Mzee Kabila, la population congolaise est désormais éveillée. Elle sait que, face à une agression barbare, la solution n’est certainement pas un « dialogue » avec les « rebelles », et encore moins un « consensus » avec ces marionnettes impuissantes des agresseurs ! La solution sera donnée par l’unité de toutes les forces patriotiques dans le combat héroïque pour bouter dehors les agresseurs et ce combat doit être mené sur tous les terrains, militaire, politique, diplomatique, etc. Monsengwo, par ses propos de trahison, fait comprendre à tous les Congolais patriotes que les politiciens de l’opposition néocoloniale sont effectivement une cinquième colonne de l’agression, oeuvrant de concert avec les Américains, les Rwandais, les Ougandais et les rebelles.
Cinquième thèse de Monsengwo : « Le moment est favorable, car la mort de Monsieur Kabila rend la guerre des Grands Lacs sans objet, puisque la guerre a été déclenchée pour chasser Mr Kabila du pouvoir ». (1.8.)
Monsengwo se félicite presque ouvertement de l’assassinat de Kabila, affirmant que la guerre « déclenchée pour chasser Kabila » est maintenant sans objet ! En réalité, la guerre a été déclenchée par les Américains pour chasser tous les nationalistes congolais du pouvoir. Et si Joseph Kabila continue la politique lumumbiste du maintien de l’indépendance et de la souveraineté du Congo, les dirigeants américains, qui ont déjà plus de 3.000.000 morts sur leur conscience, peuvent décider la continuation de l’agression.
Monsengwo fait semblant de croire que seul Kabila « gênait » les impérialistes. Or, l’homme de confiance des Américains sait très bien que ses patrons craignent surtout le peuple congolais conscient de sa dignité et mobilisé dans le combat pour l’indépendance. L’assassinat de Kabila n’a pas abattu ce peuple, au contraire, les trois millions de Kinois qui sont descendus dans la rue pour rendre hommage au Président martyre, ont prouvé que le peuple congolais est désormais debout. Ce peuple semble dire : non monseigneur, Kabila assassiné, la guerre de résistance ne devient pas « sans objet » parce que toute la population a exprimé sa détermination à poursuivre l’œuvre du Héros national et à bouter dehors les agresseurs pour assurer au Congo son indépendance, sa souveraineté et sa dignité.
Monsengwo, l’homme du coup d’état anti-nationaliste ?
Sixième thèse : « Le Dialogue inter-congolais doit, sur base d’un consensus, mettre en place le Président, le gouvernement de large union nationale et le Parlement de transition ». (1.9.) « Les autorités interimaires – le président Joseph Kabila et son gouvernement - ne peuvent recevoir leur légitimation que du Dialogue inter-congolais ». (Point 1.12) « Elles doivent donc, avec l’aide de Masire, mettre sur pied un présidium provisoire pour préparer ce Dialogue ». (Point 1.12.2.)
Monsengwo avoue que le « Dialogue inter-congolais », tel que les puissances impérialistes veulent l’imposer aux Congolais, est bel et bien un coup d’état parlementaire qui mettra fin à la légalité et la légitimité du pouvoir nationaliste issu de la révolution du 17 mai 1997. Le soi-disant « présidium du Dialogue inter-congolais » est l’organe du coup d’état néocolonial : dès l’ouverture du « Dialogue », ce « Présidium » remplacera en réalité le Président Joseph Kabila, son gouvernement de salut public et l’Assemblée Législative et Constituante.
Le Président Laurent-Désiré Kabila et son gouvernement avaient été reconnus en mai 1997 par tous les pays au monde. Même les puissances impérialistes ont félicité Kabila pour avoir annoncé des élections dans un délai de deux ans ! Simpson, l’ambassadeur américain, disait trois semaines avant l’agression américano-rwando-ougandaise : “Le président Kabila est sur la bonne voie, politiquement parlant”. “Il s’en tient, en général, au calendrier fixé en vue de la démocratisation du pays. Il y a eu des régressions, mais rien d’important. En fin de compte, c’est à l’urne que seront jugés M. Kabila et son gouvernement.” En clair, les jours précédents l’agression, Kabila était toujours sur la bonne voie, suivait son calendrier de démocratisation et se voyait féliciter pour sa décision d’organiser bientôt des élections. Puis venait une agression barbare dénoncée par l’ONU… et cette agression aurait privé le gouvernement nationaliste de son droit de reprendre la voie de la démocratisation et d’organiser des élections, une fois les agresseurs boutés dehors ! C’est une logique de gangsters rarement vue dans l’histoire.
Si, pour Monsengwo, le gouvernement nationaliste n’a plus le droit de gouverner en toute indépendance le Congo, c’est que le pays est déjà sous la tutelle d’une autre force : c’est la troïka impérialiste qui décidera désormais quelle est l’autorité supérieure au Congo.
Les nationalistes congolais ré-affirmeront haut et fort que le Congo a un gouvernement légal et légitime qui dirige la résistance à l’agression. Ce gouvernement peut, de son propre initiative, organiser un Dialogue inter-congolais. Après le retrait des agresseurs, ce gouvernement organisera des élections libres et démocratiques.
Le Congo bientôt sous tutelle militaire de l’Occident ?
La septième thèse, la plus dangereuse, de Monsongwo: « Le Dialogue inter-congolais nécessite la présence des troupes de l’ONU au Congo pour assurer la sécurité dans le pays, pour garantir l’application des décisions du Dialogue et pour former une nouvelle armée républicaine ». (Point 1.11)
Le 13 septembre 1960, dans son dernier discours radiodiffusé, Lumumba dénoncait la menace que le Congo soit « mis sous une tutelle internationale de l’ONU». C’est exactement ce que Monsengwo et tous les politiciens néocoloniaux veulent faire aujourd'hui. Ils déclarent ouvertement qu’ils veulent la mise sous tutelle du Congo par les puissances impérialistes qui tirent les ficelles de l’ONU.
Le Congo n’est plus un pays indépendant, si l’on accepte que la sécurité dans le pays soit assurée par des troupes étrangères de l’ONU et si l’on accepte que des troupes étrangères « garantissent » l’application des décisions du « Dialogue ». Monsengwo veut aussi que les Forces Armées Congolaises soient démantelées au profit d’une « nouvelle armée » qui sera formée par l’ONU, c’est-à-dire par les Américains ! C’est exactement ce qui s’est passé après l’assassinat de Lumumba et la défaite des nationalistes en 1961 : c’est sous le drapeau de l’ONU que les puissances occidentales ont formé l’armée de Mobutu… armée qui réprimera la révolution populaire de 1964-65 et fera le coup d’Etat du 24 novembre 1965…
Mettre le Congo sous tutelle militaire de la Troïka, c’est le nœud du Plan Monsengwo. En effet, l’impérialisme estime qu’il lui faudra avoir des troupes à lui au Congo pour savoir dominer efficacement le pays.
Il faut se rappeler qu’en 1991 déjà, Tshisekedi et Monsengwo souhaitaient une mise sous tutelle militaire du Congo. C’était en septembre 1991 que les troupes françaises soutenues par 850 soldats belges sont intervenus à Kinshasa. La Libre Belgique écrit alors : « Le Zaïre appelle à l’aide et cette aide, qui sera humanitaire, doit impérativement bénéficier d’un encadrement militaire. » Au nom du gouvernement belge, le Eyskens déclara devant l'ONU: "L'intervention d'Etats tiers pour protéger les droits de l'homme n'est pas nécessairement une intervention dans les affaires intérieures, même si cette intervention se réalise contre la volonté de l'Etat concerné.".
A l’époque, j’ai écrit ceci: “L’intervention militaire de la France et de la Belgique vise à imposer leur solution à la crise zaïroise: remplacer le vieux dictateur en pleine déliquescence par des hommes plus attentifs aux besoins de l’Occident. Ainsi, La Libre Belgique a écrit: "Le gouvernement belge semble prêt à élargir le cadre de la mission (militaire) belge au Zaïre de façon à promouvoir la transition démocratique". Et le social-démocrate Coëme, ministre de la Défense, a déclaré: "Nous devons aussi protéger la population zaïroise contre des émeutes dangereuses. Si vous me demandez une date limite (pour le retrait des paras), je dirais: il doit y avoir un gouvernement démocratique stable qui est capable de relancer l'économie zaïroise sur une base solide." En ces termes, l’impérialisme belge affirme sa volonté de mettre le Congo sous une tutelle militaire pour de longues années. Jacques Brassinne, acteur important de la politique africaine en Belgique, a été le plus explicite à propos la récolonisation politique et militaire complète du Congo: "Il est absolument nécessaire qu'il y ait une présence permanente militaire européenne au Zaïre. Seule la présence de ces troupes pourra permettre un retour du secteur privé, des investisseurs étrangers et des coopérants." Tshisekedi n’a fait aucune objection contre ces projets de récolonisation militaire. Le 3 octobre 1991, il déclare: "Je demande à la France et à la Belgique de ne pas retirer leurs troupes du Zaïre, aussi longtemps que je n'ai pas les affaires en mains". Ainsi, Tshisekedi se place d’emblée dans une situation de dépendance vis-à-vis des troupes étrangères.”
Ce rappel historique nous fait mieux comprendre l’actualité.
Le 16 janvier, immédiatemment après l’attentat, Louis Michel annonçait avec beaucoup de bruit que Kabila était bel et bien mort ! Comme si son but était de créer une panique à Kinshasa, de provoquer des troubles et d’obtenir un prétexte pour une intervention militaire… Et effectivement, les paras belges se sont mis directement en route pour Libreville, prêts à foncer sur Kinshasa. “Malheureusement”, les troubles graves que les puissances impérialistes attendaient ne se sont pas produits… Au contraire, l’Angola a renforcé le dispositif sécuritaire de Kinshasa. Des responsables tant congolais qu’angolais nous ont dit: “Désormais, nous les Africains, nous nous prenons en charge nous-mêmes. Avec l’aide de ses alliés angolais, zimbabwéens et namibiens, le Congo passera ce moment dramatique et difficille. Nous ne voulons plus voir des interventions militaires européennes ou américaines chez nous.”
Il est claire que les agissements de Monsengwo procèdent du même complot qui a conduit à l’assassinat de Kabila. Kabila mort, il faut encore liquider l’ensemble de son œuvre. Sous le drapeau de l’ONU, Monsengwo et ses semblables comptent mettre le Congo sous la tutelle militaire des puissances impérialistes, démanteler les Forces Armées Congolaises et les Forces d’Autodéfense Populaire et, sous le prétexte de “fusionner” l’armée nationaliste et les soi-disant “troupes rebelles”, former une nouvelle armée néocoloniale au Congo!
LE DECES DE LUDO MARTENS:
Ludo Martens est mort plongeant dans la tristesse les nationalistes et révolutionnaires congolais !
Kinshasa, 08/06/2011
Décès du Belge Ludo Martens, un militant de la cause nationaliste et progressiste en RDC qu’il a défendu courageusement jusque dans ses derniers jours. Sa brusque disparition est ressentie comme une grande perte par les patriotes et nationalistes congolais.
La nouvelle du décès de Mr Ludo Martens, écrivain, historien et journaliste belge, le dimanche 5 mai 2011 aux petites heures du matin à Bruxelles attriste les patriotes congolais. Et pour cause ? Ce grand analyste de l'évolution du mouvement nationaliste et révolutionnaire congolais s'est toute sa vie durant investi à éclairer l'opinion tant nationale qu'internationale sur la quintessence de l'œuvre de la résistance héroïque du peuple congolais à l'ordre colonial et néocolonial.
Le communiqué officiel du Parti du Travail Belge dont il a été un de principaux fondateurs et Président pendant plusieurs mandats mentionne que cette figure de proue du mouvement progressiste international quitte la terre des hommes à l'âge de 65 ans de suite d'une longue maladie. L'illustre disparu laisse à la postérité, outre une abondante bibliographie engagée, deux enfants dont, soit dit en passant, les mères sont des africaines, burkinabé pour sa fille aînée et congolaise pour son dernier garçon.
Dans sa jeunesse, ce fils aîné d'un fabricant de meuble de la petite commune de Wingene en Flandre Occidentale montre un intérêt évident pour les langues et devient vite le rédacteur en chef du journal de son école rédigé en néerlandais « Standard ». Analyser les engagements du petit peuple, sa résistance, ses révoltes, ses défaites, ses victoires, etc. était la trame principale de ses articles.
En 1965, le jeune prodige est inscrit à la Faculté de Médecine à Louvain. Pétri de talent et pétillant d'intelligence, tout le monde voit en lui un futur médecin brillant. Mais, hélas, le sort en décidera autrement. Devenu très actif dans l'union catholique flamande des étudiants du supérieur, avec quelques amis, il a commencé à donner une impulsion progressiste et internationaliste aux visées au départ étriquées et conservatrices de ce mouvement.
Se butant alors contre l'establishment académique et la droite, Ludo Martens et son groupe d'amis seront aussitôt virés de ce mouvement et du journal « Notre vie » qu'il dirige. Ses articles que d'aucuns trouvaient gênants furent finalement pris comme prétexte pour justifier son exclusion de Louvain.
A partir de ce moment, il fit de la lutte contre le nationalisme borné et le racisme son cheval de bataille. A la faveur du bouillonnement estudiantin de mai 68, il rencontre des étudiants marxistes allemands à Berlin qui lui refilent les œuvres de Marx et de Lénine. Cela va lui permettre de réorienter sa lutte en créant un front uni Étudiant– Travailleurs pour contrer les injustices sociales.
C'est ainsi qu'après son exclusion de Louvain, Ludo Martens se rend à l'université de Gand où il trouve dans la mouvance estudiantine de cette institution académique un terrain de prédilection pour combattre la censure, pour augurer l'avènement d'une université démocratique et pour développer une solidarité active entre les étudiants et le monde du travail.
Pour traduire de façon durable et manifeste leur expression de lutte contre l'exploitation capitaliste, après avoir vécu pour la plupart l'expérience ouvrière en travaillant à l'usine après une interruption volontaire de leurs études universitaires, Ludo Martens et ses camarades décidèrent de créer un parti de classe ouvrière dénommé « Tout le pouvoir aux ouvriers » en français, TPO en sigle, « Alle macht aan de arbeiders » en néerlandais, AMADA en sigle.
En plus de ce parti, un journal à caractère national qui est devenu aujourd'hui « Le Solidaire » avait vu le jour. Concomitant avec le nouveau parti, les jeunes révolutionnaires belges d'alors lancent l'asbl Médecine pour le Peuple où, à travers des maisons médicales, les soins gratuits de première ligne sont prodigués à la population ouvrière démunie, notamment celle de Hoboken.
En 1979, dix ans plus tard donc, AMADA sera rebaptisé Parti du Travail Belge, PTB en sigle. Son ouvrage « Le parti de la révolution » explique les trente années d'expérience de la lutte pour la création de ce parti communiste ouvrier. En 1985, Ludo Martens brise la loi du silence en publiant aux éditions EPO en Belgique son livre titré « Pierre Mulele ou la seconde vie de Patrice Emery Lumumba », lequel met la lumière sur l'histoire occultée de la lutte de libération du peuple congolais à travers l'action d'un de grands épigones de Patrice Emery Lumumba : Pierre Mulele.
Dans son livre, Ludo Martens décrit avec bonheur la vie de ce révolutionnaire congolais remarquable, ancien ministre de l'Education de Patrice Emery Lumumba, dans son maquis de Kwilu–Kwango. Avant lui, rien n'avait été dit, hormis des mensonges, sur cette étape glorieuse de la résistance glorieuse du peuple congolais à l'ordre inique et néocolonial que le monde occidental avait installé au Congo après la neutralisation et l'assassinat de Lumumba.
Ludo Martens récidive quelque temps après avec « Abo, une femme du Congo », un ouvrage d'une beauté littéraire évidente qui met en exergue la bravoure de Mme Léonie Abo, la compagne de Pierre Mulele sous l’insurrection armée. En lisant ce livre enivrant, on ne peut qu'être contaminé par la sympathie de l'auteur à l'égard de cette femme du peuple qui a su, à travers la lutte de Pierre Mulele, mettre toute son énergie dans la lutte contre la dictature et l'oppression.
Plus tard, la « Nouvelle Scène Internationale » le mettra en scène avec un spectacle ponctué des percussions de Chris Jones, l'ami de l'auteur qui était, affirme-t-on, un amoureux de jazz. Il est en de même de l'Institut National des Arts de Kinshasa qui a interprété cette œuvre sous le titre « Le léopard et le clochard ». A la fin de sa lecture, Winnie Mandela avait affirmé qu'elle n'avait jamais lu un livre aussi émouvant sur la participation d'une femme dans la lutte de libération du continent noir. La chanteuse Oumou Sangara s'est inspirée de cet ouvrage pour composer dix chansons de son riche répertoire.
Au lendemain de la prise de pouvoir de Mzee Laurent Désiré Kabila en 1997, Ludo Martens l'ancien « persona non grata » du régime déchu décide de concentrer ses activités militantes à Kinshasa. D'allure simple et austère, Ludo Martens était pourtant un homme ouvert à tous les contacts, notamment avec le peuple d'en bas. Tout président du PTB qu'il était, il avait choisi de vivre dix ans durant dans le dénuement des quartiers populaires de Kinshasa, parfois sans électricité, à Matonge et ses environs, n'hésitant pas à aller tenir des conférences ou organiser des séminaires à Masina ou à Camp Luka.
En fait, ses contacts avec les étudiants latino-américains à l'université avaient déjà préparé le jeune révolutionnaire belge à intérioriser pleinement la lutte de Che Guevara et l'expérience de Mao Zedong contre le colonialisme et l'impérialisme. Et depuis, la solidarité internationale qui s'est traduite notamment par son adhésion à la défense de la cause vietnamienne ou de celle des noirs aux États-Unis est une des caractéristiques permanentes de sa personnalité plurielle.
Dès 1968 déjà, il avait compris que les progressistes occidentaux avaient le devoir de soutenir le combat du peuple congolais pour le sortir du joug de la dictature mobutiste, nouvelle forme de l'oppression capitaliste. Pour Ludo Martens, en étouffant l'émergence de la conscience nationaliste et révolutionnaire au Congo, le colonialisme a permis à Mobutu de créer un establishment d'apparatchiks corrompus et véreux prêts, pour garder leurs privilèges et leurs prébendes, à brader les richesses de leur pays aux puissances étrangères.
Ludo Martens s'engage alors à soutenir ceux des Congolais qui voulaient sortir leur patrie de cette domination impérialiste néfaste, en leur redonnant confiance en eux-mêmes, en les aidant à regarder désormais avec fierté leur passé ainsi que leur histoire à dessein tronqués par les occidentaux. Il leur rappelait également, à travers ses articles, ses prestations radiotélévisées sous forme d'interviews ou de débats, ses publications, ses interventions publiques ou privées, ses analyses, ses conférences et ses séminaires de formation ainsi que les organisations et regroupements qu'il avait tant soit peu réussi à mettre sur pied, l'œuvre immense des hérauts de la lutte contre l'oppression et l'exploitation du peuple congolais, notamment Patrice Emery Lumumba, Pierre Mulele et Mzee Laurent Désiré Kabila.
Ludo Martens exhortait les Congolais auxquels il s’adressait d'être les continuateurs des œuvres de leurs héros à travers leurs engagements politiques, leur unité et leur solidarité. Son séjour en RDC lui a en outre permis de peaufiner et de publier un gros livre titré « Kabila et la Révolution congolaise », lequel donne une analyse autorisée des péripéties de la lutte de ce grand révolutionnaire congolais qui parvint dans des conditions exceptionnelles à bouter dehors le régime de Mobutu, un régime qui s’incrusta trente-deux ans durant dans un Congo aux richesses incommensurables en le reléguant dans le concert des pays les plus pauvres de la planète.
Malheureusement voilà que pris de court par la maladie, Ludo Martens n'a pas pu achever la rédaction du second tome de ce livre riche en enseignements…
Ce qui est vrai, c’est que du travail de Ludo Martens est née une graine révolutionnaire et nationaliste à jamais implantée dans la conscience révolutionnaire et nationaliste des populations congolaises. Et cette graine deviendra un jour le gros baobab qui, en concrétisant les pensées des précurseurs de la lutte contre l'oppression et l'exploitation de la RDC dans toutes ses formes, conduira le grand Congo et son vaillant peuple vers le chemin de son développement.
Correspondance de Jean-Paul ILOPI Bokanga/MMC
L'ENFANCE D'UN CHEF PAR SIFA MAHANYA: ELUCIDONS LE MYSTERE D'UNE IDENTITE!
Entretien avec Maman Sifa à Kinshasa
par Colette Braeckman, publié dans Le Soir du vendredi 2 juin 2006
Madame Sifa Maanya n'est pas une femme publique. Discrète, pudique mais pas effacée, elle évite les journalistes, sauf lorsqu'il est question de ses activités sociales au sein de la Fondation Mzee Laurent-Désiré Kabila. Exceptionnellement, peut-être parce qu'elle savait que nous avions rencontré le Mzee (le « Vieux » en swahili, surnom donné au défunt président congolais) lorsqu'il voyageait en Europe dans la plus grande discrétion, elle a accepté un entretien, qui s'est déroulé dans son vaste bureau de la Gombe. Peu de meubles, pas de tableaux ni de tapis, pas de signes extérieurs de richesse. Avant d'entamer la conversation, Madame Sifa nous invite à prier et demande à Dieu de nous bénir.
D'emblée, cette femme originaire de Kabambare au Maniéma, vient à l'essentiel : « aux côtés de Mzee, j'étais une militante. Ensemble nous voulions combattre l'injustice, lutter contre Mobutu qui avait confisqué le pouvoir. »
Dès l'assassinat de Lumumba, en 1961, Laurent Désiré Kabila se lance dans la lutte et en 1965 qu'il créée un maquis à l'Est : « Nous avons commencé dans la région de Fizi où nous avions installé notre état-major. Mais nous avons souvent dû nous déplacer dans les montagnes, fuyant les attaques de l'armée de Mobutu. Il y a eu Hewa Bora 1, Hewa Bora 2, Makanga... C'est à Kasingere que nous avons fondé le Parti de la révolution populaire. » Madame Sifa ne veut pas qualifier de difficile la vie dans le maquis : « Nous nous suffisions à nous mêmes et vivions dans une parfaite égalité. Grâce à l'agriculture, nous avions assez à manger, nous vivions aussi des produits de la pêche, de l'élevage. Nous manquions souvent de sel et d'huile et nous préférions recourir aux remèdes traditionnels. Mais notre population, sensibilisée, ne se plaignait pas. »
Déjà militante, Sifa devient cadre du Parti où elle s'occupe de la formation politique, en particulier des femmes. « Nous expliquions aux gens pourquoi il fallait combattre cette dictature qui écrasait les paysans. Nous pratiquions l'éducation permanente, chacun devait suivre des cours de formation politique, mais aussi apprendre à lire et écrire. Les sessions politiques proprement dites duraient sept jours, puis ceux qui avaient été formés étaient envoyés dans d'autres villages pour enseigner à leur tour. »
Il n'y avait pas d'électricité dans le maquis, mais pas de bougies et d'allumettes non plus : « pour faire du feu, nous devions frotter des pierres pour faire jaillir l'étincelle... » Les vêtements aussi étaient rares : Sifa avait un seul pagne, peut-être deux, mais la plupart du temps, les gens portaient des vêtements faits de raphia et d'écorces.
C'est dans ce maquis égalitaire mais très pauvre que sont nés, en 1971, ses premiers enfants, les jumeaux, Jaynet et Joseph. Virent ensuite d'autres naissances, Joséphine, Zoé, Masengo... « Notre famille s'est constituée dans le maquis et les enfants, dès l'âge de 3 ans, fréquentaient l'école que nous avions créée. Ils étudièrent dans le maquis durant cinq ans. »
Après 1975, tout le monde fut forcé d'aller vivre à Wimbi, au bord du lac Tanganyka, car les attaques des troupes de Mobutu étaient incessantes, « ils nous bombardaient, nous pourchassaient dans les montagnes, nous ne pouvions plus résister. A certains moments, nous avons même été forcés de manger de l'herbe, des plantes sauvages ».
A Wimbi, Sifa poursuit ses activités : « j'étais secrétaire adjointe de l'organisation des femmes révolutionnaires du Congo, une branche du PRP qui s'occupait de l'encadrement des femmes. Beaucoup d'enfants étaient sans famille, à cause de la guerre ou des maladies et c'est pour eux que le Mzee a créé le centre populaire pour les oeuvres sociales dont je fus la gérante principale. Mais nous avons été rapidement dispersés par les forces de Mobutu. »
Vers les années 78-79, le Mzee décide de faire évacuer les jumeaux vers Kigoma en Tanzanie, pour qu'ils poursuivent les études. La maman suivra quelque temps plus tard et le Mzee viendra ensuite, avec quelques rares partisans «il faut dire que nombreux étaient ceux qui avaient trahi et quitté le maquis car Mobutu les avait corrompus, soudoyés. Les derniers qui étaient restés subissaient les bombes, les embuscades, tout était mis en oeuvre pour les capturer...»
En Tanzanie, la famille Kabila est accueillie, protégée, par Kazadi Nyembe, bien introduit auprès du président Nyerere. Sifa insiste avec reconnaissance : « Kazadi nous a protégés, cachés, car la police de Mobutu nous recherchait pour nous éliminer. Si la vie dans le maquis pouvait paraître difficile, en Tanzanie, c'était bien pire. Là, nous n'avions rien, alors que dans le maquis on s'entraidait, on vivait dans une certaine égalité. Notre séjour en Tanzanie était pour nous un repli stratégique, car nous avions bien l'intention de revenir un jour dans notre pays, le Congo. »
C'est pour cela d'ailleurs que, malgré les difficultés financières, Laurent-Désiré avait tenu à inscrire Jaynet et Joseph à l'école française de Dar es Salaam, afin qu'ils apprennent le français pour le jour où ils rentreraient dans leur pays.
Comment la famille subvenait-elle à ses besoins ? Madame Sifa ouvre ses mains et les regarde, pensive : « je cultivais un petit champ et je vendais mes légumes au marché, comme toutes les femmes pauvres en Afrique. Plus tard, j'ai tenu une petite échoppe, pour pouvoir payer les études des enfants. Le Mzee ne s'entretenait pas de politique avec sa famille. Cette éducation-là, c'est moi qui m'en chargeais. J'expliquais pourquoi nous refusions de nous considérer comme des réfugiés, car nous étions des révolutionnaires. » En Tanzanie, l'ambassade du Zaïre ne lésine pas sur les moyens : « Mobutu a tout essayé pour nous éliminer : le poison, les femmes, les embuscades, l'argent... »
Mme Sifa dément les histoires selon lesquelles le Mzee aurait multiplié les voyages: « il n'a quitté le maquis que deux fois, pour demander de l'aide aux amis en Europe, car nous manquions de tout... » Et elle se souvient du soutien qui fut apporté par Pierre Galand, alors secrétaire général d'Oxfam-Belgique.
A propos de la Tanzanie, Sifa évoque les réactions de fierté de son mari : « A un moment donné il a dit « stop » et décidé de refuser l'aide proposée... Il déclarait que désormais nous allions nous prendre en charge... »
C'est à ce moment qu'elle a commencé à cultiver et à vendre sa petite production. « Le Mzee n'était intéressé que par la politique. C'est moi qui entretenais la famille avec mon travail... »
Après avoir terminé les études secondaires à Dar es Salaam et fait, comme tout le monde en Tanzanie, une année de service militaire, les jumeaux sont envoyés à l'Université de Makerere en Ouganda. Leur sécurité n'est pas assurée et les services de Mobutu rodent toujours. Jaynet s'inscrit en journalisme, Joseph en droit.
La maman se souvient des dispositions de son fils : « tout petit, il avait déjà un tempérament de chef, il rêvait d'être militaire, de diriger une armée. » En souriant, elle évoque le gamin qui alignait des petites voitures pour en faire un convoi militaire, tout en précisant que le père refusait que son fils se lance dans la carrière des armes.
Joseph seconde bientôt son père qui dresse des plans pour reprendre la lutte au Congo. : « les préparatifs avaient commencé, au début des années 90, pour s'intensifier en 1994 et en 1995. Joseph était aux côtés de son père lorsque les opérations ont commencé en 1996. Nous avions réfléchi et tiré les leçons des erreurs commises au début de la lutte. On n'est pas allé chercher Mzee, il était là : c'est depuis la mort de Lumumba que nous combattions la dictature...»
Le 17 mai 97, Sifa se trouve encore en Tanzanie avec les plus jeunes des enfants, lorsque les troupes rebelles entrent dans Kinshasa. C'est un mois plus tard qu'elle arrive discrètement dans la capitale :« le Mzee ne voulait pas que l'on évoque sa vie privée... » Elle confirme que lors de la première guerre, en 96-97, Joseph se trouvait aux côtés de James Kabarebe, le général rwandais qui dirigeait les opérations militaires.
Joseph tenait-il son père informé ? « Je le suppose, mais je sais que le Mzee avait été très fâché d'apprendre les atrocités, les massacres commis par ses alliés : nous, notre lutte ce n'était pas ça, notre conception de la libération, ce n'était pas la vengeance... »
Quelles valeurs, avec son mari, a-t-elle enseigné à ses enfants ? Ici Maman Sifa parle d'une traite : « nous leur avons appris l'amour de la patrie, le respect de la famille. Essayé de leur donner un code de bonne conduite, et aussi des leçons de modestie, d'humilité. De leur apprendre à vivre en paix avec leur prochain. Nous avons essayé de façonner nos enfants afin qu'ils combattent l'injustice. »(...) « Joseph, à sa manière et avec ses méthodes, a tenté de poursuivre l'oeuvre de son père. Il a toujours eu une grande force de caractère, il réfléchit avant d'agir et n'a jamais été un enfant turbulent... Calme, il ne parlait pas beaucoup, s'il était fâché, il ne le montrait pas. Je lui ai enseigné comment être poli, jamais insolent : c'est cela notre culture... »
Sifa, mère et épouse, exhale cependant quelque amertume : « Ah ! les Congolais... Quand je pense que le Mzee leur a sacrifié sa vie, et qu'ils l'ont tué... Chaque fois que je repense à sa mort, mon coeur redevient rouge... »
Elle ne nie pas la souffrance qu'elle éprouve au vu de la campagne qui vise Joseph : « il est mon enfant, au même titre que sa soeur Jaynet et les autres. Or lui, on le qualifie de « Rwandais ». Tout cela est douloureux, mais tout ce que je peux dire, c'est qu'il est bien mon fils... Comment peuvent-ils dire que je suis venue du Rwanda, alors que j'ai vécu avec le Mzee pendant 32 ans ? » Maman Sifa refuse d'évoquer les menaces qui pèsent sur son fils, « il est entre les mains du Seigneur. Je prie Dieu de le protéger, de le laisser accomplir son destin... »
LES ORIGINES DE JOSEPH KABILA KABANGE:IDENTITE DOUTEUSE OU REVELÉE?.
Journal spécial sur les origines du Chef de l’Etat, Joseph Kabila Kabange
En guise de réponse à tous ses détracteurs de la trempe de Honoré Ngbanda Zambo Ko Atumba et sa clique
Kinshasa le 15 septembre 2006
Joseph Kabila Kabange : Congolais cent pour cent
Fils de Laurent Désiré Kabila et de Sifa Mahanya
AZA MWANA CONGO
A FULA A TALA TE
1. Douze compagnons et amis de Mzee et autres confirment :
« Joseph Kabila est le fils aîné de Laurent Désiré Kabila. »
Et apprenez comment Mzee lui-même a parlé de son fils Joseph !
Lukole Yedibuse Madoa Doa
Le général Joseph Mwati
Bumba Ramazani
Dorothea Lokole
Onorate Zabibu, Présidente de l’Organisation des Femmes Révolutionnaires Congolaises
Feu Général-major Sylvestre Lwetscha
Didier Kazadi Nyembwe
Un collaborateur du Président Nyerere
Dieudonné Kassongo, le frère de Mzee Kabila, parle de Joseph Kabila Kabange
L’Union des Katangais pour le Développement « U.K.D. » en sigle
L’archevêque Etsou présente ses excuses au Président Kabila Kabange
Zoé Kabila… comme une doublure de Joseph
Voka Makenda
Le Général James Kabarebe, (Chef d’Etat Major Général des Forces Patriotiques Rwandaises) parle des origines de Joseph Kabila
Mzee Laurent Désiré Kabila lui-même parle de son fils Joseph Kabila
2 . « Joseph Kabila est un Rwandais »…
Le mensonge est la dernière arme politique de Ngbanda le Terminator
Voici une photo truquée, publiée sous le titre : « Joseph Kabila était un garde de corps de Kagame ! »
Ngbanda le Terminator fait parler un homme MORT depuis 2 ans : Eric Lenge…
EXTRAITS de la lettre écrite par NGBANDA et attribuée à Eric LENGE
Ngbanda « engage » un fasciste belge pour combattre le Président Joseph Kabila !
3. Plus congolais et patriote que Joseph Kabila ça n’existe pas.
L’expérience de trois générations de Kabila’s
M’MOLELWA Justin : « A 19 ans, Joseph Kabila était déjà pleinement associé aux activités révolutionnaires de son père »
Joseph Kabila et la défense de Kinshasa en août 1998
4. Le discours-programme du 26 janvier 2001 : le serment de Joseph Kabila pour l’indépendance, la paix et la réunification
Le 16 janvier 2001, le grand patriote et révolutionnaire le Président Mzee Laurent Désiré Kabila est assassiné au Palais de Marbre.
Fidélité à l’héritage de Mzee
Nouvelle situation, nouvelle tactique. Nouveau Chef, nouvelle méthode.
Soutien décidé aux compatriotes qui subissent l’occupation rwandaises
5. Joseph Kabila, l’artisan de l’inclusivité et de la transition non conflictuelle
Joseph Kabila défenseur de la souveraineté nationale
Joseph Kabila défenseur de l’inclusivité
A Sun City, Joseph se bat toujours pour l’inclusivité
Joseph Kabila pour un Président et un Premier ministre.
Joseph Kabila a même accepte d’être réduit à un chef de composante…
Joseph Kabila tient mordicus aux élections
6. Le tournant décisif de la guerre. La résistance militaire et populaire à l’occupation de Bukavu en février - juin 2004
Le RCD fait une déclaration qui annonce une Troisième guerre
Le "Mémo" des séparatistes rwandophones du Kivu
Joseph Kabila : « La population de l’Est a l’endurance digne de la Résistance. »
Joseph Kabila : « Nous ramènerons la guerre d'où elle est venue : au Rwanda ! »
7. La crise de Kanyabanonga et l’échec total de l’occupation génocidaire rwandaise au Congo
2002 : Le RCD éclate. C’est le début de la fin…
L’armée nationale récupère le Nord Kivu, longtemps occupé par Kagame
Des fractions du RCD rejoignent le camp de la Patrie, le front Rwanda-Ouganda éclate.
La MONUC dénonce les agressions rwandaises
Parlement Européen : dénonciation catégorique de l’agression rwandaise
1. Douze compagnons et amis de Mzee Laurent Désiré Kabila et autres confirment : « Joseph Kabila est le fils aîné de Laurent Désiré Kabila. »
Et apprenez comment Mzee lui-même a parlé de son fils Joseph !
Joseph Kabila et Selemani Kanambe ont vécu ensemble à Dar Es-salaam. Lorsque la mère de Selemani est décédée, Mzee Laurent Désiré Kabila a adopté Selemani Kanambe chez lui. Ce qui a fait que Selemani et Joseph ont évolué ensemble chez Mzee L. D. Kabila.
Ceux qui disent que l’Excellence J. Kabila est rwandais, ne sont rien d’autre que ses ennemis. Selemani Kanambe avait son père, Kanambe Adrien, et Joseph Kabila avait son père, Laurent Désiré Kabila.
Kabila est un congolais balubakat. Et Kanambe est rwandais. Et la mère de Joseph, c’est maman Sifa, congolaise aussi.
La mère de Selemani Kanambe est une mubembe, Musimwenda Christine.
Le général Joseph Mwati
Je suis arrivé à Hewa Bora en 1974, et on m’a présenté M. Adrien Kanambe à qui j’ai dit que j’étais Murega. Lui me dira que sa mère était aussi Murega, mais son père lui, était Rwandais.
Kanambe Adrien est le père de Selemani Kanambe.
Lorsque je suis arrivé à Hewa Bora, Selemani Kanambe n’était pas encore né, et son père n'avait pas encore épousé, ce n’est qu’une année plus tard que Kanambe Adrien se mariera avec Christine, la mère de Selemani Kanambe.
Celle-ci souffrait de la jambe et devait aller se faire soigner en Tanzanie. En traversant, elle s’est noyée lorsque la pirogue a chaviré. Lorsque la mère est décédée, son enfant Selemani Kanambe est resté seul, sans personne pour veiller sur lui, puisque son père était tout le temps en mission. Alors, Mzee Kabila a préféré adopter l’enfant Selemani dans sa famille, à côté de ses propres enfants, Joseph et sa sœur Jaynet.
Puis le père Kanambe Adrien a trouvé la mort lors de la guerre de Moba en 1985.
Joseph et Selemani ne sont pas de la même famille. Selemani est le fils de Adrien Kanambe, qui est un rwandophone et un combattant. Sa mère Christine Musimwenda, était Mubembe.
Joseph est le fils de Mzee Kabila et sa mère est maman Sifa. Ce sont deux personnes tout à fait différentes.
Le camarade Général MWATI Joseph, qui avait une formation d’assistant médicale, supervisait un groupe de guérisseurs traditionnels. Il témoigne : « Les jumeaux, Joseph et Jaynet Kabila, sont les enfants de L.D. Kabila, nés à Hewa Bora. Leur accouchement a été fait par la sage-femme Mbeke-Mbeke qui était plus tard sous mes ordres. Ma propre épouse, Jeanne Balolwa, directrice du cycle maternel de l’institut Safi Maman Ndjenje, a été leur première préceptrice.
Comme tous les enfants du maquis, Joseph Kabila et Jaynet Kabila étaient membres de l’organisation des Pionniers. Ils avaient des armes en bois pour jouer. Je me rappelle comment le petit Joseph Kabila courait, son arme en bois à la main, se positionnant pour une "embuscade"… Ils apprenaient ainsi l'amour de la Patrie et l'amour de l'Armée du peuple.
Mzee Kabila ne tolérait pas le favoritisme, il ne fallait pas venir avec "ma famille", "mon clan », "ma tribu", ces mots l’écœuraient beaucoup. Kabila disait : notre famille, ce sont les révolutionnaires. Notre fraternité, c'est avec les ouvriers et les paysans, avec les révolutionnaires. »
« Mzee Kabila nous a aussi appris que, devant les pires difficultés, il faut tout faire pour trouver une solution. Chacun était armé de cette conviction. C'est Kabila qui a inculqué cet esprit. Ainsi, au maquis, j'ai pu sauver trois femmes enceintes grâce à cet esprit. Il s'agissait de femmes dont le bébé était mort dans leur ventre. J'avais appris pendant ma formation à sortir le petit cadavre du ventre en écrasant la tête avec des pinces. Au maquis, il n'y avait pas de pinces. J'ai pensé que je pouvais réussir l'opération à l'aide de fourchettes. C'est ainsi que j'ai sauvé trois vies.
Un jour, Kabila est venu me voir, il avait des lipomes, une ciste graisseuse. Il m'a dit que je devais l'opérer. Mais nous avions seulement une lame à raser et il n'y avait pas d'anesthésie. Je ne voulais pas faire l'intervention. Mais Kabila m'a donné un ordre militaire. J'avais peur, je me suis dit : Quand je vais inciser, il va crier et les ennemis vont l'entendre. J'ai enlevé la ciste avec la lame de rasoir sans anesthésie. Kabila n'a pas poussé un cri. »
Bumba Ramazani
Je peux témoigner de la naissance de Joseph Kabila, comme du mariage de sa mère, Sifa, qui était l’amie intime de ma femme. Ma femme allait tout le temps chez son amie Sifa et chez Laurent Kabila. En 1971, ma femme mit au monde un garçon, et peu après, maman Sifa mit aussi au monde, c’était des jumeaux, une fille Jaynet et un garçon, Joseph.

Maman Syfa entourée de ses enfants.
Photo faite en Tanzanie au début des années 80. On remarquera le fils adoptif Selmani Kanambe au n° 6 et le fils naturel Jospeh Kabla au n° 7.
De gauche à droite: 1. Umaneo Josephine Kabila 2. Cecile Mafika Kabila 3.Zoe Kabila 4. Maman Sifa Mahanya 5. Fifi Kabila 6. Selemani Kanambe 7. Joseph Kabila Kabange 8. Jaynet Kabila Kyungu 9. Anina 10. Tetia
Dorothea Lokole
Selemani Kanambe, le fils de Kanambe Adrien, est né à Wimbi Dira. Mais Joseph était déjà né et il est passé en Tanzanie en 1978. La maman de Selemani, est morte quand elle traversait le lac pour Kigoma pour se faire soigner.
Nous venions de la Tanzanie. C’est ainsi qu’on ramènera Selemani entre mes mains.
C’était moi qui avais reçu l’enfant au beach, après l’accident sur la rivière. L’enfant était chez moi avant d’aller à Dar Es Salam.
En ce temps, son père était parti en mission à Moba, de ce fait, on décida de l’amener chez Mzee Kabila à Dar Es Salam. Je suis allé le déposer de Udjidji à Dar Es Salam.
Mais je suis étonné qu’on puisse confondre Joseph et Selemani, puisque Joseph est plus âgé que Selemani Kanambe.
Onorate Zabibu, Présidente de l’Organisation des Femmes Révolutionnaires Congolaises
Témoignage.
« Au maquis de Hewa Bora il y avait six organisations. La principale, qui dirigeait toutes les autres, était le Parti de la Révolution Populaire. Le Parti dirigeait cinq organisations de masse: 1. l’Armée de libération ; 2. l’Union des Travailleurs ; 3. l’Organisation des Femmes Révolutionnaires Congolaises ; 4. La Jeunesse du PRP et 5. les Pionniers.
Début juin 1971, quand nous avons appris que le président Kabila avait des jumeaux, il y a eu des fêtes partout, dans l’organisation de la jeunesse, dans l’organisation des femmes…
On chantait, on dansait, on mangeait et buvait. On buvait le « bondo », le vin de palme. Ce gros palmier nous donnait aussi le raphia. Dans les périodes difficiles, quand nous n’avions plus de vêtements, nous portions alors des pièces de raphia.
C’est la plus grande fête qui a été organisée au maquis de Hewa Bora. Elle exprimait l’attachement de tous les combattants au chef de notre révolution, à sa femme et à ses jumeaux…
Notre organisation des femmes encadrait les pionniers. Jaynet et Joseph étaient chez les pionniers. Nous avions une commission militaire. Elle était chargée de protéger les enfants et de les encadrer quand il fallait fuir devant les militaires.
Feu Général-major Sylvestre Lwetscha

Le groupe de personnes que vous voyez ici, ce sont des hommes sérieux, et les dames que voici, ce sont elles qui ont élevé Joseph Kabila. Ce ne sont pas des gens ramassés au hasard. Et les chefs que vous voyez ici sont ceux qui ont vu naître Joseph.
Ceux qui disent que Joseph et sa sœur sont rwandais, sont simplement des semeurs de désordre.
Moi-même, je suis de ceux qui ont vu naître Joseph et je dis la vérité, je dis que Joseph est congolais et que son père, c’est Kabila Laurent qui vient de mourir, et sa mère, c’est Sifa Mahanya, originaire de Kabambare, district de Kassongo dans la province de Maniema.
Tous ces gens qui ont parlé, leur témoignage est vrai, nous ne pouvons pas mentir.
Ce que les autres racontent est faux! Ce sont des jaloux et il y a quelque chose qu’ils cherchent.
C’est moi qui confirme ceci. Les dames que vous voyez sont celles qui ont élevé Joseph Kabila, c’est leur enfant ! Elles viennent de témoigner qu’elles étaient parties prendre Joseph qui était encore tout petit, et elles ont vécu beaucoup de choses !
Si vous voulez, Kambimbi peut venir témoigner, Théophile Kalimbi peut témoigner aussi.
Nous vous confirmons juste que Joseph est Congolais!
Et que Selemani Kanambe est une autre personne. Il a juste grandi chez Mzee L.D.Kabila, il n’est pas congolais. Le président a préféré l’adopter à côté de ses enfants. Et même les faire étudier ensemble. Telle était la façon d’être de Mzee L.D.Kabila, nous le connaissions comme ça, sans discrimination.
Sifa était une jeune fille quand elle est arrivée au maquis. Les jumeaux Jaynet et Joseph étaient ses premiers enfants.
A Dar Es Salaam, les deux enfants étaient très réservés. Les parents les avaient mis au courant des dangers qu’ils couraient : Mobutu pouvait organiser leur kidnapping en Tanzanie pour faire du chantage sur Mzee et l’obliger à capituler….
Les deux enfants allaient de l’école directement à la maison. Parfois je les cherchais à l’école pour les amener chez moi. C’est aussi pour des raisons de sécurité que les deux enfants ont été écartés à un certain moment de la capitale et envoyés à l’intérieur. Ils étaient en internat vers la frontière avec la Zambie.
Jaynet et Joseph ont fréquenté pendant un temps l’école française parce que Mzee tenait à leur retour au Congo. D’autres enfants de Mzee et Sifa, comme Cécile et Fifi, ne connaissaient pas le français.
Un collaborateur du Président Nyerere
Nous avons rencontré un responsable des services de sécurité de la Tanzanie du temps de Nyerere. Il assume toujours des responsabilités.
Il a été en charge de la famille Kabila pendant 13 ans. Il nous a donné son témoignage sur le séjour de Laurent et Joseph Kabila dans son pays.
« Une certaine opposition au Congo affirme que Joseph Kabila n’est pas Congolais. Ce genre d’allégations est bien connu en Afrique.
Julius Nyerere a été le Président de notre pays pendant de longues années. Puis, en 1985, il y a eu ce qu’on appelait ‘les premières élections multipartites’. Est-ce que vous savez que, tout à coup, des personnages ont clamé que Nyerere n’était pas un tanzanien authentique, mais un Burundais ?
De même en Ouganda, il y a eu des allégations que Yoweri Museveni était un Rwandais… Le Président Kaunda de la Zambie a également eu des adversaires qui le combattaient en affirmant qu’il n’était pas d’origine zambienne… De Mobutu, certains de ses opposants ont dit qu’il n’était pas Zaïrois, mais Centrafricain…
C’est moi qui ai géré Laurent Kabila et sa famille pendant 13 années. J’ai toujours connu Joseph et Jaynet comme le fils et la fille de Mzee Kabila. Et puis, lors du mariage du Président Joseph Kabila, avez-vous regardé son frère Zoé ? Il est né de longues années après Joseph. Mais il a exactement la même figure que son frère aîné. Il marche exactement de la même façon que le Président Joseph Kabila. Qui peut nier qu’ils ont le même père et la même mère ?

Surn la photo à droite : Joseph Kabila Kabange à Dar Es Salaam en 1987.
A lépoque, j’ai été envoyé par le Président Nyerere au Congo pour visiter le maquis de Hewa Bora.
Laurent Kabila avait dit à Nyerere qu’il dirigeait une zone libérée au Congo.
Mais beaucoup de Congolais ont prétendu diriger des territoires libérés. Ils menaient une vie agréable dans les hôtels de Dar Es Salaam… C’est tout ce qu’ils cherchaient.
Ainsi, nous étions une délégation de trois à nous rendre au maquis de Hewa Bora.
Avec un bateau rapide, cela nous prenait 45 minutes pour arriver de Kigoma sur la rive congolaise du Lac. Tard le soir nous avons pris un petit sentier et nous sommes arrives la même nuit sur le plateau.
Nous avons séjourné pendant toute une semaine à Hewa Bora. Nous avons visité la base principale. Nous y avons trouvé des hommes et des femmes très motivées. Nous avons rencontré des commissaires politiques, des femmes, des combattants, des hauts responsables. Nous avons assisté à un cours de formation donné à une trentaine de combattants.
Nous sommes arrives à la conclusion que les affirmations de Laurent Kabila étaient exactes, qu’il contrôlait effectivement une partie du territoire congolais. Nous en avons fait rapport à Monsieur le Président Nyerere. Il a accepté notre rapport.
C’est pour cette raison que Laurent Kabila ne vivait pas en Tanzanie comme réfugié. Il avait un statut spécial en tant que combattant de la libération. En conséquence, notre système de sécurité prenait soin de lui et lui donnait protection.
Le Président Nyerere a donné deux passeports à Kabila, l’un au nom de Christopher Mlindwa Denge et un autre au nom de Francis Mutwale. Kabila les utilisait pour voyager en Angola, en Ouganda et en Europe.
Mzee Kabila menait une vie pas différente des autres. Il était à l’aise, il ne se montrait jamais arrogant. Joseph Kabila vivait en Tanzanie comme un citoyen ordinaire. Il avait le même style de vie que les jeunes Tanzaniens. Comme tout le monde, il a fait son Service national. Il n’était pas traité comme réfugié, donc il avait le droit de faire le service militaire. En Tanzanie, Joseph parlait le Swahili et l’anglais comme tous les étudiants tanzaniens.
Dieudonné Kassongo, le frère de Mzee, parle de Joseph Kabila Kabange
Dieudonné Kassongo, né en 1950, est le frère cadet de Laurent Désiré Kabila.
Après la mort de ce dernier, il est devenu le chef de la grande famille Kabila.
Leur père était Taratibu Kabila Désiré, né en 1900. En 1930 il est arrivé à Ankoro.
Dieudonné Kassongo témoigne : « En 1950, Ankoro est devenu un territoire. Nous vivions là chez nous. En 1959, nous y avons construit une maison.
En 1964, j’avais 13 ans et je me trouvais à Kalemie.
En 1969, j’ai fini mes études secondaires au collège Saint Boniface à Kalemie.
Laurent s’était marié à Kashala Albertine. Ils ont eu un enfant, Jeanne Mafika.
Mais Kashala est morte dans un accident.
En 1970, Laurent et Sifa Mahanya se sont mariés selon la coutume au maquis de Hewa Bora.
A cette époque, je faisais la navette entre Hewa Bora et la Tanzanie, sur ordre du Parti.
J’ai vu naître Jaynet et Joseph à Hewa Bora. A cette occasion, il y a eu la plus grande fête que le maquis a connue… Avoir comme premiers enfants des jumeaux était une grande chance pour cette femme. Des salves ont été tirées à l’occasion de cette naissance.
Pour des raisons de sécurité, Mzee avait trois maisons en bois, couvertes de paille.
D’autres enfants de Laurent Kabila et de Sifa Mahanya son nés au maquis : Joséphine - Cécile - Mapenzi Josée Tumaleo Aimée, Zoé…

Maman Syfa Mahanya a épousé Mzee Laurent Désiré Kabila en 1970 à Hewa Bora
Chez les Balubakat, c’est-à-dire les Baluba du Katanga, règne le patriarcat : les enfants appartiennent à la famille du père.
Si une fille est enceinte, elle devra dire qui est le père. On va chercher qui est le père, même s’il est mort. Il faut savoir qui est son père. Ce sont nos traditions.
Jadis, si vous ne connaissez pas votre père, vous deveniez esclave. On vous appelle « batumbula », on vous prend comme esclave.
Donc, chez les Balubakat, il est difficile de vous marier, si vous ne connaissez pas votre père. Vous êtes sans valeur, comme l’enfant d’une femme libre. Un enfant-esclave ne pouvait pas hériter le pouvoir d’un chef.
Si tu ne connais pas le père de la fille, tu ne peux pas la marier.
Quand Joseph s’est marié, l’ambassadeur Théodore Mugalu est allé à Tshela pour rencontrer la famille.
Chez les Balubakat, un enfant adopté n’a ni droit au chapitre, ni droit à l’héritage. Il reste un étranger…
Comment moi, le petit frère direct de Laurent Kabila, pourrais-je ignorer qui est le père de Joseph Kabila Kabange ? Chez nous c’est impossible qu’un père ne reconnaisse pas son fils ! Et qui d’autre que Laurent Kabila, n'a jamais revendiqué être le père de Joseph ? Personne ! »
L’Union des Katangais pour le développement « U.K.D. » en sigle témoigne :
Un grand nombre d’associations et de personnalités du Katanga ont protesté avec force contre les mensonges que Honoré Ngbanda Zambo Ko Atumba, mensonges selon lesquels Joseph Kabila Kabange est Rwandais, qu’il fut même garde de corps de Kagame…
Ngbanda a publié en 2006 une lettre « récente » de Eric Lenge. Or, Lenge a été abattu le 13 juin 2004, au moment même où il a fait son coup d’état monté et manqué.
La fausse lettre de Eric Lenge a été écrite intégralement par Ngbanda.
Le chef des services secrets de Mobutu y affirme entre autre ceci : « Joseph Kabila veut dissoudre le corps de Mzee Kabila dans de l’acide, ainsi il ne sera plus possible de prouver que Joseph n’est pas le fils de Mzee. » Ce mensonge nauséabond n’est pas sorti du cerveau d’Eric Lenge, mort depuis deux ans. Ce mensonge infâme est sorti de la tête diabolique de Honoré Ngbanda Zambo Ko Atumba.
Nous citons pour l’exemple une des nombreuses déclarations publiées par des personnalités et associations katangaises. Il s’agit de celle faite fin juillet 2006 par l’Union des Katangais pour le Développement « U.K.D. » : « Trop c’est trop ! »
« Le Président de la République Joseph Kabila Kabange est bel et bien Congolais à 100 %. Il est bien le fils de M’Zee Laurent Désiré Kabila et de maman Sifa Mahanya.
M’Zee Laurent-Désiré Kabila et son fils Joseph Kabila Kabange étant originaires de la Province du Katanga, nous nous sommes sentis blessés et insultés par tous les mensonges dont le chef de l’Etat est victime.
C’est à tord que des gens disent : « D’où Joseph Kabila a-t-il tiré le nom de Kabange ? »
En République Démocratique du Congo, si chez les Bakongo, les jumeaux s’appellent Tsimba et Nzuzi. Chez les Baluba du Kasaï : Mbuyi et Kanku, chez les Bangala : Mboyo et Boketshu, au Bandundu : Mbo et Mpia, par contre au Katanga chez les Balubakat les jumeaux s’appellent Kyungu et Kabange. C’est ainsi que la sœur jumelle du Président s’appelle Jeanette Kabila Kyungu, et le Président s’appelle Joseph KABILA Kabange. Chez les Balubakat, Kyungu est l’enfant jumeau qui sort le premier, tandis que Kabange est celui qui vient immédiatement après l’autre. En outre, dans une famille où les filles sont nées avant un garçon est et demeure le fils aîné quelque soit sa position biologique. Même si il est cadet, il reste et demeure chef de famille et donc fils aîné. Chez les Balubakat on l’appelle « Mwana Bute »patriarcat oblige. Cependant, ces noms de Kyungu et Kabange sont sacrées chez les Balubakat, on ne peut pas les donnés à des enfants adoptés. Pour prouver à l’opinion nationale et internationale que Joseph Kabila Kabange n’est pas le fils adopté de Mzee Laurent Désiré Kabila, les Balubakat à travers leurs chefs coutumiers ont investi Joseph Kabila Kabange Grand chef coutumier de tous els Balubakat au mois de juillet 2006 à Kamina-Kinkunki fief de l’empire Lubakat.
Honoré Ngbanda a déclaré un jour : « M’Zee Laurent Désiré Kabila n’a jamais été appelé Tata Mapasa (Père Double) ».
Moi qui ai travaillé avec M’Zee Kabila, j’affirme que les intimes de M’Zee Kabila, le Président Dos Santos, le Président Robert Mugabe, le Président Sam Nuyoma et même la propre grande sœur de M’Zee Kabila, maman Kibawa, voir aussi Monsieur Kabwe Séverin ancien administrateur Général en chef de l’Agence Nationale de Renseignements « A.N.R. » l’appelaient "Père Double" – Tata Mapasa. »
Signé : Jimmy David Kakima K.M. Munkana Ngando, Président de l’Union des Katangais pour le Développement.
L’archevêque Etsou présente ses excuses au Président Kabila Kabange
A un certain moment, l’archevêque Etsou avait été influencé par le déluge d’affirmations qui disaient que Joseph Kabila était un Rwandais. Il a eu alors sa phrase malheureuse sur « les étrangers qui dirigent le pays. » Honoré Ngbanda et sa clique avaient jubilés.
Les autorités les plus hautes de l’Eglise catholique se sont penchés sur la question et ont conclu que Joseph est bel et bien le fils de Laurent et de Sifa Mahanya…
Lors du mariage religieux du Chef de l’Etat, devant plus d’un millier de présents et devant des centaines de milliers de téléspectateurs, le cardinal Etsou s’est publiquement excusé.
Il s’est excusé pour toutes les humiliations inutiles qu’on a fait subir au Président Joseph Kabila Kabange.
Dans la lettre écrite par Ngbanda et attribuée à ERic Lenge, on lit aussi : « Joseph Kabila est un musulman comme son défunt père adoptif. » Le chef des services secrets de Mobutu tenta ainsi de dresser les chrétiens congolais contre leurs frères et sœurs musulmans… Le mariage religieux du chef de l’Etat a été célébré par le cardinal Etsou et par monseigneur Pierre Marini Bodo président de l’église du Christ au Congo « E.C.C. » parce que Olive Lembe di-Sita épouse de Joseph Kabila est catholique, le Président est protestant…

L'Archevèque Etsou a marié Joseph Kabila Kabange et Olive Lembe di-Sita
Zoé Kabila… comme une doublure de Joseph.
Le mercredi 12 juillet 2006, Zoé Kabila a donné une preuve frappante et, nous dirions : vivante, que Joseph Kabila est bel et bien le fils aîné de Mzee Kabila, une preuve qui a convaincu même les plus sceptiques…
Ce jour, Zoé Kabila a rendu une visite-surprise au Grand Marché de Kinshasa.
Il s’est informé des difficultés rencontrées par les vendeurs. Et il voulait profiter de l’occasion pour faire campagne en faveur de la candidature de son grand-frère Joseph.
Mais, malheureusement, il n’a pas pu le faire, pour une raison simple : il a été pris par toute la population qui se trouvait au Grand Marché, pour le chef de l’Etat lui-même!
En effet, en voyant Zoë, beaucoup de vendeurs et d’acheteurs croyaient à une visite du chef de l’Etat Joseph Kabila Kabange ! De partout, des chants se sont élevés : « Motu bolukaka ye oyo, Joseph aye ».
Lorsque la foule a appris que ce n’était pas le chef de l’Etat, mais son jeune frère, elle n’a pas été déçue. Au contraire, presque tout le monde a fait la même réflexion pertinente : « Si Joseph Kabila n’est pas le fils de son père, par quel miracle ressemble-t-il à la perfection à un fils « non contesté » de Mzee Laurent Désiré Kabila, né plusieurs années après Joseph. ? Par son visage, par la constitution de son corps, par sa démarche, Zoé semble une doublure parfaite de son grand frère Joseph…C’est clair que Joseph et Zoé ont la même mère et le même père… ».

Zoé Kabila… comme une doublure de Joseph.
Témoignage.
« En 1972, je travaillais au ministère des Affaires étrangères, que dirigeait Nguz-a-Karl-I-Bond. J’étais conseiller chargé des affaires politiques et diplomatiques.
Un jour, je feuilletais dans les dossiers de l’année 1971.
A un moment, mes yeux ont été frappés par un message « Top secret ».
Il venait de la Tanzanie et il avait comme entête : « Message Prési-Zaïre / répéter CND / répéter Minafet »
Le message, très bref, disait : « Le dérangeur a fait des jumeaux" .
Le dérangeur était le nom utilisé pour indiquer Laurent Kabila… »
Mobutu était donc immédiatement informé de la naissance de Jaynet et Joseph… »
Le Général James Kabarebe (Chef d’Etat Major Général des Forces Patriotiques Rwandaises) parle des origines de Joseph Kabila.
« Avant la création de l’A.F.D.L (Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération), notamment au mois d’août 1996 à Kigali, je fus appelé d’urgence au Quartier Général de l’Armée Patriotique Rwandaise sur ordre du Président Paul Kagame, alors Vice-président de la République et Ministre de la Défense Nationale.
A mon arrivée au Q.G., on me présenta un papa costaud, accompagné d’un jeune homme. C’est fut Laurent Désiré Kabila alors Président du Parti de la Révolution Populaire (P.R.P.). Je lui présentais mes respects et à son tour, il me sera la main en me présentant le jeune homme qui était à ses cotés en disant : « C’est mon fils, il s’appelle Joseph Kabila. » Je répondais : « Enchanté ». C’était devant témoins. Il y avait le Président Paul Kagame, et Déogratias Bugera… puis le Président Paul Kagame m’a présenté officiellement auprès de Laurent Désiré Kagame et son fils Joseph Kabila. C’était donc la première fois que j’ai vu Laurent Désiré Kabila et Joseph Kabila. Bref, il n’y a pas de doute, Joseph Kabila n’est pas Rwandais, comme je l’entends par-ci, par-là. Joseph Kabila est le fils de Laurent Désiré Kabila. Si Joseph Kabila était Rwandais, il serait rentré avec nous le 2 août 1998, lorsque son père Laurent Désiré Kabila a rompu avec nous. Alors, de grâce, ne nous mettez pas dans la bouche ce que nous n’avons jamais dit, ni déclaré ni reconnu. »
Mzee Laurent Désiré Kabila lui-même parle de son fils Joseph Kabila
Extrait d’une émission de la RTB-F de fin novembre 1997 avec la participation de, e.a. Colette Braeckman et Marie-France Gros.
 Lorsque Mzee était encore en vie, qui aurait osé prétendre que Joseph n’était pas son fils ?
Lorsque Mzee était encore en vie, qui aurait osé prétendre que Joseph n’était pas son fils ?
Dans une interview que quatre journalistes belges ont réalisée avec Mzee pour la télévision belge, Marie-France Cros s’est efforcée de « coincer » le Président.
Mais elle n’a pas dit ou même insinué, que Joseph n’était pas son fils !
Cette « question » n’existait simplement pas, aussi longtemps que Mzee était en vie…
Par contre, Mzee lui-même a parlé dans cette émission sur son fils Joseph qui a dirigé la prise de Kisangani…
Voici des extraits de l’enregistrement.
« Marie-France Cros : Monsieur le Président, le massacre qui a eu lieu à Mbandaka était très récent, c’est la raison pour laquelle la commission d’enquête voulait se diriger vers cette région. Par Ailleurs le front Nord de l’armée de libération dirigé par vous-même, était très précisément à l’époque des massacres dirigés par votre fils.
Est-ce que cela a joué un rôle dans le fait que votre gouvernement a refusé l’enquête.
Mzee Kabila : Mon fils a dirigé le front Nord pour la libération de la ville de Kisangani. … Mais ce n’était pas pour aller massacrer, il n’y avait pas de Hutus dans la ville de Kisangani qu’on a voulu massacrer.
Marie-France Cros : Mais les gens qui étaient là pour nourrir les réfugiés qui arrivaient de l’Est, disent qu’il y a eu des massacres, qu’on a attaqué les camps de réfugiés.
Mzee Kabila : Par qui ? Pas par les troupes congolaises. Ce n’est que lorsque les réfugies s’étaient dispersés dans les brousses et se sont dirigés vers les sections contrôlées par les forces rwandaises, que les massacres ont commencé. A l’ombre de toute attention des forces congolaises. »
2 . Le mensonge est la dernière arme politique
de Ngbanda le Terminator
Voici une photo truquée, publiée sous le titre : « Joseph Kabila était un garde de corps de Kagame ! » Premier mensonge de Ngbanda.

Mobutu, Lors d'un meeting populaire à Kinkole, parlant de son Ministre de l'Agriculture qui avait détourné dit :"Bayibaka Muke, yo oyibi nyonso" "Yiba ndambo tika ndambo" "Voler un peu, laissez un peu".
Mobutu, un jour face à face avec des journalistes étrangers, dit à un de ses collaborateurs : « Buka bango lokuta » - « Il faut leur mentir ».
Ngbanda et ses fidèles ont toujours observé cette consigne…
La photo que vous venez de voir, est un truquage, une photo falsifiée. Le falsificateur JB Labika est très actif pour le groupe Banacongo Belgique. Ce groupe opère en alliance avec l’Apareco de Ngbanda.
Les menteurs de chez Nbganda affirment que cette photo date de 1995. C’est impossible. A ce moment, Kagame apparaissait toujours en public en uniforme militaire de l’APR !
Ce n’est qu’à partir de 1998 qu’il a été vu en costume.
Toute personne qui regarde attentivement cette soi-disant « photo authentique de la presse militaire rwandaise » découvre vite qu’il s’agit d’une photo truquée !!!
Voici la photo originale, qui était disponible depuis longtemps pour tout le monde, sur internet.

http://jv.wikipedia.org/wiki/Paul_Kagame
1. D’abord, regardons la lumière de la photo truquée. Sur le visage de Kagame, elle vient de droite. Pour le garde de corps, elle vient de gauche et de front. Est-ce qu’il y avait deux soleils dans le même ciel ?
2. Sur la vraie photo , la joue gauche du garde de corps est dans l’ombre, sur la photo truquée, la droite du visage est bien illuminé.
3. Sur la photo originale, il y a une large bande d’ombre au-dessous de la barrette du garde de corps. Sur la photo truquée de « Kabila », il n’y a aucune ombre en dessous de la barrette.
4. Sur la vraie photo, le garde de corps de Kagame a les yeux baissés. Sur la photo truquée, « Kabila » regarde droit devant lui.
5. Sur la vraie photo, le vrai garde de corps de Kagame, qui s'appelle lieutenant Fred, porte sa montre à la main gauche. Or Joseph Kabila porte toujours sa montre à la main droite. C'est qui prouve que cette photo est fausse et falsifiée. En effet, si c'était Joseph Kabila sa montre serait sur la main droite.
La conclusion est claire : le groupe de Ngbanda a falsifié la photo de Kagame et son garde de corps, en collant le visage de Joseph Kabila sur le corps du garde de corps de Kagame…
Les Congolais se rappellent les crimes que Ngbanda-le-Terminator a commis contre la population qui aspirait à la libération.
Le mensonge « Joseph Kabila Rwandais » est la seule arme qui reste aux mobutistes endurcis. En effet, leur véritable programme est le retour à la dictature néocoloniale qui a sévi sous Mobutu. Et ce programme, ils n’osent pas le proclamer publiquement…

A Victoire, au centre de Kinshasa, la photo falsifiée de « Joseph Kabila garde de corps de Kagame », avait connu un succès de vente jamais vu. Beaucoup d’acheteurs étaient convaincus de connaître maintenant la « vérité » : Joseph Kabila était un Rwandais, garde de corps de Kagame…
Mais lorsque la falsification a été démontrée, cette photo et la fausse "Lettre d'Eric Lenge", écrite par Ngbanda, ont brusquement disparues du marché... Tous ceux qui ont été victimes de cette falsification ont compris : des anciens criminels comme Ngbanda n’ont plus que les mensonges comme dernières armes...
Ngbanda le Terminator fait parler un homme MORT depuis 2 ans : Eric Lenge…
Via les canaux de l’Apareco, Ngbanda diffuse massivement un document intitulé « Eric Lenge parle ». Ce document, faussement attribué à Lenge, a été écrit du premier au dernier mot par l’ancien chef des services secrets de Mobutu, Honoré Ngbanda.
Luther Bisongo a bien connu Eric Lenge. Il témoigne : « Lenge avait des difficultés à écrire. Plusieurs fois, j’ai moi-même dû écrire des lettres qu’il voulait adresser à une personne. »
Or, la lettre attribuée à Lenge est écrite dans un français impeccable et elle comprend de longues phrases bien tournées, que Lenge était absolument incapable de produire. Pour Luther, cette lettre est indiscutablement un faux.
Cette lettre écrite par Ngbanda et attribuée à Lenge est particulièrement dégoûtante pour une raison très simple : Eric Lenge est mort depuis longtemps, depuis les jours de son coup d’état manqué.
En effet, après la première tentative de coup d’Etat, le vendredi 11 juin 2004, la bande de Lenge a pris la fuite dans le Bas Congo et elle a tenté de passer en Angola. Mais à la frontière, ils ont subi des tirs nourris et ils sont retournés vers Kasangulu.
La P.I.R. a réussi à arrêter huit compagnons de Lenge, groupe dirigé par l’adjudant Kyungu Lokese. La PIR a saisi une quantité importante d’armes lourdes et légères.
Selon les témoignages des pêcheurs opérant le long du fleuve Congo, Lenge, entouré d’éléments fortement armés, est arrivé à un poste de pêche, vers 15 heures, à bord d’une jeep Land Cruiser. Il s’est dirigé vers un poste de garde tenu par un adjudant de la Force navale, assis dans son hors-bord. Lenge sollicita les services du marin pour traverser le fleuve. Le militaire refusa. C’est alors que Lenge a été abattu à bout portant par l’adjudant Bukasa de la Force navale. Lenge tenta ensuite sans succès de mettre en marche le hors-bord.
Lenge a trouvé finalement un petit bateau rapide. Il a abattu deux militaires pour s’en emparer.
Il tenta de fuir, mais il a été abattu à bout portant par les militaires qui le poursuivaient.
Des témoins directs qui travaillent actuellement à la Présidence, nous ont confirmé que c’est bien ainsi que Lenge est arrivé à sa fin, le 13 juin 2004.
Ngbanda ose utiliser le nom d’un homme qui est mort depuis plus de deux ans pour donner « crédit » à son intoxication mille fois répétée : « Kabila Rwandais ! ». C’est tout ce qu’il a dans sa bouche jour et nuit.
Qui peut encore avoir la moindre confiance en Ngbanda, un individu qui était longtemps l’homme clé des services secrets de Mobutu, l’homme des sales coups, et qui utilise maintenant un homme mort pour donner une crédibilité à son mensonge mille fois répété.
Mentir et mentir encore est décidément la religion de celui qui aime se faire appeler « le Frère Honoré » et « l’Evangéliste Honoré Ngbanda… »
Cette fois le « Terminator » a exagéré et même les Congolais qui lui accordaient encore un peu de crédit, se détourneront de lui avec dégoût.
EXTRAITS de la lettre écrite par NGBANDA et attribuée à Eric LENGE
1er Extrait.
Je suis le Major Eric Lenge de la GSSP, ancien garde de corps de Joseph Kabila. Je suis en exile suite au deuxième faux coups d’état du 11 juin 2004 dont je réserve des révélations au Procureur Luis Moreno Campo de la Cour Pénale Internationale. J’ai décidé de me constituer prisonnier en qualité d’exécutant des crimes politiques et crimes de guerres commis sous les ordres de Joseph Kabila, et en tant que témoin à charge.
Réfutation.
Nous savons maintenant de façon indiscutable, de la bouche de ceux qui l’ont abattu le13 juin 2004, que Lenge est mort depuis deux ans. Lenge aurait écrit qu’il veut se constituer prisonnier et qu’il va faire des révélations au procureur de la Cour Pénale internationale. Mais qu’est-ce qu’il attend ?
En fait, le Terminator est pris au piège de ses propres mensonges.
Un mort ne vient pas témoigner. »
2e Extrait.
« Vous avez appris dans les médias le mariage de mon ancien patron avec mademoiselle Olive Lembe Disika pour ce 04 juin 2006. … C’est un mariage à visée électoraliste. Joseph Kabila pense qu’il pourra ainsi faire taire tous ceux qui pensent que lui et sa jumelle sont d’origine Rwandaise.
J’avais écrit au Cardinal Etsou afin de le dissuader de célébrer ce mariage qui est un vrai piège tendu par l’imposteur Joseph Kabila pour mettre le Cardinal Etsou en contradiction avec ces dernières déclarations concernant les étrangers qui dirigent notre pays. »
Réfutation.
Lenge a été abattu le 13 juin 2004. Deux ans plus tard il aurait écrit une lettre où il affirme avoir appris que Joseph Kabila va se marier avec son ancienne copine Olive Lembe di-Sita. En réalité, l’auteur de cette lettre est Nbganda. Mais le super-flic de Mobutu a mal fait son travail : il montrequ’il ne connaît même pas le nom de sa soi-disant « ancienne copine » ! La femme du Président s’appelle Olive Lembe di-Sita, et pas : Disika
3e Extrait.
« Je me demande toujours pourquoi Joseph Kabila avait fait commander par mes soins 100 litres d’acide sulfurique et 100 litres d’acide chlorhydrique une semaine avant le dernier faux coups d’Etat? Je pense que ce monsieur a l’intention de faire disparaître le corps de Laurent Désiré Kabila en le faisant dissoudre dans cette grande quantité d’acide, effaçant la possibilité de démontrer que lui et sa jumelle ne sont absolument pas les enfants biologiques de L D Kabila… »
Réfutation
Dans cette phrase du super-flic de Mobutu, éclate toute la haine de cet individu pour les combattants nationalistes que sont Laurent-Désiré Kabila et Joseph Kabange Kabila… Eric Lenge est mort depuis 2004. Deux ans plus tard, Ngbanda écrit une lettre qu’il attribue, en véritable escroc et faussaire, au cadavre de Lenge. Le cerveau détraqué de Ngbanda a produit cette ignominie qu’il attribue à Eric Lenge : Joseph Kabila a commandé 100 litres d’acide sulfurique et 100 litres d’acide chlorhydrique pour dissoudre le cadavre de son propre père !
Le Président Joseph Kabila ne doit pas être le seul président au monde contre qui n’importe quel faussaire peut cracher les mensonges les plus révoltants.
Il y a des tribunaux en France et en Belgique qui respectent les règles de la démocratie et qui peuvent être saisis de ces insanités de Ngbanda! Feu Mzee Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila Kabange et feu Eric Lenge étant tous des katangais et de surcroît Balubakat, L'Union des Katangais pour le Développement "U.K.D." s"est dit prête à traduire Honoré Ngbanda en justice pour faux et usage des faux en écriture, diffamation, calomnie, faux bruit...
Ngbanda « engage » un fasciste belge pour combattre le Président Joseph Kabila !
Honoré Ngbanda Nzambo Ko Atumba a écrit une lettre au Premier ministre belge Verhofstadt.
Ngbanda y affirme que des « des voies officielles s’élèvent parmi les personnalités politiques belges pour dénoncer … un complot contre le peuple congolais. » Et Ngbanda de citer monsieur Patrick Cocriamont, un élément fasciste qui est entré via des combines au parlement belge…
Ce Cocriamont, élu en octobre 1994 au conseil communal d’Anderlecht, a fait le salut hitlérien lors de sa prestation de serment !

L’homme de Ngbanda, le néo-fasciste Cocriamont, faisant le salut hitlérien au conseil communal d’Anderlecht
Rappelons que le parti fasciste de Hitler a été le principal instigateur de la seconde guerre mondiale qui a fait 50.000.000 de morts, dont 25 millions dans la seule Union Soviétique !
Et Ngbanda ose s’afficher publiquement à côté d’un individu aussi lugubre…
Cocriammont a déclaré : … « Monsieur Joseph Kabila est connu par nos services de renseignements comme un sujet d’origine rwandaise ». Ngbanda ajoute, pour impressionner les gens naïfs, que « Cocriamont a accès aux archives de l’Etat belge ».
En réalité, Cocriamont n’a accès à aucune « archive secrète» où il serait question de la « nationalité rwandaise » du Président Kabila. Comme les archives dont parle le néo-fasciste Cokriamont sont du domaine public, il est évident que si une « révélation » aussi sensationnelle s’y trouvait, elle aurait été publiée depuis longtemps… Une fois de plus, nous avons à faire avec de l’intoxication signée par Ngbanda-le-Terminator.
Les Congolais doivent savoir que les fascistes et néo-fascistes sont les pires ennemis de l’Afrique.
Cocriamont, l’allié de Ngbanda, a osé écrire ceci : « Je confirme mon point de vue concernant le bien fait de la colonisation belge, …le fait que Lumumba était un bandit, Kasavubu un incompétent, … Laurent Désiré Kabila et Joseph Kabila deux dictateurs sanguinaires. … Il est facile de sortir un nègre de la jungle, mais il est très difficile de sortir la jungle qu’il y a dans sa tête. … Mon parti souhaite que les conditions sociales des Congolais s’améliorent en R.D.C. afin que les 25 à 30.000 Congolais vivant en Belgique puissent retourner dans leur pays. La Belgique ne peut pas indéfiniment supporter toute la misère de Congo. »
Les nazis et néo-fascistes ont toujours été des racistes de la pire espèce. Ils veulent une Europe « racialement pure » où il n’y a pas de place pour des Noirs, ni pour des Chinois, ni pour des Arabes…
Les 25.000 Congolais qui vivent et travaillent en Belgique, contribuent, par leur travail sous-payé, à la richesse de la Belgique. La droite et l’extrême droite belge, appuyés par les Cocriamont’s, veulent chasser ces Congolais de la Belgique… Pour cette salle besogne, ils inventent un « bon » argument : bientôt les conditions s’améliorent au Congo, et nous pourrons chasser de la Belgique, tous ces « nègres» dont nous n’avons jamais voulu….
Ngbanda, qui faisait jadis de la démagogie sur « l’authenticité zaïroise », est tombé si bas qu’il doit avoir recours aujourd’hui à un fasciste et raciste anti-noir…
Ngbanda n’a plus aucun avenir.
Qu’il se retire en paix là où il peut trouver l’âme de son cher ami Eric Lenge…
3. Plus congolais et patriote que Joseph Kabila ça n’existe pas.
L’expérience de trois générations de Kabila’s
Le Président lui-même a dit un jour : « Plus congolais que moi, ça n’existe pas. Plus patriote, non plus ! » Et cette phrase résume en effet l’expérience de trois générations de Kabila’s…
Né en 1900, Taratibu Kabila Désiré, le grand-père de Joseph Kabila, a été un homme remarquable.
Il est entré en 1927 à la Poste d'Elisabethville comme commis. En 1952, il était commis principal de deuxième classe, le degré le plus élevé qu'un Noir pouvait atteindre à la poste et dans l’administration. Faisant aussi du commerce, il a atteint un standard de vie très élevé pour un Congolais.
Lors de la création du Secteur Kamalondo, chef-lieu Ankoro, Taratibu est devenu le premier chef de secteur. Ayant compris l'importance décisive de l'instruction dans le monde moderne, Taratibu donnait à ses enfants une éducation sur le modèle des Blancs.
A la maison, il les habituait à parler le français. Le jeune Laurent Kabila était un lecteur assidu qui fréquentait les bibliothèques publiques. Jeune, il y lisait les meilleurs auteurs français.
Laurent est aussi devenu président de plusieurs Associations Sportives de jeunes et il montrait déjà ses talents de dirigeant. Selon un témoin, "le jeune Kabila n'acceptait pas la défaite, il était tenace et déterminé et il avait un ascendant sur nous tous".
Monsieur Rosy était gouverneur du Katanga en 1958. Sendwe lui a demandé en 1958 : "Monsieur Rosy, ne voudriez-vous pas mettre au bloc cette jeune crapule de Kabila ? C'est un agitateur, il ameute les jeunes de la Balubakat !" Pour se faire remarquer dans la colonie comme agitateur politique à 17 ans, Laurent devait être exceptionnel !
Lors de la lutte pour l’indépendance et contre la sécession katangaise, l'administration coloniale est remplacée par des "Sénats", des comités formés par des nationalistes.
L'opération décisive des nationalistes au Nord Katanga est la prise de Kabalo, réalisée début octobre 1960, par trois colonnes de la Jeunesse de Kamalondo, une colonne étant dirigée par Laurent Kabila, appelé "général d'Ankoro".
Laurent Kabila a 19 ans !
Joseph Kabila est né le 4 juin 1971 dans le maquis de Hewa Bora dans une famille révolutionnaire.
Son père a été, à côté de Pierre Mulele, le deuxième responsable de la révolution populaire de 1964, révolution qui fut noyé dans le sang par des interventions de l’armée belge et américaine, appuyées par des mercenaires.
Son père Laurent Kabila a eu en 1965 l’honneur extra-ordinaire de recevoir le grand révolutionnaire Che Guevara, venu soutenir la lutte de libération au Congo. La mère de Joseph Kabila était une jeune militante de Kabambare au Maniema qui avait rejoint le maquis de Hewa Bora.
Les Congolais qui répètent les mensonges de Ngbanda : « Joseph Kabila Rwandais », ne se rendent pas compte qu’ils se couvrent de ridicule.
Joseph Kabila peut, plus facilement que n’importe quel autre Congolais, prouver qu’il est congolais à 100 % et nous l’avons démontré dans ce document.
Laurent Kabila dirigeait en 1970 le maquis de Hewa Bora et il y a marié Sifa, une jeune militante mubangu bangu de Kabambare. Elle n’avait pas encore mis au monde.
Toute la communauté révolutionnaire de Hewa Bora connaissait leur union.
Tous les militants et cadres du PRP avaient le plus haut respect pour leur chef. En plus, pour des raisons de sécurité, Laurent et sa femme vivaient un peu à l’écart des autres combattants. Quel maquisard aurait pu faire un enfant à la jeune épouse du chef ?
Tous les maquisards ont vu les deux bébés de Laurent et Sifa à leur naissance. Dans toutes les organisations du maquis, il y a eu une fête à cette occasion. Tous les partisans et partisannes ont vu grandir Jaynet et Joseph, puis s’engager chez les Pionniers.
Fort de l’héritage de son grand-père Taratibu et de son père Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, né à Hewa Bora, le berceau de la révolution congolaise, a donc raison de clamer haut et fort : « Plus congolais que moi, et plus patriote, ça n’existe pas ! »
M’MOLELWA Justin : « A 19 ans, Joseph Kabila était déjà pleinement associé aux activités révolutionnaires de son père »
Justin M’Molelwa a participé à toutes les entreprises révolutionnaires de Laurent Kabila de 1968 à Hewa Bora jusqu’à la guerre de libération de 1996-97.
Les ennemis de la révolution congolaise prétendent que les Rwandais sont aller « chercher » Kabila en 1995 pour le mettre à la tête d’une entreprise manipulée par Kagame.
Le témoignage de Justin M’Molelwa montre que Laurent Kabila n’a jamais été « cherché » par qui que ce soit : il a été constamment aux cœur de la lutte politique et armée au Congo et cela de 1964 jusqu’au triomphe de la guerre de libération le 17 mai 1997…
A chaque étape, c’est Laurent Kabila qui a cherché des alliés et qui les a convaincus de rallier le combat qu’il dirigeait. Laurent Kabila a une place unique dans l’histoire révolutionnaire du Congo.
Justin M’Molelwa témoigne : « En 1964, Adrien Kanambe, était déjà dans la révolution muleliste dirigée à l’Est par Laurent Kabila. Kanambe luttait dans un groupe dirigé par Kalukula, un Murega.
Après la révolution de 1964-65, Lwetscha est resté au maquis. Des combattants de Kisangani, de Kabambare et de Ngandji, près de Fizi, l’ont rejoint. C’est Lwetscha qui a uni tous ces groupes. Il était le principal chef sur le terrain quand Laurent Kabila a créé le PRP en 1967.
Kalukula ne voulait pas l’unité. Il y a eu une guerre avec son groupe. Nous avons fait des prisonniers de guerre et beaucoup se sont ralliés à Mzee, et notamment Kanambe. C’était un homme courageux et discipliné et convaincu que la ligne indiquée par Mzee était correcte.
Adrien Kanambe a été un grand révolutionnaire congolais, depuis 1964 il est resté fidèle au combat révolutionnaire de Mzee jusqu’à sa mort au front de Moba II en 1984… Mais avant sa mort il avait assisté au mariage de Laurent Désiré Kabila et de Sifa Mahanya ainsi qu'à la naissance des jumeaux Jospeh et Jaynet Kabila.
Après l’échec de la révolution de 1964-65, des combattants se sont retirés sur le plateau de l’Itombe. Chaque groupe avait « son » chef ! Nous nous sommes dit : nous sommes des combattants, des militaires, il faut un seul commandant ! En 1966, nous avons élu Lwetscha comme notre chef.
Plus tard, à Hewa Bora, le commandant Kilenda Saleh a rejoint le PRP avec 56 armes. Il est devenu le premier chef d’état-major, c’était au village Kitoga.
Vieux Kabila était en Ouganda et il connaissait le président Obote qui a donné son accord pour que les révolutionnaires congolais ouvrent un front dans le Ruwenzori.
A ce moment, Museveni combattait déjà le régime d’Obote vers Lwezo, en Ouganda.
A Kanyampala Kasese, un des nôtre a été responsable pour la fuite d’information et l’état-major d’Obote était au courant…Et Obote a rompu avec Kabila…
Kabila a alors dit à ses hommes qu’ils retournent à Kampala. Beaucoup se sont dirigés ensuite vers l’ancienne base de Wimbi Dira.
Justin M’Molelwa : « En 1981, j’étais à Ruwenzori, à Kanyampala Kasese. Il y avait aussi Simon Maboko et Jean Mugimba du PRP.
En 1984, j’étais à nouveau à Ruwenzori, toujours à Kanyampala Kasese, avec Katuta Oscar, qui était de ce coin. Mais nous subissions beaucoup d’attaques et ce garçon a quitté.
A cette époque, Mzee faisait la navette entre Kampala et Das Es Salaam.
De 1984 à 1995, je vivais en Ouganda. Joseph Kabila Kabange s’y trouvait déjà. La police de Mobutu avait traqué Mzee et sa famille en Tanzanie. Joseph a terminé l’école secondaire en Ouganda, comme sa sœur Jaynet.
Laurent Kabila permettait que Joseph, des l’age de 13 ans, reste dans la maison, lorsque les cadres du PRP venaient discuter. Joseph écoutait les discussions que nous avions. C’est le cadre familial qui l’a très tôt poussé à s’intéresser à la politique révolutionnaire. »
En Ouganda, Selemani Kanambe vivait chez Mzee, tout comme les enfants du combattant Jean Mugimba qui avait été tué. Après la mort de Oscar Katuta, ses enfants ont aussi été pris en charge par Mzee. Des membres du PRP comme Kambale Barnabé et Salomon Kasereka du Nord Kivu et Philippe Banyaye étaient avec Mzee en Ouganda. »
Fin 1986, Kabila, accompagné de Justin M’Molelwa, a relancé le maquis dans la région de Ruwenzori. Ngbanda protesta en 1987 auprès de Museveni contre les opérations militaires lancées contre le Zaïre à partir de Ruwenzori.
En août – septembre 1988, des membres du PRP, dirigés par M’Molelwa et Katuta, ont gagné la zone contrôlée par le Parti de la Libération du Congo (PRL) de Marandura.
Jusqu’en 1988, une centaine de combattants du PRP ont maintenu le maquis de Wimbi Dira.
A 19 ans, Joseph Kabila est associé aux préparatifs de la Guerre de libération...
A partir de 1990, Joseph Kabila avait des réunions avec des combattants qui visitaient la Tanzanie. Il était déjà associé à tout le travail révolutionnaire de Mzee. Quand des combattants de Wimbi passaient à Dar Es Salaam, Joseph organisait leur séjour et mettait une voiture à leur disposition.
En 1991, Mzee Kabila a fait une tentative pour implanter des combattants PRP dans la zone frontalière Zaïre-Zambie. Il y a recruté des jeunes dans région Kasenga, au sud du Lac Moëro. Les cadres PRP ont rencontré, Laurent Kabila et son fils Joseph qui avait juste 20 ans à Kashikishi, en Zambie. Sikatenda et Bondho Pascal se sont dirigés alors vers Kilwa-Pweto et y ont recruté un grand nombre de jeunes.
Justin M’Molelwa : « En 1992 également, j’étais à Ruwenzori. Mzee nous visitait de temps en temps, parfois accompagné de son fils Joseph.
Kissasse Ngandu opérait là-bas dès 1990-92. Mzee Kabila lui a envoyé Sikatenda pour prendre contact en vue de coordonner les actions. Kissasse Ngandu a remis 12 armes pour Kabila. »
Il y a eu une réunion importante à Dar Es Salaam en 1995 du 17 au 24 août. Mzee y était, Joseph aussi, Lwetscha, Sikatenda, Katota Oscar, Kanefu Gervais et M’Molelwa Justin. On y préparait déjà ce qui va devenir l’AFDL… L’objectif était de monter une opération pour prendre Uvira.
Laurent Kabila et Joseph, accompagnés de M’Molelwa, étaient à Kigali 11 novembre 1995. Dan Munyoza était responsable pour leur séjour. Le projet d’une opération congolaise pour éliminer le régime dictatorial et anti-africain de Mobutu, appuyé par des régimes de la région qui ont souffert du mobutisme, y est né.
Lors de la préparation de la guerre de libération en 1995, Sikatenda proposa de commencé la lutte à Kasenga, près de Pweto. Il argumentait : « Je peux y réunir 1.000 combattants, je suis bien connu là-bas. » Mais c’est finalement Lwetscha qui a rallié la majorité pour lancer la guerre à partir d’Uvira. La population y était acquise à la cause et le Rwanda et le Burundi étaient déjà en confrontation avec Mobutu. En mai 96, Sikatenda lui-même a recruté 397 jeunes à Lueba, au nord de Baraka. Il était en contact avec Nyangoma.
Justin M’Molelwa : « Je veux affronter n’importe quel individu qui prétend que Joseph n’est pas le fils de Laurent Désiré Kabila. Si je suis une vache, le crapaud dans l’eau ne va pas m’empêcher de faire ce que je veux. Quand j’arrive près du crapaud, il se tait. Depuis la naissance de Joseph et Jaynet, à Hewa Bora, en Tanzanie ou en Ouganda, personne, mais alors personne n’a jamais dit qu’ils n’étaient pas les enfants de Mzee ! J’ai entendu ce mensonge pour la première fois après la guerre de libération, ici à Kinshasa… »
Joseph Kabila et la défense de Kinshasa en août 1998

Le général-major Lwetcha en concertation avec le général-major Joseph Kabila Kabange
Au Rwanda, Mzee a appris à connaître les talents militaires de deux officiers supérieurs particulièrement doués : Kagame et Kabarebe.
Au début de la guerre de libération en 1996-97, Kabarebe a reçu le commandement des troupes de l’Alliance. Mzee a placé son fils aux cotés de Kabarebe pour qu’il apprenne à commander une armée moderne. Mzee Kabila a toujours estimé que la meilleure école militaire est la pratique sur le champ de bataille.
Le 2 août 1998, les troupes rwandaises et ougandaises attaquent le Congo de Mzee Kabila.
Peu après, ayant survolé tout le territoire congolais, des troupes aéroportées prennent la base de Kitona, à 2.000 km de la frontière rwandaise.
Mais elles seront encerclées et battues par les forces angolaises.
Les survivants marchent à pieds sur Kinshasa. Ils foncent aussi sur Inga, occupent le site et coupent l’électricité pour les 8 millions d’habitants de la capitale. Un crime de guerre dont Kagame et Kabarebe répondront un jour.
Le 26 août, tôt le matin, des centaines d’agresseurs et rebelles entrent à Kimbanseke et Masina. Le même jour, Abdoulaye Yerodia annonce le couvre-feu dans la capitale.
C’est le début de la résistance populaire héroïque de la population de la Tshangu et des autres communes de la capitale contre l’agression – rébellion... Le 22 août, la ville stratégique de Kisangani tombe...
Au moment de l’agression, Joseph Kabila suivait une formation dans une Académie militaire en Chine. Il a été rappelé d’urgence par le Président Mzee Laurent Désiré. Joseph Kabila a étudié pendant six mois en Chine.
De retour au pays, le commandant Joseph Kabila reçoit, dans les circonstances dramatiques où les agresseurs et rebelles veulent s’emparer de la capitale congolaise, la lourde tâche de chef d'état-major des Forces armées congolaises. Il succède au général Kifwa.
A ce moment, Joseph Kabila est face à face avec son ancien maître en art militaire, Kabarebe, dont il connaît parfaitement les tactiques et les ruses…
Le premier objectif de Kabarebe est la prise de l’aéroport de Ndjili, qui permettra l’envoi de troupes fraîches du Rwanda et de l’Ouganda.
C’est Joseph Kabila qui dirige la défense de l’aéroport dans des combats très rudes qui durent trois jours. Kabarebe doit décrocher, battu par son élève…
Récemment, des intoxicateurs qui suivent Ngbanda et Bemba, ont prétendu que "Joseph Kabila a insulté les Kinois." L’accusation est ridicule. A un des moments les plus dramatiques de la guerre, lorsque les agresseurs et rebelles avaient déjà pénétré dans la Tshangu, c’est Joseph Kabila qui dirigeait les Forces Armées Congolaises pour défendre la capitale et c’est lui qui organisait le soutien à l’autodéfense populaire à Masina, Ndjili, Kimbanseke…
Joseph Kabila, qui n’a jamais insulté qui que ce soit, pourquoi insulterait-il une population courageuse dont il a dirigé la résistance en dirigeant les Forces Armées Congolaise de la capitale Kinshasa?
En plein combat pour la Tshangu, le 28 août 1998, Joseph Kabila fait une déclaration à la radio. « Nous lançons un appel patriotique aux soldats congolais impliqués dans cette aventure rwandaise contre notre pays à déposer les armes immédiatement et à regagner les rangs de l'armée régulière ».
Au même moment, à Luanda, dos Santos, Kabila et Sam Nujoma discutent du danger de déstabilisation de la région. Les ministres de la Défense du Zimbabwe, de l'Angola, de la Namibie et du Congo se rencontrent à Harare dans le cadre de la SADC.
Ils déclarent : « Nous avons pris une décision collective que toutes sortes d'aides doivent être accordées au Président Kabila, y compris un soutien militaire. Il y a une guerre là-bas qui doit être arrêtée. Les ministres de la Défense de la SADC ont décidé d'intervenir et cela doit être fait. » Avec cette phrase, le destin du Congo bascule. Les agresseurs ne pourront jamais occuper le Congo…
Mzee a tracé alors la stratégie à suivre pour vaincre des agresseurs disposant d’une grande expérience militaire et de puissants alliés sur le plan international.
Mzee déclara : « Nous devons être préparés à une guerre longue, très longue, une guerre prolongée, une guerre populaire où le peuple tout entier devra défendre sa Patrie et sa souveraineté. Le peuple devra s'armer pour repousser l'agresseur. Il devra refuser toute coopération avec les envahisseurs. Une force de défense appelée "autodéfense populaire" va être mise sur pieds et les armes seront distribuées à ceux qui pensent encore pouvoir se défendre au lieu de s'aliéner. »
Mzee envoie son fils sur tous les fronts décisifs. Joseph Kabila dirigera le front de Mbandaka en Equateur et celui de Mbuji Mayi au Kasaï. Il participe à la bataille cruciale pour la ville stratégique de Kabinda…
4 . Le discours-programme du 26 janvier 2001
Le serment de Joseph Kabila pour l’indépendance, la paix et la réunification
Le 16 janvier 2001, le grand patriote et révolutionnaire le Président Mzee Laurent Désiré Kabila est assassiné au Palais de Marbre.
A ce moment, les groupes rebelles, créés, armés et soutenus par le Rwanda et l’Ouganda, contrôlent de larges parties du territoire national.
Le Président défunt avait galvanisé la population pour la défense du territoire national et pour la création d’un nouveau pouvoir nationaliste et populaire.
L’assassinat de Mzee a été le signal pour les rebelles et les mobutistes pour réaffirmer leur volonté de prendre le pouvoir grâce à un « coup d’état parlementaire, grâce à un « dialogue intercongolais » où ils auraient la majorité.
Il faut rappeler que Mzee Kabila avait accepté le principe d’un débat national intercongolais, qui se ferait sous la direction du gouvernement légitime et qui réaliserait une plus grande inclusivité. En 2000, d’anciens cadres de la « rébellion » avait déjà été cooptés au Parlement de Mzee à Lubumbashi.
Dans la situation de faiblesse et de désarroi dans laquelle se trouvait le camp nationaliste après l’assassinat de Mzee, Joseph Kabila a décidé de changer de tactique : il a choisit la lutte politique comme la principale forme de combat et la lutte militaire comme forme secondaire.
Choisir la lutte politique signifiait accepter le dialogue inter-congolais comme forum où les décisions essentielles seront prises.
Joseph Kabila a décidé en même temps une ouverture politique vers la principale force qui s’est acharnée contre Mzee Kabila : les Etats-Unis. Puis il a dialogué avec l’Union Européenne et particulièrement avec la France et la Belgique, qui s’opposaient aux aventures militaires du Rwanda et de l’Uganda au Congo.
Dix jour après l’assassinat de son père, Joseph Kabila fait un discours-programme remarquable qu’il va mettre en pratique de façon conséquente, sans déviation, pendant toute la durée de la transition… Nous pouvons dire que, engagé dans la carrière militaire, Joseph Kabila a mûri politiquement à l’école de son père. Et ce qui frappe d’emblée dans ce discours programmatique du jeune président, c’est sa détermination à rester fidèle à l’héritage politique de Mzee Laurent Désiré Kabila, son père.

En effet, Joseph Kabila déclare : « Des circonstances tragiques ont conduit à la disparition inopinée du Président de la République Mzee Laurent-Désiré Kabila, circonstances qui laissent inachevée l’œuvre combien exaltante de reconstruction et de consolidation de la Nation congolaise.
L'ignoble assassinat du Chef de l'Etat a fait que les hautes charges de la magistrature suprême me soient confiées, à un moment où la Nation, déchirée par la guerre, avait encore besoin de l'illustre disparu, artisan de sa libération, du réveil de sa conscience nationale, ainsi que de la fierté et de la dignité retrouvées. Visionnaire et précurseur, Homme d'Etat de grande envergure, Mzee Laurent-Désiré Kabila a consacré toute sa vie à la lutte pour le triomphe des valeurs sacrées que sont : la liberté, la justice, l'égalité des citoyens dans un Congo uni, indépendant et souverain.
Il a gouverné en comptant essentiellement sur ses ressources aussi bien humaines que naturelles. Mzee Laurent-Désiré Kabila, est parmi les rares dirigeants dans l'histoire du monde contemporain à avoir exercé le pouvoir pendant plus de trois ans, sans avoir contracté de dettes extérieures à la charge de l'Etat, ni accumulé de fortune personnelle.
Le Chef de l'Etat, Laurent-Désiré Kabila, a toujours demandé au peuple congolais de se prendre en charge lui-même. »
Après ces paroles, on est étonné que dans le camp nationaliste, des voix se soient immédiatement élevées pour dire : « Joseph Kabila suit une politique radicalement différente de celle qu’appliquait son père… »
Cette phrase exprimait surtout la volonté de pas mal de « kabilistes », poussés par intérêt, de rompre avec les « sottises » du pouvoir populaire. Ce reniement exprimait leur espoir de remettre en place la démocratie « traditionnelle » qui a connu son heure de gloire lors de la transition mobutiste…
Il est vrai aussi que pas mal de nationalistes honnêtes n’avaient pas compris les changements dans la situation politique provoqués par l’assassinat de Mzee et la nécessité qui s’en suivait de changer de tactique pour réaliser les mêmes objectifs.
Dès qu’il est devenu président, l’objectif essentiel de Joseph Kabila a été de mettre fin à l’agression et à l’occupation par les troupes rwandaises et ougandaises et d’obtenir de tous les partis un engagement ferme pour aller aussi vite que possible aux élections.
Est-ce que Joseph Kabila n'a jamais réprimé des forces nationalistes qui défendaient le credo de Mzee? Est-ce que Joseph Kabila a jamais dénoncé des groupes mzee-kabilistes pour avoir défendu la souveraineté congolaise, la révolution populaire, l’indépendance économique et le pouvoir populaire ? Jamais.
Pourquoi Joseph Kabila aurait-il affronté les nationalistes révolutionnaires, alors qu’il ne réprima pas le RCD, lorsqu’en juin 2004, ce parti accusait le Président d’avoir « un comportement qui frise le terrorisme d’Etat digne d’un Etat-voyou ou d'une dictature noire et sanguinaire » ?
Joseph Kabila ne pouvait pas être au four et au moulin.
Le Président ne pouvait pas guider une transition inclusive et s’engager à fond pour la défense du kabilisme révolutionnaire. C’était à d’autres, qui n’avaient pas les mains liées par l’accord global et inclusif, de le faire.
Nouvelle situation, nouvelle tactique.
Nouveau Chef, nouvelle méthode.
Mzee Kabila avait dénoncé en son temps l’Accord de Lusaka parce qu’il niait l’agression. Cet Accord servait à maintenir l’agression et l’occupation et à imposer un dialogue entre le pouvoir nationaliste de Mzee Kabila et ses pires ennemis qui auraient la majorité au « dialogue ». Mzee combattait à juste titre cet accord qui a été fait explicitement pour éliminer le pouvoir nationaliste.
Joseph Kabila a dû accepter cet accord dans des circonstances toutes nouvelles. Il n’avait ni le prestige, ni la maîtrise de la scène politique qu’avait son père et le rapport de forces avait radicalement changé.
Le dirigeant historique Laurent Désiré Kabila assassiné, Joseph Kabila devait reculer, pour pouvoir revenir à la charge par d’autres moyens. Joseph Kabila était obligé de changer la tactique dans la lutte contre l’agression et contre les collaborateurs de l'ennemi.
Joseph Kabila décida de placer le combat principalement sur le terrain politique, tout en préparant des contre-offensives militaires quand la situation l’exigerait.
Joseph Kabila changeait aussi de tactique en prêchant l’unité de toutes les forces congolaises qui refusaient l’agression et l’occupation rwandaises et ougandaise…. En effet, dans les groupes rebelles, le mécontentement de la domination rwandaise et ougandaise et l’opposition aux massacres des populations congolaise, s’amplifiaient.
Après plus de trois années d’agression, d’occupations, de massacres, après trois millions de morts, même les puissances occidentales, qui avaient donné leur fiat à l’agression, voulaient que cela cesse.
Joseph Kabila a compris tous ces changements objectifs et il a adopté une nouvelle tactique.
Le 26 janvier 2001, Joseph Kabila disait au peuple congolais : « Ensemble, sans exclusion, nous devons nous armer de courage, …pour affronter les défis de l'heure : l'instauration de la paix et la consolidation de la communion nationale, face à une Nation déchirée par une guerre d'agression inacceptable. Ce défi repose essentiellement sur le retrait immédiat et sans conditions des Etats agresseurs, en l'occurrence, le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda.
Nous allons … examiner les voies et moyens pour relancer l'Accord de Lusaka afin qu'il puisse ramener la paix dans la région des Grands Lacs, … tout en préservant l'indépendance, la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'unité du pays. »
L’agression-rébellion n’avait pratiquement aucune base dans les territoires sous pouvoir nationaliste et elle était haïe dans les territoires occupés. Les contradictions entre les puissances occupantes et leurs « rebelles » se multipliaient. C’était de la bonne guerre de la part de Joseph Kabila de promettre une libéralisation politique tous azimuts : elle devait nécessairement accentuer les oppositions entre les Congolais engagés dans la « rébellion » et leurs commanditaires rwandais et ougandais.
Joseph Kabila disait ceci dans sa première grande adresse au peuple : « En deuxième lieu, il y a le défi de la normalisation de la vie démocratique telle que le Président de la République, Mzee Laurent-Désiré Kabila, l'avait lui-même proposée. Il s'agit de renforcer l'Etat de droit, de consolider la démocratie et la bonne gouvernance, de garantir les droits de l'homme et la justice.
C'est de cette façon qu'on pourra mieux préparer les échéances futures, notamment l'organisation des élections libres et transparentes sur toute l'étendue de la République Démocratique du Congo.
Il y a aussi le défi de la reconstruction nationale sur tous les plans, car il convient de poursuivre le programme et les efforts engagés par le Gouvernement de Salut Public, sous la haute direction de Mzee Laurent-Désiré Kabila, depuis la libération du 17 mai 1997, mais, hélas, freinés par la guerre d'agression.
Cette guerre a accru la misère de notre peuple. En ce début du 21ème siècle, il s'agit de reconstruire un pays plus beau qu'avant comme l'affirme notre hymne national. Et pour cela nous avons besoin de toutes les énergies et de tous les bras.
Dans l'esprit et l'orientation du Président de la République, Mzee Laurent-Désiré Kabila, je prends l'engagement de poursuivre l’ouverture afin que tous les acteurs politiques exercent leurs droits dans le respect des lois et règlements.
Les problèmes politiques d'importance majeure devront trouver leur solution dans le cadre du Dialogue intercongolais.»

Fidèle au panafricanisme de Mzee Kabila, Joseph Kabila déclara :
« Concernant le continent africain, je voudrais lancer un appel pathétique pour une plus grande solidarité. En effet, l'Afrique se meurt. J'exhorte donc les peuples frères d'Afrique à redynamiser l'Organisation de l'Unité Africaine dans l'esprit des pères fondateurs. Comme l'exprimait Mzee Laurent-Désiré Kabila, un grand panafricaniste, il faut renouer avec la flamme rédemptrice de N'krumah et de Lumumba.
La République Démocratique du Congo étant physiquement au centre géostratégique de l'Afrique, elle entend jouer un rôle de première importance dans le renouveau de l'Organisation panafricaine. »
Notons aussi que le 16 janvier 2001, le Président Joseph Kabila félicita l'Assemblée Constituante et Législative-Parlement de Transition pour avoir élevé le Président Laurent-Désiré Kabila au rang de Héros National. Il salua aussi « les Comités du Pouvoir Populaire et les Forces d'Autodéfense Populaire pour leur contribution remarquable au maintien de l'ordre en cette période difficile.
Soutien décidé aux compatriotes qui subissent l’occupation rwandaises
Dès son premier discours, Joseph Kabila a mis un accent particulier sur le soutien à apporter à ses compatriotes qui subissaient la terreur des armées d’occupation et de leurs milices.
Le Président dit : « Aux frères et sœurs vivant dans les territoires sous occupation, je salue votre sens élevé de sacrifice ainsi que votre attachement pour la Patrie. Je vous exprime notre solidarité dans la lutte que vous menez, dans des conditions difficiles pour la libération du pays. Mes efforts militaires, politiques et diplomatiques seront orientés vers votre libération totale de l'occupation des forces d'agression. En ce moment où j'accède aux hautes charges de la République, je lance un appel solennel et pathétique à la jeunesse congolaise afin qu'elle se joigne à moi dans la défense des intérêts vitaux de la Nation et pour assumer notre destin ».
Puis il énonça cette thèse fondamentale : « Une fois la paix retrouvée et l'intégrité territoriale restaurée, mon action consistera à préparer des élections libres et transparentes, pour amener le peuple à se choisir lui-même, un chef qui présidera aux destinées de ce pays.
Le Président Joseph Kabila a conclu son discours historique du 16 janvier 2001 en ces termes.
« Notre pays traverse l'une des plus douloureuses crises de son histoire. Mais je crois que tous ensemble nous la surmonterons, car nos ennemis n'ont pas réussi à briser l'essentiel : notre courage, l'amour que nous vouons à notre Patrie, à l'Unité de ce grand Congo que Lumumba conduisit à l'indépendance et pour lequel le Président de la République, Mzee Laurent-Désiré Kabila, lutta jusqu'à sa mort tragique.
Les hommes peuvent disparaître, mais cette flamme-là, nous allons tous ensemble la transmettre à nos enfants. »
Son premier discours nous a révélé un Joseph Kabila nationaliste et mzee-kabiliste, un homme flexible aussi, capable de poursuivre l’idéal de son père dans une situation toute nouvelle et par d’autres tactiques.
5. Joseph Kabila, l’artisan de l’inclusivité et de la transition non conflictuelle (*)
Fidèle à son discours du 26 janvier 2001, Joseph Kabila convoque en août 2001 les négociations politiques inter-congolaises. Les travaux préparatoires ont lieu à Gaborone, capitale de Botswana. On s’attendait à ce que les politiciens qui ne juraient que sur les négociations, applaudissent à cette décision de Joseph K abila. Mais non ! L’opposition le qualifie de « dictateur » et demande son départ !
Cette opposition a une curieuse façon de comprendre son propre principe "d’égalité de toutes les parties au Dialogue". Pour cette opposition, il n’y a plus ni chef de l’Etat ni gouvernement. Tout le monde devait être sur le même pied d’égalité. Et pourtant, l’opposition voulait la disqualification de la partie gouvernementale ! Tout cela en dépit du discours fort qui affirmait que « l’exclusion ne paie pas »… Sauf s’il s’agit d’exclure les nationalistes et les révolutionnaires…
Joseph Kabila défenseur de la souveraineté nationale
A Gaborone, Joseph Kabila était la cible des opposants qui ne voulaient pas de sa présence dans la capitale botswanaise. L’opposition congolaise voulait qu’à la cérémonie d’ouverture, à laquelle assistaient sept chefs d’Etat africains, Joseph Kabila, le plus concerné, ne prenait pas part. Ils étaient catégoriques : pas d’hymne national congolais et pas de drapeau congolais. On ne sait pas ce que les opposants congolais avaient contre les signes de la souveraineté de leur pays… C’est la preuve que dans la tête de beaucoup d’entre eux, le Congo comme Etat souverain, n’existait plus.
Pour sauver les négociations, Joseph Kabila était prêt à reprendre son avion pour Kinshasa. Ce sont ses collègues chefs de l’Etat africains invités à cette cérémonie, qui ont exigé qu’il soit là.
Joseph Kabila a donc été obligé à ré-affirmer d’abord l’existence du Congo et sa souveraineté, avant de rechercher sa réunification et sa pacification.
Les travaux de Gaborone ont abouti à la signature d’un pacte républicain, en plus d’un programme de négociations politiques inter-congolaises qui devaient avoir lieu au siège de l’Union Africaine à Addis-Abeba le 15 octobre 2001. Dans le pacte républicain, les politiciens, ceux qui étaient dans la rébellion comme ceux de l’exil, mettaient l’accent sur la récupération de leurs biens… Les opposants avaient bouffé sous Mobutu et étaient déterminés à continuer à bouffer…
Joseph Kabila défenseur de l’inclusivité
Le 15 octobre 2001, le facilitateur Masire convoque les travaux du dialogue inter-congolais à Gaborone. Sur les 330 délégués que les travaux préparatoires ont prévus, seuls 60, c’est-à-dire, ceux qui ont participé aux travaux de Gaborone, sont à Addis-Abeba. Le facilitateur ne peut pas en amener davantage faute des moyens… Et ses fonds disponibles permettent seulement de couvrir 5 jours de délibérations…
Les politiciens congolais ne veulent pas rater cette occasion. Les 60 mandataires de Gaborone décident de se substituer aux mandants et de prendre les décisions capitales en cinq jours.
Il fallait pour ce faire, ignorer les décisions de Gaborone.
En trois jours, ils veulent prendre les décisions et se partager le pouvoir.
Quelles négociations pouvait-on faire en 72 heures pour une problématique aussi complexe de celui du Congo occupé et divisé ? En réalité, ce qui intéressait les politiciens néocoloniaux, c’était un accord rapide de partage du pouvoir.
Pour forcer la main de Joseph Kabila, ils le rassurent qu’il pourra garder son poste de Président…
Mais Joseph Kabila tient à l’inclusivité et veut la présence des 330 délégués convenus. Il donne l’ordre aux délégués qu’il a envoyé, de quitter Addis-Abeba…
Alors les politiciens se rendent à l’évidence, non sans maudire...
On peut conclure que si Joseph Kabila n’avait pas tenu bon, le dialogue inter-congolais de Sun City – Pretoria n’aurait pas eu lieu.
A Sun City, Joseph se bat toujours pour l’inclusivité
Les négociations inter-congolaises sont transférées à Sun City en République sud-africaine. Elles devraient avoir lieu le 25 février 2002. Mais l’opposition conteste maintenant une liste de 20 membres, essentiellement de l’opposition politique, affirmant qu’ils n’ont pas le certificat d’opposants. La délégation gouvernementale estimait qu’il y avait de la place pour tous les Congolais présents à Sun City.
Finalement, Tshisekedi et Nzuzi wa Mbombo font rayer de la liste Frédéric Kibasa Maliba de l’Udps et Félix Vunduawe du Mpr.
Puis les opposants reviennent sur leur thèse il n’y a plus de président ni de gouvernement en RDC. A Johannesburg, Tshisekedi se précipite pour annoncer sa candidature à la Présidence de la République avant que les travaux aient commencé. Et il est soutenu par les mouvements rebelles !
Joseph Kabila pour un Président et un Premier ministre.
On perd tellement de temps que le gouvernement sud-africain, après la prolongation d’une semaine, ne peut pas aller au-delà. Pour ne pas terminer les travaux sur un fiasco, entre Congolais, on signe un accord cadre qui préconise un poste de Président de la République et d’un Premier ministre. La fameuse formule 1+1 Kabila et Bemba.
Ce schéma est repoussé par le Rcd, l’Udps et le Palu, mais est signé par la quasi-totalité des associations de la Société civile. JP Bemba est désigné Premier ministre, Ruberwa président du parlement...
La commission constitutionnelle réunie ensuite à Matadi et qui devait concrétiser l’accord en le coulant sous forme de loi fondamentale, piétine. Le MLC et la composante « gouvernement » n’arrivent pas à un accord. Les travaux de Matadi se terminent sur un échec. Et l’accord cadre est abandonné.
Les délégués congolais rentrent à Pretoria.
Pour compenser les faiblesses notoires du facilitateur Masire, ce dernier est doublé d’un modérateur : l’ancien Premier ministre sénégalais Moustapha Niasse.
Les travaux de Pretoria aboutissent le 17 décembre 2002 à un accord dit global et inclusif qui est, en réalité, un accord de partage du pouvoir. Il préconise un président de la République et quatre vice-présidents. C’est la fameuse formule 1 + 4 dont l’UDPS affirme haut et fort que c’est sa victoire…
Mais ce même parti criera en juin 2004 dans les rues de Kinshasa : « 1 + 4 = 0 »…
Joseph Kabila a même accepté d’être réduit à un chef de composante…
L’accord global et inclusif saucissonne le pouvoir. Chaque composante gère un certain nombre de ministères, soit huit portefeuilles par composante et quatre par entité. C’est le chef de composante qui nomme et révoque « ses » ministres et vice-ministres.
Dans un gouvernement de 60 membres, le chef de l’Etat n’est directement responsable que de huit ministres et quatre vice-ministres. Inacceptable ? Cette expérience unique au monde est voulue par les politiciens pour élargir leurs revenus légaux et illégaux.
Le Président Joseph Kabila a accepté cette aberration comme prix à payer pour qu’il y ait la paix et la réunification du territoire national.
Ainsi, le garant de la nation ne peut pas faire partir un ministre qui a commis une faute grave. Il faut s’en remettre à son chef de composante qui peut accepter ou refuser son départ.
Même quand le chef de composante ou de l’entité n’a aucune fonction publique, il nomme les ministres dans le gouvernement d’un pays ! C’est le cas pour Roger Lumbala de l’entité Rcd/N. Ce monsieur est parti du gouvernement pour mal gouvernance, mais comme chef de l’entité, il pouvait désigner lui-même son remplaçant… Il n’a pas cherché loin : ce monsieur a nommé sa propre femme… Le portefeuille ministériel est resté en famille.
Le même accord inclusif confie au parlement la mission de contrôler l’action du gouvernement… mais ce parlement n’a pas le droit de sanctionner le gouvernement par une motion de méfiance. Si on dit que cet accord favorisait l’impunité, on n’exagère pas.
Joseph Kabila tient mordicus aux élections
Joseph Kabila a reçu du dialogue inter-congolais la mission de réunifier et de pacifier le pays, de réconcilier les Congolais et de les amener aux élections.
En juillet 2006, le pays est réunifié et pacifié pour l’essentiel. Aux différents groupes armés, succède une armée nationale et intégrée. Il ne reste plus qu’à aller aux élections pour qu’enfin le peuple congolais récupère son pouvoir de désigner des dirigeants.
Mais ce chemin des élections est parsemé d’embûches. Les politiciens habitués à se partager le pouvoir au cours des combines politiciennes, ne sont pas prêts à se soumettre au verdict du peuple. Il a fallu la détermination de Joseph Kabila pour que les opérations d’enrôlement et le référendum constitutionnel aient lieu.
Après le 30 juin 2006, Joseph Kabila a dû rejeter toute idée de « négociations » qui auraient pour unique objectif de faire traîner à l’infini les luttes pour les postes et de repousser de plus en plus loin les élections.
Tout le monde se rappelle les politiciens qui ont fait durer la transition mobutiste de 1990 à 1997, …pour ne jamais avoir des élections démocratiques.
En conséquence, Laurent Kabila a dû prendre les armes et chasser le dictateur, pour décider que des élections libres et démocratiques auront lieu en 1999.
Les forces étrangères et les politiciens néocoloniaux savaient que Mzee Kabila allait effectivement organiser les élections dans ce délai… et qu’il allait les gagner haut la main. Alors le Rwanda de Kagame et l’Ouganda de Museveni ont été engagés pour chasser Mzee Kabila du pouvoir et rétablir un gouvernement de politiciens du temps de Mobutu…
Mais ils ont connu l’échec.
Le gouvernement nationaliste a tenu.
D’abord sous Mzee Kabila, ensuit sous Joseph Kabila…
6. Le tournant décisif de la guerre.
La résistance militaire et populaire à l’occupation de Bukavu en février - juin 2004
Début février 2004, une cache d'armes contenant 65 caisses de munitions a été découverte à Bukavu dans une maison du gouverneur Xavier Chiribanya. Samedi 21 février les hommes du général Nabyolwa découvrent aussi des caches d'armes chez le major Kassongo et chez le colonel John Bahati. Kassongo est transféré pour enquête à Kinshasa.
Peu avant minuit, le 23 février, Mutebutsi mène une opération pour arrêter son supérieur, le général Nabyolwa.
Le 3 mars, Kassongo, est entendu par la mission de l’Etat-major général qui conclut qu'il y a eu acte délibéré de mutinerie.
Les événements de février à Bukavu prouvent que le RCD se comporte comme s'il possédait toujours "son propre armée" qui n'est pas subordonné à la hiérarchie militaire nationale.
Le RCD est toujours dans la logique de l'agression-rébellion. Le RCD sait que lorsqu’il n'aura plus la main sur "son" armée, Kagame ne pourra plus envoyer son armée au Kivu en la faisant passer pour des troupes du RCD… Le RCD continue donc de rouler pour le Rwanda…
Le RCD fait une déclaration qui annonce une Troisième guerre.
Elle s'appelle officiellement "Déclaration politique du RCD et alliés du 24 février 2004".
Elle dit entre autres : «Le comportement du Chef de l’Etat Joseph Kabila frise le terrorisme d’Etat digne d’un Etat-voyou ou d'une dictature noire et sanguinaire."
Ce langage exprime une hostilité farouche à l’égard du Président Joseph Kabila.
"Le nouveau scandale signé Président Joseph Kabila n’est pas de nature à conduire la transition vers les élections générales dans la sérénité et la non- conflictualité exigées." Ceci montre clairement la volonté du RCD de tout faire pour empêcher que le Congo puisse tenir les élections à la date prévue.
Autre "scandale" retenu contre Joseph Kabila : "le refus de nommer les officiers régulièrement désignés par une composante, en l’occurrence le RCD". Et de citer les généraux Bora et Nkunda et le colonel Mirindi. Or, Bora et Mirindi ont été condamnés à mort pour l'assassinat de Mzee Kabila et Nkunda aura tôt ou tard à répondre devant la justice des crimes commis contre la population nationaliste de Kisangani.
Dans un langage qui rappelle les plus violentes tirades du RCD et MLC contre Mzee Laurent Désiré Kabila, la Déclaration dit : "Le Général Major Joseph Kabila se croit tout permis. Ce qui lui reste, c’est son intronisation comme Empereur de la République Démocratique du Congo. Le RCD et alliés ne peuvent en aucun cas cautionner le retour à la dictature."
Malgré toutes les concessions souvent humiliantes que Joseph Kabila a fait, il reste, aux yeux des agents de Kagame, un dictateur détesté…
"Si les revendications du RCD et alliés ne sont pas prises en compte, ils se réserveront le droit d’utiliser tous les moyens à leur disposition pour … mettre fin à la dictature naissante."
Kagame et le RCD préparent donc à nouveau la lutte armée pour renverser Joseph Kabila ! C'est une évidence : "utiliser tous les moyens pour mettre fin à la dictature naissante de Joseph Kabila", c’est le même langage qu’au moment de l’agression du 2 août 1998. La Déclaration du RCD du 24 février 2004 est une Déclaration pour une troisième guerre…
Seulement, Kagame et le RCD n’ont pas saisi le changement des rapports de force intervenu suite à la nouvelle politique de Joseph Kabila !
Le "Mémo" des séparatistes rwandophones du Kivu
Au moment où Ruberwa et le RCD pose leur ultimatum à Joseph Kabila, les séparatistes rwandophones avancent leurs revendications.
La première: "Le Président doit faire fonctionner l’espace présidentiel sur base de prises de décisions consensuelles entre les composantes du Dialogue inter-congolais. Selon la Constitution, les cinq institutions de la République sont : le Président, le gouvernement, l'assemblée national, le sénat, les cours et tribunaux. (Article 63). La Présidence, qui regroupe le Président et les quatre vice-présidents, est simplement un organe de "concertation". (Article 82) Seul le Président "est le garant de l'indépendance, de l'intégrité du territoire national et de la souveraineté nationale". (Article 68). Le "Mémo" des séparatistes prône une sorte de coup d'état qui enlèvera au Président Kabila ses prérogatives constitutionnelles. Les forces rwandaises et pro-rwandaises veulent paralyser le Président pour avoir les mains libres au Kivu.
Deuxième revendication : "Une forte décentralisation territoriale, prélude au processus fédéraliste". Il faut «la répartition des ressources et des compétences entre le Gouvernement et les Entités Décentralisées». Le RCD veut une décentralisation et une fédéralisation qui crée les conditions optimales pour faire avancer la cause du séparatisme ou du contrôle effectif du Rwanda sur le Kivu.
Le 11 août 2003, à Bruxelles, Manasse Müller Ruhimbika, Tutsi congolais et patriote bien connu, déclare ceci : "Kagame a ses hommes à la tête du Congo, et en même temps il garde son potentiel militaire intact au Congo. Ses militaires restent à l'œuvre à l'Est de notre pays. Alors, la question se pose : le RCD mouvement politique, peut-il réellement gérer sa "milice" pour qu'elle intègre l'armée nationale ? Ces militaires doivent quitter l'état de milice, pour être gérés par la Nation. Rappelons que près de 40 % des officiers du RCD sont à la fois des militaires de l'ANC (RCD) et des militaires officiellement reconnus de l'Armée Patriotique Rwandaise. Je pense que le RCD va mettre sur la table autant que possible de questions qui ne peuvent trouver de réponse. Ils feront cela pour empêcher que nous ayons une Transition normale. Ainsi, ils vont faire barrage à la reconstruction, ils vont empêcher le démarrage. Ils espèrent que, finalement, les Congolais vont se résigner, ils ne vont plus rien attendre de ce gouvernement. Ceci peut créer une situation propice à l'implosion du Congo."
Joseph Kabila : « La population de l’Est a l’endurance digne de la Résistance. »
Le 3 mars, lors d’une interview accordée à Radio Okapi, le Président Joseph Kabila a tiré les conclusions de la crise grave provoqué par les agissements du RCD et alliés en liaison directe avec Kagame. “Je sais que la population est inquiète. Je dis que la même population qui a pu résister à l’occupation, peut encore résister et surtout qu’elle ne doit pas baisser les bras face aux Rwandais. Elle doit avoir de l’endurance digne de la résistance. … Je peux dire que lorsque les troupes rwandaises étaient présentes, la résistance était telle qu’elles ont quitté notre territoire. Et si les troupes rwandaises sont là, la résistance devra les faire partir comme il y a quelque temps. …La population doit aussi savoir que la paix commence à venir et tout est fait pour que la paix revienne. Des mesures seront prises pour empêcher qu’un aventurier puisse se réveiller un matin et poser des actes contraires à la discipline militaire. La population doit se sentir sécurisée et nous sommes là pour elle. … La sécurité est sans nul doute la tâche du gouvernement, mais la population doit aussi collaborer. … Nous allons commencer le travail de la réunification de l’armée et nous allons désarmer tous ces jeunes gens qui circulent partout avec des armes pendant qu’ils sont censés ne pas en détenir. Après la démobilisation, j’ai l’espoir que la sécurité reviendra graduellement. La population doit être vigilante.”
Joseph Kabila continue l’œuvre de son père : résister, résister, jusqu’à ce que les agresseurs quittent le Congo.
Joseph Kabila : « Nous ramènerons la guerre d'où elle est venue : au Rwanda ! »
Le 3 juin 2004, au plus fort de la nouvelle occupation au Kivu, Joseph Kabila dit au journal Le Monde : “L'histoire se répète. Une fois de plus, les troupes rwandaises ont traversé la frontière. Elles contrôlent déjà Bukavu. La tension est palpable dans les autres villes de l'Est. Une nouvelle guerre nous est imposée. Par cette invasion, le Rwanda montre clairement qu'il ne veut pas la paix, ni au Congo, ni dans la région des Grands Lacs. Le gouvernement de transition va prendre ses responsabilités. Il est vrai que le pays est à genoux et que la population vit dans la misère. Mais nous n'avons pas d'autre choix que de défendre le territoire national et l'indépendance de notre pays. J'ai lancé la procédure pour proclamer l'état d'urgence. Le gouvernement a d'ores et déjà décidé la mobilisation générale pour défendre la patrie. Ce pays regorge de ressources et la mobilisation des Congolais est totale. La capacité militaire se construit avec le temps, mais, même si la guerre est longue, nous finirons par la ramener d'où elle est venue, à savoir au Rwanda ! Pour cela, nous devons nous organiser. Les guerres successives qui ont ravagé la RDC nous enseignent que nous devons d'abord compter sur nous-mêmes. Je suis déçu de l'inaction et du manque de solidarité de la communauté internationale et des Nations unies. Malgré son armement et son mandat, la mission de l'ONU n'a pas empêché la chute de Bukavu. Plus de 3 millions de Congolais sont morts du fait des guerres qui nous ont été imposées. Il faut que cela cesse ! Le gouvernement a adopté une position commune et l'ancien mouvement rebelle RCD était représenté à ce conseil extraordinaire. Il faut que les Congolais réagissent ensemble. Il y a 300 ethnies chez nous. La communauté banyamulenge n'est pas menacée et elle ne le sera jamais. Elle compte parmi les 300 ethnies qui fondent la nation congolaise. J'ai pour mission de protéger ces 300 ethnies, les 60 millions de Congolais. Ils sont unis et, avec leur concours, je mènerai cette mission à bien.”
La mobilisation générale pour défendre la Patrie : c’est l’appel de Mzee en août 1998. « Même si la guerre est longue, nous finirons par la ramener d'où elle est venue, à savoir au Rwanda ! » C’est ce que Mzee promettait…
Les événements de février-juin 2004 à Bukavu ont constitué le tournant dans l’histoire de la guerre d’agression. En effet, elles ont fait comprendre à tous les Congolais, de l’Ouest à l’Est, que le RCD-Goma représentait les visées expansionnistes de Kagame sur le Congo. Dans la période qui suivra, le RCD connaîtra de multiples scissions, et même ceux qui sont restés, prendront les uns après les autres, leur distance du Rwanda kagamiste…
La solidarité agissante des Congolais avec leurs frères et sœurs sous occupation, s’est manifestée comme jamais auparavant. Le 2 juin 2004, il y a eu des foules immenses dans les rues de Kinshasa. Les estimations variaient de 500.000 à 1.000.000 personnes. La colère populaire a éclaté spontanément devant cette nouvelle humiliation infligée par Kagame. Cela a été vraiment une journée historique. Les manifestants s’en prenaient surtout à la Monuc et exigeaient la démission de Swing. Ils disaient qu'il collabore avec Kagame et qu'il est responsable pour l’occupation de Bukavu. La Monuc a tiré sur les manifestants à Kinshasa. On a parlé de sept morts.
Des manifestations semblables ont eu lieu à Kisangani, et d’autres villes.
Le droit international étant du côté congolais, Joseph Kabila a fait pression sur la Monuc et sur Swing pour qu’ils changent leur position intenable, pour qu’ils reconnaissent que le Congo doit recouvrir sa pleine souveraineté et indépendance.
Et la « communauté internationale » est arrivée à la conclusion que le Congo n’acceptera jamais la domination du Rwanda kagamiste. Swing et la Monuc ont été obligés à s’engager pour la défense de l’indépendance et de la souveraineté de la R.D.C. et à dénoncer la présence de l’armée rwandaise, quel que soit le prétexte utilisé.
Les Etats-Unis et la France ont ordonné à Kagame de cesser ses aventures en RDC…
Des jusqu’à-boutistes comme Kunda se sont encore lancés dans des aventures, mais ils n’avaient plus d’avenir. Bientôt ils se trouveront devant le tribunal…
La crise de Bukavu a eu des répercussions profondes à long terme.
Cela a été un tournant : Swing et la Monuc ont été obligés à s’engager désormais pour la défense de l’indépendance et de la souveraineté de la R.D.C. et ils dénonceront la présence de l’armée rwandaise, quel que soit le prétexte utilisé par Kagame.
7. La crise de Kanyabanonga et l’échec total de l’occupation génocidaire rwandaise au Congo
Kanyabayongo, une cité de 30.000 habitants, est situé sur l’axe stratégique Butembo-Goma, dans la province du Nord-Kivu, province convoitée par l’expansionniste Kagame. C’est sans doute la région qui a le plus souffert de l’agression et de l’occupation rwandaise.
La crise de Kanyabayonga en août – décembre 2004 a marqué l’échec total de la stratégie de Kagame et du RCD. C’est le dernier grand tournant de la guerre d’agression, commencée six années auparavant, le 2 août 1998.
L’agression et les tueries de fin 2004 à Kanyabayonga ont poussé la fameuse « communauté internationale » à décider que l’aventure sanglante de Kagame au Congo a trop durée.
Cette même « communauté internationale » avait encouragé et soutenu en 1998 les agresseurs rwandais et ougandais. Mais ces derniers ont commis trop de dégâts irréparables. Washington aussi bien que Paris ont pris leur distance par rapport à une entreprise désormais condamnée irrémédiablement à l’échec…
2002 : Le RCD éclate. C’est le début de la fin…
En fait, la crise finale de la « rébellion » avait commencé en 2002 avec l’éclatement du RCD, le mouvement « rebelle » le plus fort, inféodé au Rwanda.
En avril 2003, le RCD-Goma a lancé une offensive militaire contre ses anciens cadres et militants maintenant regroupés dans le RCD-Kisangani/M.L.
Puis des négociations ont conduit à un « Accord de Bujumbura » qui attribuait Kanyabayonga au RCD-K/ML… Mais le RCD-Goma et les milices de Serufuli ont gardé le contrôle militaire de la cité. Et les assassinats, pillages et viols massif de la part du RCD-Goma ont continué…
A Kibirizi, les militaires du RCD-Goma sont venus la nuit brûler les maisons et beaucoup d’habitants ont péri dans les flammes…
Le 28 août 2004, les autorités de Beni et Lubero ont à leur tour rompu avec les autorités du RCD-Goma. C’était une réaction à la déclaration de Ruberwa demandant l’arrêt du processus de Transition…
A Butembo, le major Akulema avait réussi à faire régner la sécurité dans la ville. Akulema a été suspendu par la direction du RCD. La population a exigé sa réhabilitation…
En octobre 2004, le président de la Société civile du Nord-Kivu, Jason Luneno Maene déclare : «Chaque soir il y a crépitement des armes et des assassinats chaque nuit dans la ville de Goma. » « Nous estimons que le gouvernement doit prendre ses responsabilités pour permettre à la population de sentir que la ville de Goma et le Nord-Kivu font partie intégrante de la RDC. »
Le 11 octobre un certain Funzi Eba fait sur Raga FM des déclarations incendiaires contre le commandant de la région militaire Obedi Rwibasira. Funzi Eba venait de renter du Rwanda où il a suivi une formation idéologique…
Le 10 et 11 octobre 2004 des centaines d’élèves descendent dans les rues de Kanyabalonga pour protester contre le nouveau cycle de crimes contre la population civile, commis par l’armée du RCD et la « Local Defense » de Serufuli. Un tiers de la population de Kanyabayonga se joint aux jeunes.
La manifestation est farouchement réprimée, des dizaines de jeunes sont arrêtés et torturés, des viols collectifs de 150 femmes sont commis par les milices pro-Kagame.
Les jeunes étaient accusés de sympathie pour le RCD-Mouvement de Libération, rival du RCD-Rwanda. Kanyabayongo se situait dans la zone contrôlée par les « rebelles » du RCD /Mouvement de Libération…
Le 30 octobre 2003, le chef de la Monuc lui-même, William Swing, facilite une réunion entre Serufuli du RCD-Goma et Eric Paluku pour le RCD-ML.
Au même moment, l’agence MISNA et la BBC affirment que des militaires rwandais ont passé la frontière et que 4.000 soldats infiltrés se trouvent dans la plaine de la Rutshuru.
Même Ruberwa se sent obligé de déclarer : « Si les troupes rwandaises sont entrées au Congo, je me dois de le condamner. Sans le consentement des autorités congolaises, (!) il n’est pas acceptable que des troupes rwandaises pénètres au Congo. »
Quant à Kagame, il relance son éternel prétexte pour agresser le Congo : « A chaque fois que les Nations Unis échouent à désarmer les Interahamwe, nous le faisons nous-mêmes. »
Mais qui ignore que l’armée de Kagame a été le maître absolu du Kivu d’août 1998 à 2003 et qu’elle n’a pas pu éliminer les Interahamwe !
Le ministre de la Coopération et ancien chef « rebelle » Mbusa Nyamwisi déclare : « Les Rwandais sont entrés. Ils n’ont pas franchi la frontière à travers les routes principales, mais ils sont partout. Les Rwandais brûlent des villages avec une sévérité jamais vue. »
De nombreuses sources indiquent que des milliers de soldats rwandais sont présents à Rutshuru, Walikale et Masisi. Ils opèrent en alliance avec les ex-éléments du RCD-Goma et les « dissidents » de Laurent Nkunda.
L’armée nationale récupère le Nord Kivu, longtemps occupé par Kagame
Le 29 novembre 2004, Joseph Kabila affirme que l’armée nationale, chassée depuis août 1998 de la région, y reviendra. Il annonce aux ambassadeurs des pays permanents du Conseil de Sécurité : « Les troupes gouvernementales seront bientôt déployées dans le Nord-Kivu. » Le Nord Kivu était la principale base pour les provocations et les aventures militaires de Kagame au Congo.
Même Londres, l’allié traditionnel du RCD et de Kagame, déclare : « Nous sommes très occupés par les informations selon lesquelles le Rwanda envisage une incursion en RDC. Toute incursion militaire pourrait avoir de sérieuses implications pour toutes les parties impliquées" .
Le « Comité International pour l’Accompagnement de la Transition » de Swing, fait une déclaration capitale : il souligne la nécessité « pour tous de respecter le caractère inviolable de la souveraineté nationale et l’intégrité territoriale de la RCD ; … Le CIAT condamne toute action, de l’intérieur ou de l’extérieur, visant à déstabiliser le processus de la Transition. »
Swing annonce, en fait, que ni les Etats-Unis, ni l’Union Européenne permettront que la Transition au Congo, piloté avec beaucoup de tact et d’habilité par le Président Kabila, soit mise en échec par les forces du mal…
Mamadou Bah de la MONUC déclare : « Nous avons de plus en plus d’indications corrobées de la présence de troupes rwandais au Congo. » M’Hand Djalouzi, responsable des casques bleus de Goma, affirme : « Ce phénomène d’infiltration prend une toute autre dimension, l’allure même d’une invasion. »
Entre-temps la barbarie du RCD continue. Le porte-parole de la MONUC à Goma, Jacqueline Chenard, déclare que des soldats rwandais sont passés sur l’axe de Rutshuru à Kanyabayonga. Des villages ont été brûlés aux alentours de Lusamambo. Il y a 5.000 déplacés.
En Ituri, Thomas Lubanga, l’allié de Bemba, reçoit des armes lourdes et légères de la part de Kigali.
Des fractions du RCD rejoignent le camp de la Patrie, le front Rwanda-Ouganda éclate.
Depuis que Ruberwa a suspendu la participation aux institutions de la Transition, des divergences profondes ont éclaté au sein du RCD. Maître Mudumbi est suspendu de ses fonctions en qualité de ministre.
Les crimes commis sous l’instigation de Kagame et Ruberwa choquent les Congolais engagés dans l’aventure criminelle de et son RCD. Le Potentiel du 7 décembre 2004 écrit : « Des députés et sénateurs du RCD ont élevé une vive protestation contre l’attitude du Rwanda. Ils déclarent : ‘Les événements en cours dans l’Est de notre pays ont un objectif multiple, entre autre de retarder le processus de Transition.»
Une nouvelle crise est déclenchée au sein du RCD…
Des cadres du RCD participant aux institutions de la Transition, comme le ministre de la défense, sont engagés dans la guerre contre les troupes rwandaises et rebelle. Ondekane déclare : « Des unités des FARDC basées à Beni, Butembo et et Lubero, ont commencé à se déplacer vers Masisi et Rutshuru où des combats ont eu lieu ces derniers jours. »
Une fois de plus, il est prouvé que la justesse de la tactique définie par le Président le 26 janvier 2001, est correcte : il faut le dialogue et la réconciliation entre Congolais pour mettre fin à l’occupation et pour instaurer un pouvoir légitime via des élections libres…
Pour isoler le Rwanda, l’ennemi principal, le Président Joseph Kabila s’est rapproché de l’Ouganda. Deux ministres, anciens rebelles, Ondekane de la Défense et Busa Nyamwisi de la Coopération, ont rencontré des responsables de la sécurité ougandaise à Kasese.
Puis le journal « East African » rapporte que, le 2 décembre, le ministre de la Défense ougandais, Amama Mbabazi et le Commandant de l’armée, Aronda Nyakairima, ont visité Kinshasa. Ils ont parlé de la sécurité régionale. Le « Monitor » ougandais écrit que le Rwanda pourrait ne pas apprécier la possibilité d’une alliance entre le Congo et l’Ouganda…
Lola Kisonga, porte-parole du RCD et ministre du Travail, fait une déclaration le 14 décembre dans laquelle il regrette les affrontements entre des troupes gouvernementales envoyées de Beni sur décision du Conseil Supérieur de la Défense et des forces de la 8e Région militaire stationnées à Kanyabayonga. Lola Kisonga parle d’une « mutinerie » et « condamne l’insubordination par les éléments de la 8e région militaire».
La MONUC dénonce les agressions rwandaises
Une commission d'enquête de la MONUC envoyée à Walikale a finalement recueilli des éléments qui confirment l'implication de troupes rwandaises dans les attaques menées début décembre contre des villages au nord de Goma. La Commission écrit : " Les assaillants, décrits comme des Tutsis rwandais, ont mené une série d'opérations dans les localités d'Ikobo, Nuruti et Kanyabayonga, détruisant 4 villages et 2 autres partiellement, ils ont tué 8 civils, enlevé 30 habitants et forcé 5.000 personnes à se déplacer".
La Monuc "a multiplié ses missions de vérification sur toute l'étendue du Nord Kivu. Ces missions ont confirmé que les soldats mutins ont bien reçu des armes et des renforts en provenance de l'extérieur de la RDC".
William Swing, chef de la mission de l’ONU au Congo, dit au Financial Times : "Il est clair que des armes ont été introduites dans cette région. Il y a également des preuves que des troupes étrangères sont entrées au Congo, après que le Rwanda avait fait ses menaces de renvoyer ses soldats dans le pays."
Mamadou Bah, porte-parole de la Monuc, a ajouté: "Ce n’est plus un secret : nous parlons du Rwanda”.
Le Président Joseph Kabila est intervenu fort à propos dans cette dernière grande crise. Il déclara : « Bénéficiant de la complicité d'une partie de l'ex-rébellion congolaise, les troupes rwandaises n'ont jamais définitivement et totalement quitté le territoire congolais. Leur présence était masquée par la confusion entretenue délibérément entre les Congolais dits rwandophones et les Rwandais. Seulement, avec l'extension de l'autorité de l'Etat sur l'ensemble du territoire, cette présence ne pouvait plus être dissimulée.
Les Rwandais ont toujours nourri des appétits territoriaux sur la RDC. Ils ont toujours rêvé d'annexer la province du Kivu. Dans le contexte actuel, l'agression rwandaise vise d'abord à perturber, jusqu'à son échec, le processus de transition en RDC. Les Rwandais craignent les retombées de la réussite de cette transition sur la politique interne du Rwanda. L'intervention rwandaise en RDC est aussi motivée par l'exploitation des richesses naturelles de notre pays.
Il appartient donc à la communauté internationale prendre ses responsabilités et au peuple congolais s’assumer en vue de faire respecter sa souveraineté. »
Parlement Européen : dénonciation catégorique de l’agression rwandaise:
Fin décembre 2004, le Parlement Européen fait une déclaration capitale, qui revient à un soutien total à la politique suivi avec constance par Joseph Kabila.
Le Président demandait depuis le 26 janvier 2001 le départ des troupes d’agression et d’occupation, le dialogue et la réconciliation entre les Congolais ainsi qu’une transition consensuelle, inclusive qui doit aboutir à des élections libres et démocratiques…
Voici des extraits de la Déclaration du Parlement européen:
« Le Parlement européen, …
B. considérant que … les troupes rwandaises sont à nouveau entrées, pour la troisième fois en dix ans, en République démocratique du Congo, …
E. considérant que la RDC lutte pour se relever de six ans d'un conflit dévastateur qui a fait plus de trois millions de morts,
F. considérant que la RDC se trouve dans une phase de transition extrêmement délicate, avec la tâche difficile de mettre en place des institutions viables, et soulignant que la coopération de toutes les parties concernées est indispensable,
G. considérant que la présence de forces armées rwandaises issues du pouvoir déchu en 1994, sert de prétexte depuis dix ans à la présence en RDC des troupes de l'actuel pouvoir rwandais,
1. condamne l'action militaire unilatérale du Rwanda et demande le retrait immédiat et inconditionnel de ses troupes du territoire congolais; …
3. demande au gouvernement du Rwanda de respecter l'intégrité territoriale de la RDC;…
13. demande au Conseil de sécurité des Nations Unies d'infliger des sanctions à l'encontre des personnes dont la participation au pillage des richesses aurait été avérée, ainsi que de toute personne remettant en cause par son action le processus de paix; …
14. demande le respect du calendrier électoral afin que les Congolais puissent choisir librement et démocratiquement leurs dirigeants; » …
Ainsi, même les puissances européennes qui ont soutenu l’agression rwando-ougandaise du 2 août 1998 pour éliminer Mzee Kabila, ont finalement dû reconnaître la réalité de l’agression-occupation du Congo.
Dans la Déclaration du Parlement européen, tout l’essentiel est dit.
L’agression et l’occupation du Congo par les troupes kagamistes, est dénoncée sans nuance.
Le prétexte de « la présence de Interahamwe au Congo » est rejetée.
Kagame est sommé de respecter l'intégrité territoriale du Congo.
Le génocide congolais est reconnu.
Les Rwandais et Ougandais qui ont pillé au Congo, seront punis.
Personne ne pourra remettre en cause le processus de paix.
Les élections doivent avoir lieu selon le calendrier fixé de façon concertée par la RDC et la Communauté internationale.
La conclusion est claire : Joseph Kabila est en train de réaliser tous les objectifs qu’il s’est fixés dans son discours d’investiture, le 26 janvier 2001.
Joseph Kabila, candidat aux élections présidentielles, est le seul à avoir fait ses preuves dans la lutte pour l’indépendance du Congo, et dans la lutte pour la paix et de la réconciliation nationale.
Quel bilan Bemba peut-il lui opposer ?
Lors de la guerre d'agression, Bemba est devenu un agent de l'armée ougandaise dans le but de mettre les mains sur les richesses immenses de la Province orientale et particulièrement de l’Ituri.
L’Ouganda a livré trois guerres dans la ville de Kisangani contre ses rivaux rwandais. Des parties entières de la ville ont été détruite !
Depuis lors, l’Ouganda a été formellement et définitivement condamné par le Tribunal International. Kampala devra payer entre 6 et 10 milliards de dollars pour tous les dommages causés au Congo !
Mais Bemba a osé déclarer le 2 mai 2001: "Je félicite les Ougandais pour avoir sacrifié leurs vies, leur matériel, pour entraîner mon peuple. Les Congolais sont fiers des Ougandais".
Les services des Nations Unies ont de volumineux dossiers en charge de Bemba.
Le 16 janvier 2003, différentes agences ont repris cette information capitale provenant des Nations Unis. "Un rapport de la MONUC a mis en lumière d'horribles crimes - cannibalisme, exécutions sommaires, viols et pillages systématiques - commis en Ituri à partir d'octobre 2002 par les troupes du MLC de Jean-Pierre Bemba, soutenues par les hommes de Roger Lumbala, chef du RCD-National et de Thomas Lubanga, leader de l'Union des Patriotes Congolais (UPC) ». Ce dernier est déjà arrêté et mis en prison en Hollande en attendant son procès. Bemba sait ce qui l’attend.
Le Haut Commissaire de l'ONU aux Droits de l'Homme Sergio Vieira de Mello, a également fait allusion aux actes de cannibalisme commis en Ituri par les troupes du MLC de Jean-Pierre Bemba. "Les cas d'anthropophagie sont particulièrement répugnants. C'est justement pour cette raison que je lance un appel afin que tous ceux qui sont impliqués dans cette barbarie soient au plus vite punis par des sanctions" a-t-il souligné.
Quand le Commissaire aux Droits de l’Homme de l’ONU appelle à punir au plus vite ceux qui sont impliqués dans les crimes barbares, Jean-Pierre Bemba sait que la prison l’attend !
Ensuite le leader du MLC a été traduit devant la Cour Pénale Internationale (CPI) par la Fédération des Ligues de Droits de l’Homme. Bemba est accusé avec Ange-Félix Patasse pour les crimes dont leurs hommes se sont rendus coupables vis-à-vis des Tchadiens et des Centrafricains lors du coup d’état du général Bozize en octobre 2002. Les Centrafricains ont des dossiers solides sur les tueries et les pillages commis par les bandes de Bemba. Ce dernier avait envoyé sa milice à Bangui pour y occuper et piller la Banque Centrale crime jamais vu dans l’histoire africaine !
Les principaux collaborateurs de Bemba au début de sa « rébellion » l’ont quitté et ont dénoncé ses crimes, ses vols et ses pillages. Selon eux, avec Bemba, le Congo risque de plonger dans un mobutisme pire que sous Mobutu Sese Seko.
Au début du MLC, le colonel Karawa, ancien de la Dsp, a été le bras droit militaire de Bemba. Ayant rompu avec Bemba, il a déclaré en mars 2003 ceci sur son ancien chef. "Des sources très proches de Bemba, estiment à plus de 30 millions de dollars la fortune qu'il a tireé de la rébellion. C'est un véritable chef mafieux déguisé en homme politique qui a gardé tous ses réflexes de commerçant et qui n'hésite pas une seule seconde à les mettre en application pour en tirer profit. Il vit dans un environnement qui lui permet de s'enrichir sans partage. Bemba est un petit dictateur en puissance dans la jungle de l'Equateur."
Le Président Joseph Kabila a été la cible de campagnes mensongères virulentes. Mais il ne s’est jamais laissé provoquer, refusant de répondre à ces bassesses. Il ne voulait donner aucun prétexte à ses adversaires pour troubler la transition et « éviter » ainsi les élections…
Lors du premier tour des élections présidentielles, Joseph Kabila a obtenu 45 pour cent, loin devant Bemba qui en obtint 20 %. Mais le phénomène le plus inattendu de ce scrutin est le score de 13 % du vieux combattant Antoine Gizenga. Ce sont des voix conscientes, non gagnées par l’argent, mais par des dizaines d’années de travail militant. Cela porte le nombre de voix nationalistes, Kabila et Gizenga confondus, à 58 %. Les forces nationalistes et patriotiques sont largement majoritaires en R.D.C.
Le peuple congolais a montré par ce scrutin qu’il est reconnaissant au Président Joseph Kabila pour ses efforts inlassables pour la paix, la réconciliation, l’indépendance et la démocratie agissante où le peuple devient le maître réel de son destin.
Le peuple nationaliste et patriote confirmera au deuxième tour le camarade Joseph Kabila comme Président pour qu’il puisse achever son œuvre de paix, d’indépendance et de reconstruction.
(*) Basé sur un article de Joachim DIana du 29 juin 2006.
TRADITION ARISTIQUE UNIQUE
l'Art Vestimentaire d'Afrique Précoloniale
L’Imitation Occupe Quelle place dans l’Art ? En Europe, Au XVII ème siècle, chaque famille noble avait son artiste attitré. Le peintre n’était qu’un artisan auquel on passait la commande de portraits, un tâcheron dont les œuvres étaient jugées à son aptitude à copier des sujets réels. Un bon portrait devait être conforme à l’original, sans toutefois en accentuer trop les défauts. Dans ce contexte, l’idée que l’art se doit d’imiter la Nature va plutôt de soi. La figuration de la Nature est un passage obligé pour l’art. Ne trouve-t-on pas dans la sculpture grecque des moulages de taureau où il semble bien que les « artistes », se sont contentés de jeter un animal dans de l’argile pour faire le moule ? Mais qu’est-ce que le résultat de ce travail, si ce n’est de l’imitation pure et simple ?
Notre idée postmoderne de l’art met tellement en avant le caractère original, personnel et subjectif de l’œuvre d’art, qu’il nous répugne de penser que l’art doive se contenter de copier des sujets naturels. D’ailleurs, le goût ambiant se détourne d'emblée de ce qui est figuratif et réaliste et privilégie dans l’art justement ce que l’on ne trouve pas dans la nature. Le sens commun postmoderne a plutôt tendance à voir dans l’art une sorte de décoration originale. Seulement, même ainsi, on ne se débarrasse pas si aisément de l’idée de l’imitation. Elle subsiste encore comme imitation de l’art par l’art. Après tout, à y regarder de plus près, les artistes se copient très souvent les uns les autres.
Il semble difficile d’évacuer entièrement la notion d’imitation de la création artistique. La justification de l’imitation n’est pas simple. Toute la question est de savoir quelle place occupe l’imitation dans l’art ? L’imitation dans l’art pose déjà problème en tant qu’imitation de la Nature. Le reproche des modernes aux anciens a souvent été formulé ainsi : à quoi bon copier à tour de bras la Nature, comme tant de sculpteurs et de peintres l’ont fait ?

TRADITION ARISTIQUE UNIQUE
En afrique, c'était au temps où le Nganga, le grand féticheur, fixait sur des statuettes des matériaux de toutes sortes pour en faire des objets de culte animiste. Les marchands et voyageurs qui pour la première fois se rendirent en Afrique noire au XVlIème siècle, découvrirent d'étranges statuettes aux visages crispés ou douloureux, stupéfaits ou surpris complètement intériorises, quelques-unes donnant l'impression que le mouvement de vie s'était brusquement arrêté. Découvertes d'autant plus hallucinantes qu'elles ne ressemblaient à non de ce qu'on pouvait voir ailleurs, à aucune esthétique connue comme si elles avaient surgi du néant.

C’est sans doute cette impréssion de jamais vu et la forte expressivité de ces idoles qui ont troublé jusqu'au plus profond d'eux-mêmes ces marchands en règle avec leur conscience, si l'on peut dire. Les adjectifs ne manquent pas pour décrire ces statues d'un autre âge. Il est évident, au premier coup d’œil qu’il ne s'agit pas là de pièces decoratives. La violence des traits de ces formes sculptées dans le bois ou le fer crée chez celui qui les regarde avec l'angoisse. Une angoisse qui peut aller jusqu’à la peur, à croire que dans la confrontation entre l’objet et le spectateur, ce soit l'objet qui prend le dessus, gouverne le spectateur, prend en quelque sorte Possession de lui on retrouve des renets de cette idée de possession dans un des meilleurs textes de l'écrivain Jean Genêt : L'atelier d'Alberto Giacometli.
Figés de stupeur devant ces créations violentes, ces totems magiques, certains collectionneurs, par la suite, cachèrent ces statues quelque part dans leur cave ou les dépouillèrent de leurs inquiétants oripeaux. Ces éléments qui leurs paraissaient surajoutés, au masque, à la tête ou à la statuette d'allure pygmée, furent bizarrement enlevés afin de les rendre acceptables, c'est-à-dire de les intégrer dans une collection. Miroirs, peaux, plumes furent arrachés du corps des idoles.
Or ce sont justement ces éléments essentiels que le nganga le grand féticheur, fixait sur ces étranges objets pour parachever l'oeuvre du sculpteur. Tout ce matériel perdu aujourd'hui appartenant à ces objets de culte, servait en fait a les imprégner d'une force magique, a les doter d'une vie propre. Longtemps on a refusé d'évoquer ces objets africains qui, avant de devenir des objets d'art aux yeux des Occidentaux, s'intégraient à la vie des peuples qui les fabriquaient et les gardaient jalousement. Beaucoup furent brûlés par les missionnaires qui avaient peut-être senti, leur pouvoir incantatoire. Ces têtes aux lignes abstraites étaient destinées à capter la force vitale des ancêtres au bénéfice du membre du groupe. Il s'agissait de tisser un lien entre le monde des vivants et cet autre monde qui est celui des morts.
Un auteur, dans ses livres fondamentaux, écrit qu'aux époques des grands sacrifices organisés par l’intermédiaire des divins, des objets sont fichés dans le sol afin d'être en règle avec les puissances de l'au-delà. Ce lien avec l'au-delà se retrouve tout au long de l’histoire africaine et même précédemment dans la vieille Egypte avec Le livre des morts des anciens Egyptiens, incantations aux rythmes musicaux solennels et graves permettant au défunt de diriger sa vie posthume. Ce qui confère aux obets cultuels africains du Musée Dapper un côté à la fois brut et très pensé, lointain et mystérieux, c'est qu'on les imagine façonnés par la foudre, par une puissance exceptionnelle. Il n'est pas facile d'assigner un rôle particulier à ces statuettes au regard fixe ou aux yeux vides. Elles appartiennent dirait-on à d’autres royaumes.

Dans un livre profond et intelligent paru ces jours-ci aux éditions Payot, intitulé : Logiques métisses. Anthropologie de l'identité en Afrique et ailleurs, l'auteur écrit par exemple, à propos du culte des ancêtres politiques, que « les fétiches royaux se nommaient Nangoloko et Makungoba et qu'ils étaient situés dans les villages importants de la zone centrale du royaume. Mais ce que l'on sait moins, c’est que ces fétiches ou leurs surgeons se trouvaient également dans les provinces périphériques, celles qui n'étaient soumises que de façon très proche du village ». Le rôle joué par ces objets n'a rien de commun avec celui qu'on assigne aux monuments. Ce sont des objets de pouvoir destinés à asseoir l'autorité d'un chef. Les marchands qui ont négocié ces statues, qui les ont embarqués en Europe sans « mode d'emploi », sans écrits les authentifiant ou spécifiant leur origine, les ont considérés comme des reliquats de peuples primitifs sans histoire aucune. A les examiner maintenant au Musée Dapper, fragments chargés d'histoire, arrachés à des civilisations indéchiffrables, on ressent presque physiquement leur puissance d'envoûtément.
La Force Dynamique de la Création.
On se fait la réflexion que si l’art africain a été pour un ensemble de peintres et de sculpteurs un levain (Picasso, Germaine Richier, Brancusi, quelques autres encore) il aura manqué à ces artistes la flamme qui marque la création d'une force dynamique. Objets d'art, certes, mais sans vie, à l'exemple de ces grands coquillages vides aux couleurs pâles. Statuettes d'ancêtres au regard ébloui par un ciel incandescent, du Zaïre ou du Congo, masques mortuaires du Libéria, statues Nkisi au regard scrutateur à l'image des statues de l'Ile de Pâques contemplant la vastitude, statuettes Nkisi-Nkonde cernées de clous, « tireurs de langue » ou singes accroupis, tous portent en eux le foyer rouge d'une histoire qui nous est dérobée, statuettes prêtes à dire le mot définitif, apparitions nocturnes pour exprimer la parole suprême. Quant aux figures du Gabon ou du Mali, elles possèdent cette intériorité propre aux masques africains.
S'il fallait à tout prix leur trouver un prolongement aujourd'hui ce serait sans doute dans la forme d'un certain jazz, celui des grands saxos de l'époque Parker, Lucky Thompson, Coltrane. Puissants, agressifs, vivants, creusant une mélodie jusqu'à la racine, ramassés à l'intérieur du motif (l'aspect extérieur n'étant que la mélodie) ces saxophonistes expriment joie et douleur mêlées. Ces variations à nulles autres pareilles sont peut-être l'ultime aboutissement de ces masques à la fois tragiques, clos sur eux-mêmes, distillant une douce ironie.
On imagine les multiples réflexions que pourront se faire les visiteurs devant cette richesse inestimable d'une quarantaine d'objets africains empruntés aux principaux musées d'Europe. Signalons pour finir l'album publié par la Fondation Dapper : Objets Interdits, reproduisant tous les objets exposés. Les photos sont superbes. On lira aussi les présentations « De la curiosité à l'art », « De l'indicible à l'œuvre », d'une très grande qualité. On trouvera également dans l'album la Description de l'Afrique d'O. Dapper, fac-similé de l'édition française de 1686, imprimée à Amsterdam. Mais au fait qui était Olfert Dapper ? Un humaniste hollandais qui fit œuvre utile pour l'histoire de l'Afrique tout en demeurant parfaitement neutre à l'égard des pays concernés.
On puisera dans Description de l'Afrique de précieux renseignements introuvables ailleurs. Olfert Dapper a eu accès à des témoignages oraux et à des manuscrits aujourd'hui perdus, en particulier pour le Congo avec le Loango. Expressions inquiètes ou expressions d'extase, les statuettes exposées à la curiosité du public sont comme autant de pièges pour l'autre. On s'y sent happé, on y tombe, on veut s’en déprendre.
Ceux qui ont possédé ces statuettes l'ont compris d'où les oubliettes dans lesquelles elles ont été précipitées par leurs propriétaires. On songe alors à cette phrase de Georges Bataille : « J'écris pour qui, entrant dans mon livre, y tomberait comme dans un trou, n'en sortirait plus ». Cette idée de capture fut peut-être la fonction première de ces extraordinaires sculptures.
DECLARATIONS DESTINÉES A JUSTIFIER LA DESTRUCTION DE L'AFRIQUE!
Déclarations destinées à justifier la destruction de l’Afrique !
LA DESTRUCTION DE L’AFRIQUE S’APPUIE T-ELLE SUR UNE IDÉOLOGIE CELLE DU RACISME, L'ANTIANIMISME ET DU COLONIALISME ?
1 - Coloniser pour doper l’économie :
"J’étais hier dans l’East-End (quartier ouvrier de Londres), et j’ai assisté à une réunion de sans-travail. J’y ai entendu des discours forcenés. Ce n’était qu’un cri. Du pain ! Du pain ! Revivant toute la scène en rentrant chez moi, je me sentis encore plus convaincu qu’avant de l’importance de l’impérialisme... L’idée qui me tient le plus à coeur, c’est la solution au problème social : pour sauver les quarante millions d’habitants du Royaume-Uni d’une guerre civile meurtrière, nous les colonisateurs, devons conquérir des terres nouvelles afin d’y installer l’excédent de notre population, d’y trouver de nouveaux débouchés pour les produits de nos fabriques et de nos mines. L’Empire, ai-je toujours dit, est une question de ventre. Si vous voulez éviter la guerre civile, il faut devenir impérialiste."
Extrait du journal Neue Zeit de Cécil Rhodes, Premier ministre du Cap, 1898.
2 - Coloniser pour voler les richesses de l’autre :
"La nature a distribué inégalement, à travers la planète, l’abondance et les dépôts de ces matières premières ; et tandis qu’elle a localisé dans cette extrémité continentale qui est l’Europe le génie inventif des races blanches, la science d’utilisation des richesses naturelles, elles a concentré les plus vastes réservoirs de ces matières dans les Afriques, les Asies tropicales, les Océanies équatoriales, vers lesquelles le besoin de vivre et de créer jettera l’élan des pays civilisés. L’humanité totale doit pouvoir jouir de la richesse totale répandue sur la planète. Cette richesse est le trésor commun de l’humanité."
A. Sarraut, Grandeur et servitudes coloniales, 1931.
3 - Coloniser au nom de Dieu
"Nous avions jadis, par de précédentes lettres, concédé au Roi Alphone, entre autres choses, la faculté pleine et entière d’attaquer, de conquérir, de vaincre, de réduire et de soumettre tous les sarrasins (nègres), païens et autres ennemis du Christ où qu’ils soient, avec leurs royaumes, duchés, principautés, domaines, propriétés, meubles et immeubles, tous les biens par eux détenus et possédés, de réduire leurs personnes en servitude perpétuelle (...) de s’attribuer et faire servir à usage et utilité ces dits royaumes, duchés, contrés, principautés, propriétés, possessions et biens de ces infidèles sarrasins (nègres) et païens (...) Beaucoup de Guinéens et d’autres Noirs qui avaient été capturés, certains aussi échangés contre des marchandises non prohibées ou achetés sous quelque autre contrat de vente régulier, furent envoyé dans les dits Royaumes (Amérique, Antilles...)".
Extrait de la Bulle papale du Pape Nicolas V, 8 janvier 1454
4 - Coloniser au nom de la providence :
"Messieurs, La providence nous a dicté l’obligation de connaître la terre et d’en faire la conquête. Ce suprême commandement est l’un des devoirs impérieux inscrits dans notre intelligence et dans notre activité. La géographie, cette science qui inspire un si beau dévouement et au nom de laquelle tant de victimes ont été sacrifiées, est devenue la philosophie de la terre."
Déclaration de l’Amiral La Roncière le Noury, au Congrès international de Géographie de Paris, 1875.
5 - Coloniser au nom de la paix :
"Une nation est comme un individu : elle a ses devoirs à remplir et nous ne pouvons plus déserter nos devoirs envers tant de peuples remis à notre tutelle. C’est notre domination qui, seule, peut assurer la paix. la sécurité et la richesse à tant de malheureux qui jamais auparavant ne connurent ces bienfaits. C’est en achevant cette oeuvre civilisatrice que nous remplirons notre mission nationale, pour l’éternel profit des peuples à l’ombre de notre sceptre impérial (...) Cette unité (de l’Empire) nous est commandée par l’intérêt : le premier devoir de nos hommes d’Etat est d’établir à jamais cette union sur la base des intérêts matériels (...) Oui, je crois en cette race, la plus grande des races gouvernantes que le monde ait jamais connues, en cette race anglo-saxonne, fière, tenace, confiante en soi, résolue que nul climat, nul changement ne peuvent abâtardir et qui infailliblement sera la force prédominante de la future histoire et de la civilisation universelle (...) et je crois en l’avenir de cet Empire, large comme le monde, dont un Anglais ne peut parler sans un frisson d’enthousiasme (...) ".
Discours de Joseph CHAMBERLAIN, ministre des colonies en 1895.
6 - Coloniser au nom de la nature humaine :
"La nature a fait une race d’ouvriers. C’est la race chinoise d’une dextérité de main merveilleuse, sans presque aucun sentiment d’honneur ; gouvernez-la avec justice en prélevant d’elle pour le bienfait d’un tel gouvernement un ample douaire au profit de la race conquérante, elle sera satisfaite ; une race de travailleurs de la terre, c’est le nègre : soyez pour lui bon et humain, et tout sera dans l’ordre ; une race de maîtres et de soldats, c’est la race européenne. Que chacun fasse ce pour quoi il est fait et tout ira bien."
Ernest Renan, La Réforme intellectuelle et morale, 1871.
7 - Coloniser au nom de la race blanche :
"En premier lieu je crois en l’Empire britannique, et en second lieu je crois en la race britannique. Je crois que la race britannique est la plus grande des races impériales que le monde ait connues. Je dis cela non comme une vaine vantardise, mais comme une chose prouvée à l’évidence par les succès que nous avons remporté en administrant les vastes possessions reliées à ces petites îles, et je crois donc qu’il n’existe pas de limite à son avenir."
Discours de Joseph Chamberlain (1895), ministre des Colonies de Grande-Bretagne.
- Coloniser au nom de la soumission à l’univers :
"La colonisation est la force expansive d’un peuple, c’est sa puissance de reproduction, c’est sa dilatation et sa multiplication à travers les espaces ; c’est la soumission de l’univers ou d’une vaste partie à sa langue, à ses moeurs, à ses idées et à ses lois. Un peuple qui colonise, c’est un peuple qui jette les assises de sa grandeur dans l’avenir et de sa suprématie future... A quelque point de vue que l’on se place, que l’on se renferme dans la considération de la prospérité et de la puissance matérielle, de l’autorité et de l’influence politique, ou que l’on s’élève à la contemplation de la grandeur intellectuelle, voici un mot d’une incontestable vérité : le peuple qui colonise est le premier peuple ; s’il ne l’est pas aujourd’hui, il le sera demain."
P. Leroy-Beaulieu, De la colonisation chez les peuples modernes, Guillaumin éd., 1870,
8 - Coloniser pour asseoir sa prédominance politique :
"Messieurs, au temps où nous sommes et dans la crise que traversent toutes les industries européennes, la fondation d’une colonie, c’est la création d’un débouché. On a remarqué, en effet, et les exemples abondent dans l’histoire économique des peuples modernes, qu’il suffit que le lien colonial subsiste entre la mère-patrie qui produit et les colonies qu’elle a fondées, pour que la prédominance économique accompagne et subisse, en quelque sorte, la prédominance politique."
Jules Ferry, Discours, 1885.
9 - Coloniser pour se mettre en rapport avec l’autre :
"Coloniser, c’est se mettre en rapport avec des pays neufs, pour profiter des ressources de toute nature de ces pays, les mettre en valeur dans l’intérêt national, et en même temps apporter aux peuplades primitives qui en sont privés les avantages de la culture intellectuelle, sociale, scientifique, morale, artistique, littéraire, commerciale et industrielle, apanage des races supérieures. La colonisation est dont un établissement fondé en pays neuf par une race avancée, pour réaliser le double but que nous venons d’indiquer."
Merignhac, précis de législation et d’économie coloniales.
10 - Coloniser : une affaire d’argent :
"Il ne faut pas se lasser de le répéter : la colonisation n’est ni une intervention philosophique, ni un geste sentimental. Que se soit pour nous ou pour n’importe quel pays, elle est une affaire. Qui plus est, une affaire comportant invariablement à sa base des sacrifices de temps, d’argent, d’existence, lesquels trouvent leur justification dans la rémunération."
Rondet-Saint, La Dépêche coloniale, 1929
HISTOIRE DE KIMPA NVITA ALIAS DONA BEATRICE LA REFORMATRICE AFRICAINE
Action d'information sur des religions et les valeurs spirituelles Africaines exclues, bafouées et réprimées par le système colonial en Afrique.
La prophétesse retrouve la vitalité au Panthéon des Divinités de l'église Animiste de notre Temps.
La Prophétesse Kimpa Vita : Ses adeptes connus sous le nom «Antoniens»
Kimpa Vita, appelée aussi Dona Béatrice, la « Jeanne d'Arc du Kongo » Fondatrice du mouvement messianique des Antoniens, Kimpa Vita avait entendu en rêve saint Antoine lui ordonner de ramener le roi Pedro IV à Sâo Salvador, la capitale du Kongo détruite par la guerre, et de récupérer les insignes royaux détenus par l'usurpateur Jean II. Grâce à l'influence que prit sa secte au Kongo, la prophétesse réussit à ramener le roi dans sa capitale, mais ce dernier ne lui en sut aucun gré, bien au contraire, et la livra aux autorités ecclésiastiques portugaises. Condamnée comme hérétique, Kimpa Vita fut brûlée vive en 1706. Son histoire est inscrite dans les archives missionnaires du Portugal.
Au XVe siècle, les navigateurs européens ont découvert les côtes africaines et des relations commerciales entre les peuples se sont mises en place. Mais, en même temps que les commerçants attirés par le profit, sont arrivés les missionnaires convaincus de faire le bien en convertissant les populations animistes, qui souvent bouleversèrent les coutumes, et parfois les esprits. Kimpa Vita fut victime de ces malentendus provoqués par le choc des cultures.
Après de longs mois en mer, suivis d’une marche éprouvante, le père Lorenzo atteint enfin la destination qu’il s’est fixée : Mbanza Kongo, la capitale d’un vieux royaume situé au centre du mystérieux continent africain. Le Kongo a été découvert en 1482 par le Portugais Diego Cao et, depuis, ses souverains entretiennent des relations commerciales basées sur des échanges de produits divers auxquels les uns et les autres attachent du prix. Le Kongo reçoit des produits manufacturés, tandis que le Portugal importe des esclaves et des denrées exotiques.
Les Mani-Kongo (rois) ont toujours bien accueilli ces étrangers venus par la mer, ils ont accepté leur religion et la présence de leurs missionnaires. L’arrivée du père Lorenzo, en ce mois de septembre 1704, n’a donc rien de surprenant.
La vieille cité, nommée Mbanza Kongo par les habitants du pays et Sao Salvador par les Portugais, est le cœur du royaume, l’endroit où se confrontent la tradition et la modernité. Sa réputation en a franchi les frontières : c’est dans la citadelle, située sur un éperon rocheux, que se déroulent les rites royaux et les cérémonies imposées par la coutume, tandis qu’à ses pieds des maisons, des églises et même une cathédrale rappellent la présence de ces hommes au teint pâle venus de pays lointains.
Saint Antoine est entré dans sa tête et parle par sa voix
Les récits parvenus aux oreilles du missionnaire lui ont fait espérer une prospérité que la ville ne possède plus. Guerres, pillages et incendies ont mis à terre les belles constructions de ce passé glorieux. La broussaille a repris ses droits et, dans ce pays fertile, les lianes et les pousses d’arbres ont soulevé même les matériaux les plus durs pour ne laisser place qu’à des cabanes en terre, en branchages et en palmes, plus vite démolies, mais aussi plus vite reconstruites. Le père Lorenzo est atterré.
Le père Bernardo, tout puissant à la cour et conseiller du Mani-Kongo, va lui donner les explications qu’il attend. Durant trente ans, plusieurs chefs de régions se sont disputés le pouvoir et une succession de petits rois ont mis à mal les ressources du pays. Pedro IV, l’actuel roi du Kongo, pourtant légitimé et reconnu en 1694 par l’ensemble des dignitaires, s’est retiré sur le mont Kibangu, au nord de Sao Salvador, laissant la ville à l’abandon.
La population souffre et les esprits s’échauffent. Ils ont besoin d’espoir, un espoir que semble leur apporter une jeune fille animiste de 20 ans : Kimpa Vita. Baptisée, elle se dit désignée par Dieu pour apporter à son peuple les changements tant attendus. Saint Antoine est entré dans sa tête et parle par sa voix. Il dit : « Un nouveau royaume va naître. Vous devez reconstruire la ville, relever les maisons, redonner à la terre sa fertilité et ses récoltes ». Les adeptes sont nombreux autour de la jeune fille : « Salve, ô Sao Antonio ! Ave Maria ! Kimpa Vita, notre Dona Béatrice va nous sauver. » Un grand mouvement de foules envahit la ville, on crie, on chante, on danse, on pleure. L’émotion est forte parmi tous les malheureux qui sont venus entendre la prophétesse. Et elle, jeune, pure, belle, livre ses inspirations : « Le roi Pedro doit quitter son refuge du mont Kibangu. Qu’il vienne. Nous l’attendons. »
Une Prophétesse Séductrice aux Yeux si Beaux
Chacun doit participer au renouveau. Kimpa Vita, devenue pour tous « Dona Béatrice », illumine son entourage par sa foi et ses prières. Et l’on se prend à espérer, à retrouver l’envie de participer à cette grande ambition que propose la foi chrétienne par l’intermédiaire de sa prophétesse. Parmi les adeptes, un homme grand prêtre animiste l’écoute avec attention. Il pourrait être son père mais il s’est mis à son service car il admire sa beauté, sa force et ses convictions. Kimpa Vita a trouvé en lui un appui. Il est présent lorsqu’elle se retire pour prier. Il l’aide à convaincre. Dona Béatrice le nomme Saint-Jean, du nom du disciple bien-aimé du Christ.
Saint-Antoine les inspire. Il faut que le Mani-Kongo revienne. Et Kimpa Vita prend la tête d’un groupe de fidèles qui se dirige vers la citadelle royale, en priant et en chantant. Saint-Jean est à ses côtés. Tous deux sont persuadés qu’ils vont ramener le roi au sein de sa ville. Le groupe de tête franchit les barrages, et la jeune fille se trouve devant Pedro qui l’accueille avec étonnement. Que veut cette prophétesse si jeune, aux yeux si étranges et si beaux ? Quel est ce destin qu’elle lui offre ? L’unité du royaume retrouvé, le renouveau ? N’est-ce pas un piège tendu par ses ennemis ?
Le père Bernardo n’apprécie pas les déviations du dogme animisme et les sectes qui en découlent. Pour lui, ces « Antoniens » menacent la foi. Kimpa Vita ne dit-elle pas que la terre sainte est le Kongo ? Que le Christ est né à Sao Salvador et que les pères de l’Eglise étaient des Africains ? Bien sûr elle incite à brûler les fétiches, mais aussi la croix du Christ, et elle veut créer une église africaine noachique en écartant les étrangers de l’entourage du roi. Pedro hésite. Va-t-il prendre la tête du grand renouveau que lui propose son peuple ou endosser la méfiance de ses partenaires blancs ? Le roi a besoin d’y voir clair. Il demande une confrontation. Dialogue de sourds entre deux convictions. Pour Kimpa Vita les hommes blancs sont nés de la pierre de savon et les noirs d’une sorte de figuier. Les racines de ce figuier doivent reprendre vie grâce aux enseignements de Saint-Antoine, un Saint Antoine qu’elle incarne et qui manifeste sa volonté de voir le peuple du Kongo s’affranchir de ses liens étrangers. Pour les missionnaires, voilà qui est inacceptable, tout comme est sacrilège la déformation de la religion à laquelle ils assistent. Animisme, Incantations, prières, transes et contorsions, prédictions et chants divers ponctuent les cérémonies de la prophétesse, ralliant autour d’elle de plus en plus de monde.
La « Vierge » Condamnée à Mort
Entre les hommes de la science chrétienne, dont il a besoin pour contrer ses adversaires, et la jeune illuminée aux paroles enflammées, si convaincante soit-elle, le roi mettra deux ans à choisir, deux années durant lesquelles Kimpa Vita construit son église.
Devenue aux yeux de tous Dona Béatrice, elle a acquis un prestige qui menace celui du roi et des missionnaires. « Dieu veut l’intention » clame-t-elle. « Les prières sont des pièges, les cérémonies religieuses des offenses à notre propre église ». On écoute ses propos, on la vénère.
Si elle a disparu un jour de 1705, c’est qu’elle a rejoint Saint Antoine et qu’elle va ressusciter sous peu. Le peuple l’attend. Mais la réalité est autre.
Prophétesse oui, mais femme aussi. La présence du beau « Saint-Jean » à ses côtés, sa fidélité, son dévouement ont fini par concrétiser les liens qui les unissent. La « Vierge du Kongo » se voit contrainte de dissimuler aux yeux de tous le fruit de ces relations coupables. Elle disparaît mais on finit par la découvrir. Belle occasion pour les prêtres de dénoncer l’imposture. Une nouvelle vierge Marie ? Allons donc ! Pour eux Kimpa Vita doit abjurer publiquement ses erreurs. Ils s’en contenteraient mais elle s’y refuse, et le Conseil royal prononce alors une sentence de mort.
Et voilà pourquoi, en ce jour de juillet 1706, deux ans après son arrivée à Mbanza-Kongo, le père Lorenzo assiste à un spectacle qui le remplit de terreur tout autant que la foule amassée sur la grand place de la capitale du royaume. Un bûcher est préparé pour l’hérétique. La prêtresse, son bébé, et son compagnon sont conduits sur le tas de bois et leurs corps sont environnés de flammes. Dona Béatrice, plus de deux siècles après Jeanne d’Arc en France, meurt « avec le nom de Jésus en bouche », écriront les témoins. Mais la jeune Kongolaise a mis l’espérance au cœur de son peuple animiste. Ses adeptes, connus sous le nom d’ Antoniens, affirmeront qu’une belle étoile est apparue sur le lieu du sacrifice et ils continueront à transmettre son message.
L’ancien royaume du Kongo est resté dans la mémoire des habitants qui le peuplèrent jadis et qui, aujourd’hui sont dispersés en Angola et dans les deux Congo ; quant à l’histoire de Kimpa Vita elle a été consignée dans les écrits des missionnaires portugais qui en furent témoins et qui nous l’ont transmise.
Hommage à Kimpa Vita
Son nom en latin Signifie « vie » Rosée du matin Larme de pluie Monte, roule et coule
Sur ma joue Je fixe ce monticule Et j’entends : en joue ! Feu… le bûcher… feu ! Horreur et damnation ! Kimpa ! Est-ce un jeu ? Non, car je perçois le son De ta voix qui s’élève
Au-dessus des flammes Qui sucent ta sève…Femme ô Femme ! Tu as osé faire
Ce qu’aucun homme N’a pu : être Pour le royaume L’étoile brillante De la résistance
C’est pourquoi tu hantes A jamais nos existences…
Pour en savoir davantage : Kaké, Ibrahima Baba : Dona Béatrice, la Jeanne d’Arc congolaise, Ed ABC/NEA 1976 – Balandier, Georges : La vie quotidienne au royaume de Kongo du XVIe au XVIIIe siècle – Hachette, 1965/1992
LEOPOLD SEDAR SENGHOR:LE POEME D'UNE VIE
Léopold Sédar Senghor : le poème d'une vieNé le 9 octobre 1906 à Joal (Sénégal)
Au « Royaume d’enfance »
La naissance de Léopold Sédar Senghor est déclarée le 9 octobre 1906 par son père Basile Diogoye Senghor, lors d’un de ses rares voyages à Gorée. Mais son acte de baptême est daté du 15 août précédent et il pourrait être né une ou deux années auparavant. Ses ancêtres étaient des guerriers d’origine noble et son père est à la fois éleveur, « maître de terre » - c’est-à-dire un féodal -, et traitant avec des commerçants bordelais. Notable fortuné, résidant en dehors des quatre communes de plein exercice, et ne possédant de ce fait pas la nationalité française, chrétien, il a eu cinq épouses dont il aura au moins vingt-cinq enfants ; Léopold Sédar est l’aîné des garçons. Sédar signifie en sérère « celui qu'on ne peut humilier » ou encore « qui n'a pas honte d'être chétif » et Senghor vient du portugais senhor :
« J’écoute au fond de moi le chant à voix d’ombre des saudades.
Est-ce la voix ancienne, la goutte de sang portugais qui remonte du fond des âges ? Mon nom qui remonte à sa source ? Goutte de sang ou bien senhor, le sobriquet qu’un capitaine donna autrefois à un brave laptot ?» (Élégie des saudades)
La maison des Senghor à Joal Léopold Sédar Senghor est né dans cette maison de style portugais, le 9 octobre 1906, selon le registre d'état civil, le 15 août, suivant le registre de baptême. La maison comprend deux ailes où habitaient les femmes de son père avec leurs enfants.
Joal, son lieu de naissance, est situé à une centaine de kilomètres de Dakar. « Joal ! Je me rappelle, Je me rappelle les signares à l'ombre des vérandas Les signares aux yeux surréels comme un clair de lune sur la grève ; Je me rappelle les fastes du Couchant Où Koumba N’dofène voulait faire tailler son manteau royal. Je me rappelle les festins funèbres fumant du sang des troupeaux égorgés Du bruit des querelles, des rhapsodies des griots Je me rappelle les voies païennes rythmant le Tantum Ergo Et les processions et les palmes et les arcs de triomphe Je me rappelle la danse des filles nubiles Les chœurs de lutte – oh ! la danse finale des jeunes hommes, buste Penché élancé, et le pur cri d’amour des femmes – Kor Siga ! Je me rappelle… Ma tête rythmant Quelle marche lasse le long des jours d’Europe où parfois Dans son « Royaume d'enfance », le jeune sérère, pris en charge par son oncle paternel, reçoit une éducation traditionnelle, marquée par une profonde religiosité et l'animisme. « Toko'Waly, mon oncle, te souviens-tu des nuits de jadis, quand s'appesantissait ma tête sur mon dos de patience ? Ou que me tenant par la main, ta main me guidait par ténèbres et signes ? » Il est scolarisé, vers l’âge de sept ans, à la mission catholique de Joal, puis à celle de N'Gasobil en 1914 où il débute l'enseignement secondaire.
Le collège de N'Gasobil près de Joal « J'étais interne à l'École des Pères, à Saint-Joseph de Ngasobil, petit village sénégalais perché sur les falaises, où soufflait l'esprit des Alizés. » (Liberté, I, p. 126) © Archives Gérard Bosio/Reproduction photographique Cornelis van Voorthuizen
Il pense devenir prêtre et enseignant et poursuit ses études durant cinq années à Dakar, au collège-séminaire Libermann tenu par les pères du Saint-Esprit.
Léopold Sédar Senghor (à l'extrême droite) en 1923 au collège Libermann de Dakar Collection particulière © DR
Un affrontement avec le père supérieur le conduit à s’inscrire au cours secondaire public et laïque de la rue Vincens, le futur lycée Van Vollenhoven. Il est reçu aux deux parties de son baccalauréat avec mention et obtient une demi-bourse d’études littéraires.
Photo de classe du collège Libermann à Dakar Collection particulière © DR Du Sine à la Seine En septembre 1928, il arrive à Paris et s’inscrit aux cours du lycée Louis-le-Grand, en hypokhâgne. Il y rencontre de futurs parlementaires et hommes politiques, Georges Pompidou, Aimé Césaire, Robert Verdier, ou écrivains, comme Paul Guth, Robert Merle, Henri Queffelec et Thierry Maulnier.
Plongé dans la lecture et l'étude Collection particulière © DR
Avec Georges Pompidou, il s’engage aux Étudiants socialistes en juillet 1930, attiré par la pensée humaniste de Léon Blum, découvert par la lecture de l’éditorial quotidien du Populaire ; sans véritablement militer. « Pourquoi ne pas le dire ? L'influence de Georges Pompidou sur moi a été, ici, prépondérante. C'est lui qui m'a converti au socialisme, qui m'a fait aimer Barrès, Proust, Gide, Baudelaire, Rimbaud, qui m'a donné le goût du théâtre et des musées. Et aussi le goût de Paris. Je me rappelle nos longues promenades sous la pluie tiède ou dans le brouillard gris bleu. Je me rappelle le soleil dans les rues., au printemps : en automne, la douce lumière d'or sur la patine des pierres et des visages. » (Liberté I, p. 405)
Léopold Sédar Senghor, avec notamment, au premier plan, Pham Duy Khiêm et Georges Pompidou Collection particulière © DR
Trois ans plus tard, en 1931, il s’inscrit à la Sorbonne, où il est désigné à la présidence de l’Association des étudiants ouest-africains. Après un échec en 1934, il est reçu à l’agrégation de grammaire en 1935, alors qu’il accomplit son service militaire, tout d’abord au 150ème Régiment d’infanterie à Verdun, puis à la caserne Lourcine à Paris, où il s’occupe de la bibliothèque. Il est le premier agrégé africain. Deux ans plus tôt, il a obtenu la nationalité française. Nommé en octobre 1935 au lycée René-Descartes de Tours – puis au lycée Marcellin-Berthelot à Saint-Maur-des-Fossés (dans le département actuel du Val-de-Marne), trois ans plus tard – le jeune professeur de lettres milite dans le syndicat des enseignants du second degré et adhère à la SFIO en 1936, dans l’effervescence du Front populaire. Il fréquente aussi les chrétiens de gauche de la revue Esprit.
La négritude, pierre d’angle de la civilisation de l’universel Mais, Senghor joue surtout en cette décennie un rôle important dans l’affirmation en métropole de l’identité négro-africaine, de ce qu’il nomme la conscience de « race ». Avec Césaire [Pour saluer le Tiers Monde, in Ferrements], il participe au redressement du journal des étudiants martiniquais, l’Étudiant noir et se penche sur le problème des rapports entre les deux blocs ethniques. Poète et humaniste, il prône un retour aux sources africaines, se fait le chantre de la « négritude », vocable qu’il invente avec Aimé Césaire et Léon Damas, et du métissage culturel. Il proclame la complémentarité et l’égalité entre Blancs et Noirs, écrivant Ce que l’homme noir apporte, célébrant, après l'américain William E. B. Dubois, son legs au patrimoine commun de l’humanité [Voir : le mouvement de la négritude]. Dans Négritude et Humanisme, il écrit : « Pour nous, notre souci, depuis les années 1932-1934, notre unique souci a été de l'assumer, cette Négritude, en la vivant et, l'ayant vécue, d'en approfondir le sens. Pour la présenter au monde comme une pierre d'angle dans l'édification de la Civilisation de l'Universel. » (Liberté 1, p. 9)
« Ma Négritude point n'est sommeil de la race mais soleil de l'âme, ma négritude vue et vie Ma Négritude est truelle à la main, est lance au poing Réécade. Il n'est question de boire, de manger l'instant qui passe Tant pis si je m'attendris sur les roses du Cap-Vert ! Ma tâche est d'éveiller mon peuple aux futurs flamboyants Ma joie de créer des images pour le nourrir, ô lumières rythmées de la Parole ! »
La guerre, une rupture provisoire La guerre constitue une rupture provisoire dans son itinéraire et le propulse vers de nouveaux horizons politiques. Fantassin de deuxième classe dans un bataillon volant de la coloniale, le 31ème RIC, Senghor est fait prisonnier de guerre le 20 juin 1940, après avoir participé aux combats de la Charité-sur-Loire. En septembre, au camp d'Amiens où il est détenu, il compose A Guélowar (*), inspiré par l'appel du général de Gaulle : « [...] Guélowar ! Ta voix nous dit l'honneur l'espoir et le combat, et ses ailes s'agitent sur notre poitrine Ta voix nous dit la République, que nous dresserons la Cité dans le jour bleu Dans l'égalité des peuples fraternels. Et nous répondrons : Présents, ô Guélowar ! » (*) « Les "Guélowars ou princes", qui descendent des conquérants du pays, sont d'origine mandingue. La tradition indigène attribue la fondation du royaume de Sine, il y a quatre ou cinq siècles, à un nommé Maïssa Waldione. » ( Funérailles royales et ordre de succession au trône chez les Sérères du Sine, par Aujar, dans Bulletin du Comité d'études historiques et scientifiques de l'Afrique occidentale française, 1925.)<
Passant deux ans dans les Front-stalags en France, il rédige Hosties noires en hommage aux tirailleurs sénégalais et anime la Résistance dans son camp ; ce qui lui vaut d’être envoyé fin 1941 en commando de représailles dans les Landes.
Hosties noires. Paris, Éditions du Seuil, 1948
Les poèmes de ce recueil ont été écrits, pour la plupart, en captivité entre juin 1940 et février 1942 ; confiés à un soldat autrichien, ils furent remis à Georges Pompidou. Au-delà de la souffrance des tirailleurs sénégalais, le thème d'Hosties noires est « l'Afrique crucifiée depuis quatre cents ans » : le sacrifice de l'Afrique est assimilé au sacrifice du Christ mort pour sauver les hommes « [...] l'Afrique s'est faite hostie noire Pour que vive l'espoir de l'homme. » Bannissant de son cœur toute haine : « Seigneur Dieu, pardonne à l'Europe blanche ! » le poète achève son recueil par une Prière de paix : « Et donne à leurs mains chaudes qu'elles enlacent la terre d'une ceinture de mains fraternelles DESSOUS L'ARC-EN-CIEL DE TA PAIX. »
Réformé pour maladie en février 1942, il reprend les cours au lycée de Saint-Maur et fréquente la Résistance, par l’intermédiaire du Front national universitaire. Ses idées, qu’il a élaborées à la fin des années trente, mûrissent par la réflexion sur les civilisations méditerranéennes « métisses », menant à une subtile dialectique entre trois éléments, la Négritude, la Voie africaine vers le socialisme et la Civilisation de l’universel. Elles aboutissent à des thèses plus achevées prononcées devant les deux congrès des écrivains et artistes noirs, tenus à Paris en 1956 et à Rome en 1959. En 1944, à l’initiative de Robert Delavignette, Senghor occupe la chaire de langues et civilisations négro-africaine à l’École nationale de la France d’outre-mer. Aussi est-il désigné par le ministre des colonies Marius Moutet pour siéger dans la commission chargée d’étudier la représentation des colonies à la future Assemblée constituante. Alors que paraît un recueil de poèmes, Chants d’Ombre et qu’il participe avec son ami Alioune Diop à la fondation de la revuePrésence africaine, Senghor qui rêve de carrière universitaire hésite, selon son expression, à « tomber dans la politique ».
Présence africaine, n° 1, novembre-décembre 1947 « Donc, à l'égard du peuple noir, trois périodes, trois attitudes ; et nous sommes à la dernière. D'abord, l'exploitation ; puis la condescendante pitié ; puis enfin cette compréhension qui fait qu'on ne cherche plus seulement à le secourir, à l'élever et, progressivement, à l'instruire ; mais aussi bien à se laisser instruire par lui. On découvrit soudain qu'il aurait, lui aussi, quelque chose à nous dire, mais que, pour qu'il nous parle, il importe d'abord de consentir à l'écouter. » (André Gide, Avant-propos au premier numéro de Présence africaine, p. 4)
Mais il subit de nombreuses sollicitations l'invitant à devenir « député de la brousse ». Il se décide lors d’une tournée en pays sérère, premier retour au pays depuis 1937. Élu à l'Assemblée constituante
Senghor se présente aux élections au Sénégal dans le deuxième collège, celui des non-citoyens, pour représenter la région Sénégal-Mauritanie, son camarade socialiste Lamine Gueye, maire de Dakar, briguant le siège de député du premier collège essentiellement représenté dans les quatre communes de plein exercice (Dakar, Gorée, Rufisque et Saint-Louis). Son élection le 21 octobre 1945 ne constitue pas sa première intrusion dans la politique sénégalaise, même s’il a jusqu’alors surtout milité à Tours puis à Paris. Au temps du Front populaire, il a soutenu la candidature de Lamine Gueye contre Galandou Diouf. En rejoignant le maire de Dakar, l’homme fort du socialisme africain qui s’inscrit dans la tradition de Blaise Diagne, il entre dans des réseaux politiques établis et dominants.
La rencontre entre le jeune intellectuel, chantre de l’identité négro-africaine et la SFIO peut paraître paradoxale. Entre le jeune chrétien, nourri de la culture et des traditions africaines, et le socialisme français, anticlérical, rationaliste, assimilationniste et très européocentriste en dépit de son discours laïque et universaliste, le rapport n’est pas évident. La rencontre s’explique par des conjonctions personnelles et intellectuelles. Senghor cherche à marier christianisme, socialisme et marxisme. Et, alors qu’il fréquente par ailleurs la revue Esprit, où il rencontre Jean Rous, il ne nie jamais à la SFIO ses convictions chrétiennes. Métis culturel, Senghor veut concilier l’âme nègre avec le meilleur de la culture européenne, il n’y a pas d’antinomie avec un assimilationnisme qui respecterait les identités. Qui plus est, son itinéraire n’est pas particulier sur ce plan, car les mouvements nègres n’ont pas coupé les liens idéologiques et sentimentaux qui les unissent depuis leur formation au début des années vingt avec la gauche française. Leur objectif est soit une union fraternelle avec la France des Droits de l’homme, soit la synthèse entre lutte des classes et conscience de race. Et, pour quelques-uns dont Senghor, c’est aussi l’émergence d’un humanisme noir, entre le socialisme européen et la tradition nègre. Senghor est élu député socialiste de l’ensemble Sénégal-Mauritanie à la première Assemblée nationale constituante par 15 095 voix, sur 25 188 inscrits et 20 376 votants. Il est nommé membre de la commission des territoires d’outre-mer et surtout entre à la commission de la Constitution en février 1946, succédant à André Philip devenu ministre. Il s’y montre très actif, combattant âprement les thèses du député MRP Viard sur l’Union française, prônant une orientation fédéraliste de l’Union française et intervient régulièrement sur les questions culturelles, défendant les langues locales et le bilinguisme outre-mer. Il accepte un compromis entre ses positions et celle de son parti et des autres forces politiques, accepte une dose d’assimilation en matière politique, mais s’oppose résolument à l’assimilation culturelle et exige que l’Union française soit une démocratie effective. « Nous voulons faire partie de l’Union française, dit-il à la tribune le 21 mars 1946, à cette seule condition que la démocratie ne craigne pas de se mouiller les pieds en traversant la Méditerranée ». Le 5 avril 1946, il est chargé d’un rapport supplémentaire au nom de la commission sur les principaux textes des groupes et sur celui du rapporteur Guy Mollet. Il intervient aussi dans les débats publics sur la déclaration des droits et est désigné comme rapporteur général du chapitre sur l’Union française. Senghor est réélu à la deuxième Assemblée nationale constituante, le 2 juin 1946. Il obtient 20 718 suffrages, sur 28 461 inscrits et est reconduit à la commission de la Constitution. Il intervient à la tribune dans les débats sur la liberté de l’enseignement, sur l’Union française et sur les départements et territoires d’outre-mer. Récusant toute « charte octroyée », il présente le 25 juillet 1946 un texte de tonalité fédéraliste qui admet pour les peuples coloniaux le droit de « libre disposition d’eux-mêmes ». Senghor participe à la constitution avec les élus « indigènes » d'un intergroupe que préside Lamine Gueye. Il contribue à faire évoluer durant plusieurs mois les positions socialistes sur la question coloniale. La SFIO trouvait en lui une vitrine politique, valorisante et quelque peu édifiante. Lamine Gueye, avocat, et Senghor, professeur agrégé, sont deux exempla des bienfaits de la colonisation. Le 19 septembre 1946, le lendemain d’un grand discours prononcé à l’Assemblée en faveur d’une « fédération de Républiques », Le Populaire le présente en ces termes : « (Il) était particulièrement qualifié pour montrer ce qui unissait et différenciait à la fois la France métropolitaine. Fleuron de la civilisation européenne et de ses territoires d’outre-mer, n’était-il pas fils de l’Afrique noire, l’interprète fidèle de ses aspirations et de ses sentiments, en même temps qu’un humanisme fin et lettré, poète de grande classe qui a reçu de notre université le meilleur de son enseignement ? ». Durant plus de deux ans, Senghor et la SFIO profitent mutuellement de cette alliance. Il semble à cette étape très intégré dans les milieux socialistes. Lorsqu’en septembre 1946, il épouse, Ginette Éboué, la fille de la députée SFIOEugénie Éboué et de feu le gouverneur Félix Éboué, il a pour témoin Marius Moutet, ministre socialiste de la France d’outre-mer. Mais le député du Sénégal, qui est aussi élu conseiller général cette même année, est confiné à la question coloniale dont les spécialistes les plus reconnus sont alors Lamine Gueye et sa belle-mère Eugénie Éboué. Surtout, il entend que les promesses constitutionnelles soient transformées en réalité et espère que l’Union française deviendra résolument égalitaire et réformiste. Aussi se résigne-t-il de plus en plus mal à la politique modérée et prudente en la matière du tripartisme. Après avoir cosigné avec une cinquantaine de parlementaires un texte critique en février 1946, il approuve la motion Guy Mollet au congrès d’août et s’engage dans la gauche de la SFIO qui entend rénover le parti et sa politique. Réélu député sous la Quatrième République Senghor est réélu député de l’Afrique occidentale française (Sénégal) à la première législature de la IVe République, le 10 novembre 1946. Le collège unique étant établi, il est alors colistier de Lamine Gueye. Les deux députés SFIO sortants sont brillamment réélus, avec 128 284 suffrages sur 192 861 inscrits et 130 118 exprimés.
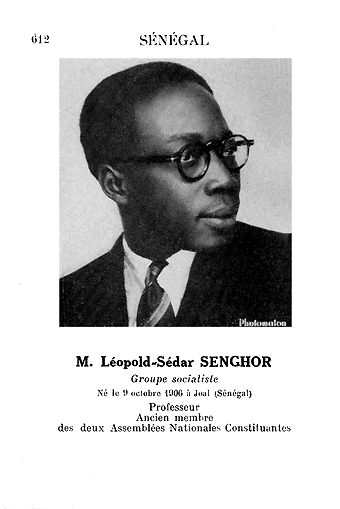 © Assemblée nationale
Senghor est nommé à la commission des territoires d’outre-mer qui le désigne comme secrétaire le 26 janvier 1950 et l’envoie siéger au comité directeur du Fonds d’investissement pour le développement économique et social (FIDES) le 21 février 1951. Il est encore nommé à la commission du suffrage universel du règlement et des pétitions et juré de la Haute Cour de justice le 23 novembre 1948. En 1947, Senghor entre au comité directeur de la SFIO mais sans s’intégrer à la direction, car il soutient la motion plus à gauche et anticolonialiste de Jean Rous. Les désaccords avec la SFIO ne cessent d’augmenter, liés à la situation au Sénégal, à la conjoncture et à des oppositions de fond. Au Sénégal, Senghor représente les électeurs de la brousse et, fédéraliste, envisage une autonomie du mouvement socialiste africain. Ses intérêts divergent de ceux de Lamine Gueye, maire de Dakar, avocat de la bourgeoisie citadine des quatre communes littorales, assimilationniste, qui veut maintenir les liens avec la SFIO et contrôle l’appareil politique local. Senghor fonde alors un journal Condition humaine et commence à rassembler des partisans. En Afrique, il s’agit aussi de réagir à la pression exercée par la fondation du RDA d'Houphouët-Boigny. En France, le député sénégalais estime que la SFIO ne défend plus les intérêts des autochtones en Afrique, ou plutôt qu’elle subordonne leur défense aux exigences gouvernementales françaises et à celle de la Troisième force. Au comité directeur, il exprime sa méfiance vis-à-vis de celle-ci en octobre 1947 et en janvier 1948, où il prononce un long réquisitoire s’achevant ainsi : « Nous ne voulons être ni des otages ni des dupes. Si nos territoires ne sont pas équipés, si l’analphabétisme n’est pas combattu, nous n’avons aucun intérêt à rester Français. Si on oppose une fin de non-recevoir à nos revendications, notamment à celles touchant la réforme de l’enseignement, je voterai contre le gouvernement et je suis prêt à subir toutes les sanctions. Il faut, conclut-il, que la Troisième Force s’occupe d’établir un peu plus de démocratie dans la France d’outre-mer ». Plus profondément, alors que la SFIO entrevoit la Libération des « colonisés » uniquement en termes politiques, Senghor met au premier plan de ses préoccupations l’affirmation culturelle des « nègres ». Dans ces mois, avec Jean Rous, Senghor fonde le Congrès des peuples contre l’impérialisme. Avec Rous, Lamine Gueye et Paul Rivet, il participe à l’éphémère aventure du Rassemblement démocratique révolutionnaire (RDR). En juillet 1948 le congrès national de la SFIO condamne le RDR et, Senghor n'est pas réélu au comité directeur. Il se retrouve une dernière fois aux côtés de Lamine Gueye, avocat des députés malgaches, pour protester contre leur condamnation à mort. Senghor démissionne de la SFIO le 27 septembre 1948. Avec le docteur Louis-Paul Aujoulat, député du Cameroun et marginal du MRP, il rejoint les Indépendants d’outre-mer (IOM), dirigé par son vieil ami Sourou Apithy. C’est un des groupes charnières dont l’appui est indispensable aux coalitions au pouvoir. La fragilité de la Troisième force favorise les petites formations et leur ouvre ainsi un espace politique. Avec succès, puisque, à l’initiative de son groupe, l’Assemblée vote le 30 juin 1950 la loi sur les traitements et indemnités des fonctionnaires d’outre-mer, puis adopte le code du travail (Senghor intervient dans le débat le 27 novembre 1950). Il revendique par ailleurs un rôle dans la création d’une Académie en AOF et dans le décret portant égalisation des pensions des anciens combattants de l’Union française. Au Sénégal, Senghor fonde dès octobre 1948 le Bloc démocratique sénégalais (BDS) qui mène campagne pour les élections législatives de 1951. Celles-ci sont particulièrement animées et violentes. Le BDS le présente, avec pour second le secrétaire des syndicats confédéré de Dakar, Abbas Gueye. Ils écrasent Lamine Gueye et la SFIO, avec 213 417 suffrages sur 665 280 inscrits, contre 96 469 voix à la liste SFIO et 5 033 à une liste RPF.
Le BDS l’emporte largement, contrairement aux prévisions de l’administration dirigée par le gouverneur général et ancien député socialiste Paul Béchard. Senghor est de nouveau élu à la commission des territoires d’outre-mer en juillet 1951 et désigné par celle-ci comme membre suppléant de la commission de coordination pour l’examen des problèmes intéressant les États associés d’Indochine et comme titulaire de l’Assemblée consultative du Conseil de l’Europe, où il représente les territoires d’outre-mer. Il siège avec assiduité à l’Assemblée ad hoc pour une communauté politique européenne. Il y noue des liens qui lui seront particulièrement utiles par la suite. Le député du Sénégal approfondit aussi la notion « d’Eurafrique » qui constitue une permanence durant toute sa vie politique. Louis-Paul Aujoulat entrant au gouvernement, Senghor prend la présidence des IOM qui compte quatorze élus africains. Il dispose d’un groupe parlementaire toujours situé dans la majorité, souvent indispensable à la formation de gouvernement. Situation qui permet de faire avancer aussi bien les revendications immédiates – durant toute la législature, les IOM combattent ainsi pour assurer un prix plus rémunérateur aux producteurs d’arachides – que les grandes questions. Au Parlement, le député du Sénégal fait adopter une loi le 6 février 1952, faisant obligation au gouvernement de déposer des projets de statut pour les territoires, donnant à chaque circonscription administrative un nombre de conseillers qui soit proportionnel à leur population, rendant le suffrage pratiquement universel. Il mène le combat pour réformer l’article VIII de la Constitution relatif à l’outre-mer, afin que les territoires obtiennent une autonomie interne dans le cadre d’une République française fédérale. Avec le groupe IOM, il dépose une proposition de résolution en ce sens le 15 mai 1955. Le député du Sénégal, en dépit des pressions de la SFIO, est nommé secrétaire d’État à la présidence du Conseil dans le deuxième cabinet Edgar Faure le 1er mars 1955.
Chargé de la recherche scientifique et de la révision du titre VIII de la Constitution, il remet au chef de gouvernement un rapport sur l'avenir de l'Union, intitulé « Choisir de ne pas choisir ». C'est un projet de révision de la Constitution visant à transformer l’Union française en confédération et l’État français en République fédérale. Lorsque le gouvernement Edgar Faure est renversé, il publie son rapport dans la NEF, la revue dirigée par Lucie Faure, écrivant que l’autonomie recherchée ne peut être qu’une étape vers l’indépendance dans « l'Union des États confédérés ». Senghor multiplie par ailleurs durant cette législature les responsabilités et les fonctions de représentation. En novembre 1952, il est délégué de la France à la 7ème session de l’UNESCO (il avait déjà participé à la deuxième conférence à Mexico en 1947). Au Sénégal, les élections aux Assemblées territoriales, gagnées en 1952 par le BDS, scellent un rapport de force favorable à son parti. Il entre au Grand conseil de l’Afrique équatoriale française et un de ses amis accède à la présidence jusqu'alors exercée par Lamine Gueye. Aux élections anticipées du 2 janvier 1956, le BDS conserve les deux sièges attribués au Sénégal avec 346 266 suffrages, contre 101 732 à la liste de Lamine Gueye et 6 896 à une liste de l’Union démocratique sénégalaise.
Senghor participe aux travaux de la commission de la défense nationale à partir du 31 janvier 1956 et retrouve la commission des territoires d’outre-mer et du suffrage universel le 6 mars 1956. Le 4 octobre 1957, il est nommé à la commission des lois constitutionnelles, du règlement et des pétitions. Il prend une position critique et embarrassée lors de la préparation du projet de loi-cadre sur l’outre-mer, dite Gaston Defferre qui institue des conseils de gouvernement et élargit les pouvoirs des assemblées locales. Senghor estime que la loi ne va pas assez loin : « joujoux et sucettes » dit-il, et regrette que l'autonomie accordée aux territoires et non aux deux grandes fédérations conduise à un risque de « balkanisation régionale » et à un dépeçage de l’Afrique noire en une poussière d’États. Il s'abstient, lors du vote final, alors que la loi est adoptée par 487 voix contre 99. Mamadou Dia -son colistier- devient vice-président du conseil de gouvernement du Sénégal et Senghor appelle à l’unité entre partis « libérés de toutes attaches métropolitaines ». Il regroupe quelques petites formations qui permettent de créer le Bloc populaire sénégalais (BPS) en 1956.
Les événements d’Algérie accélèrent les échéances. Le 1er juin 1958, Senghor ne prend pas part au vote d’investiture du général de Gaulle mais, le lendemain, il votera les pleins pouvoirs au gouvernement et la révision constitutionnelle. Au Sénégal, il achève le rassemblement des socialistes, puisque, sous la pression de la SFIO, Lamine Gueye et les socialistes sénégalais qui ont déjà formé un mouvement indépendant du parti français, le Mouvement socialiste africain, rapprochent du BPS formant avec lui l’Union progressiste sénégalaise (UPS). Senghor en devient secrétaire général, le maire de Dakar étant directeur politique. Elle combat pour une République fédérale d’Afrique, insérée dans une Confédération franco-africaine, mais la revendication de l’indépendance immédiate se fait jour dans ses rangs. Avec Houphouët-Boigny, qui prône lui la fédération avec la France et l’éclatement de l’AOF, Senghor se retrouve membre du comité chargé d’élaborer le projet de Constitution de la Ve République. De Gaulle refuse la confédération, invitant chaque pays à choisir entre fédération et sécession.
« Où es-tu donc, yeux de mes yeux, ma blonde, ma Normande, ma conquérante ? Chez ta mère à la douceur vermeille ? - j’ai prisé votre charme ô femme ! sur le versant de l’âge - Chez ta mère à la vigne vierge, avec le rouge-gorge domestique, les merles et mésanges dans les framboises ? Ou chez la mère de ta mère au chef de neige sous les Ancêtres poudrés de lys Pour retourner au Royaume d’Enfance ? Te voilà perdue à me retrouver au labyrinthe des pervenches, sur la montagne merveilleuse des primevères. Ne prête pas l’oreille aux lycaons ! Ils hurlent sous la lune, férocement forçant les daims du rêve. Mais chante sur mon absence tes yeux de brise alizés, et que l’Absente soit présence. » Élégies majeures, "Élégie des Alizés"
Senghor dans les blés d'or de Normandie « Été splendide Été, qui nourris le Poète du lait de ta lumière » Collection particulière © DR Senghor se rallie publiquement au projet constitutionnel, expliquant que la nouvelle Constitution autorise les États associés à se regrouper, ce que fera le Sénégal avec le Soudan français. Il proclame : « Oui pour l’indépendance dans l’amitié, non dans la dispute ». Il est suivi par l’immense majorité de la population du Sénégal.
« Éveiller mon peuple aux futurs flamboyants»
Senghor tente de mettre sur pied une Fédération du Mali dont il préside l’Assemblée. Il entre dans le gouvernement Debré en juillet 1959, comme ministre conseiller. Sénateur de la Communauté, lorsque l’indépendance est accordée le 20 juin 1960, il est président de la Fédération du Mali, mais celle-ci éclate le 19 août suivant. Senghor président de l’Assemblée fédérale, secrétaire général de l’UPS, est élu à l’unanimité de l’Assemblée président de la République du Sénégal le 5 septembre 1960. Du 19 au 21 avril 1961 le Président Léopold Sédar Senghor effectue sa première visite officielle en France.
En décembre 1962 le Président Senghor fait face, avec le soutien de Lamine Gueye devenu président de l’Assemblée, à la tentative de coup d’État du président du Conseil, son ancien compagnon Mamadou Dia. Senghor prend alors la direction du gouvernement et -l'année suivante- une nouvelle Constitution met en place un régime présidentiel.
« L'émotion est nègre, comme la raison hellène »
Léopold Sédar Senghor s’attache, au cours de ses mandats présidentiels, à transmettre une vision culturelle. Dans l'homme de couleur (Librairie Plon, coll. « Présences », Paris, 1939), il écrit au sujet de la culture nègre : « C'est à ses floraisons humaines que je vais m'attacher, plutôt aux rameaux nouveaux, greffés sur le vieux tronc humain. Partialement, c'est entendu. On connaît assez les défauts des Noirs pour que je n'y revienne pas, et celui-ci, impardonnable parmi d'autres, de ne pas s'assimiler dans leur personnalité profonde. Je ne dis pas de ne pas laisser s'assimiler dans leur personnalité profonde. Je ne dis pas de ne pas laisser assimiler leur style. Seuls m'intéressent, ici, sont intéressants les éléments féconds qu'apporte leur culture, les éléments du style nègre. Et celui-ci demeure aussi longtemps que demeure l'âme nègre, vivace, dirais-je éternel ? » En 1966 Léopold Sédar Senghor organise à Dakar le premier Festival mondial des arts nègres qui a lieu en présence d'André Malraux. Léopold Sédar Senghor déclare, dans une allocution radiodiffusée le 19 mars 1966 : « Le premier festival mondial des arts nègres a très précisément pour objet de manifester, avec les richesses de l’art nègre traditionnel, la participation de la Négritude à la Civilisation de l’Universel. »
La francophonie, « un idéal qui anime des peuples en marche vers une solidarité de l’esprit »
En janvier 1969, intervenant sur le thème : « La Francophonie comme contribution à la Civilisation de l’Universel », Senghor affirme que la langue française, tout en aidant à « l’éclosion de la Négritude », a vocation à fonder un grand projet politique, « [à] édifier, entre nations majeures, une véritable communauté culturelle [...]. L’heure est désormais à la coopération. La Francophonie n’est pas une idéologie c’est un idéal qui anime des peuples en marche vers une solidarité de l’esprit » (Liberté 3, p.193-194). Léopold Sédar Senghor défend aussi un socialisme adapté aux particularités africaines. Entré à l’Internationale socialiste dont il est vice-président en 1976, il préside la République du Sénégal jusqu’au 31 décembre 1980, date à laquelle il quitte volontairement le pouvoir. Élu à l'Académie française Senghor, qui a toujours entretenu des rapports privilégiés avec le général de Gaulle et surtout avec son vieil ami Georges Pompidou, s’installe en France, se partageant entre Paris et la propriété normande de son épouse. Il se consacre essentiellement à une activité poétique qu’il n’a jamais abandonnée, même au pouvoir, et poursuit son combat en faveur de la francophonie dont il a fondé les premières structures en 1970, avec Bourguiba. Il reçoit alors les plus prestigieuses distinctions du monde des Lettres. Déjà membre des Académies des Sciences morales et politiques comme associé étranger depuis 1969, et membre de l’Académie des Sciences d’outre-mer,
il est élu à l’Académie française en 1983.
(Internet Explorer 6 : rafraîchir la page)
Il y est reçu solennellement en 1984 par son ami Edgar Faure. Cette même année, François Mitterrand fait appel à lui pour être vice-président du Haut Conseil de la Francophonie. Il appartient, par ailleurs, à la société de linguistique de France, au Comité national des écrivains, à l’Association Guillaume Budé et au Conseil supérieur de la recherche scientifique et du progrès technique. En 1991, a été inaugurée à Alexandrie (Égypte), l'Université internationale francophone Léopold Sédar Senghor. En octobre 1996, Léopold Sédar Senghor déclare dans un message à l’UNESCO qui lui rend hommage pour son quatre-vingt dixième anniversaire : « J’ai toujours rêvé de concilier Francophonie et Négritude. Ce rêve est maintenant une réalité ». Il décède le 20 décembre 2001 à Verson, sa résidence normande, et est inhumé à Dakar. Ce grand acteur de la scène africaine laisse une œuvre poétique, critique, linguistique très riche ainsi que de nombreux ouvrages politiques, délivrant, par-delà une « Négritude debout » et au travers du dialogue des cultures, un message universel.
(Internet Explorer 6 : rafraîchir la page)
Parmi les nombreux ouvrages dont Senghor est l’auteur, citons Chants d’Ombre, Hosties noires, Chants pour Naët,Éthiopiques, Nocturnes, Lettres d’hivernage et Élégies majeures, Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache en langue française, La parole chez Paul Claudel et chez les Négro-africains, dialogues sur la poésie francophone.
Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache de langue française, par Léopold Sédar Senghor, précédée de Orphée noir, par Jean-Paul Sartre. Paris, Presses universitaires de France, 1948. « L'aventure des poètes de l'Anthologie n'a pas été une entreprise littéraire, pas même un divertissement ; ce fut une passion. Car le poète est comme la femme en gésine : il lui faut enfanter. Le Nègre singulièrement, qui est d'un monde où la parole se fait spontanément rythme dès que l'homme est ému, rendu à lui même, à son authenticité. Oui, la parole se fait poème. » (Liberté I, p. 218)
Une série d’œuvres en proses, discours, conférences, essais, sont parues aux Éditions du Seuil, en quatre tomes sous le titre de Liberté. Léopold Sédar Senghor collabore aussi durant sa longue carrière littéraire à de nombreuses revues, par exemple, les Cahiers du Sud, Les Temps modernes, Esprit, Jeune Afrique, Le Journal des africanistes.
|
LEOPOLD SEDAR SENGHOR:MEMOIRE
Léopold Sédar SENGHOR (1906-2001)
Élu en 1983 au fauteuil 16
Grand-croix de la Légion d'honneur
Grand-croix de l'ordre du Lion du Sénégal
Grand-croix de l'ordre national du Mérite
Commandeur des Palmes académiques
Commandeur des Arts et des Lettres
Médaille de la Reconnaissance franco-alliée 1939-1945
Croix de combattant 1939-1945
Titulaire de nombreuses décorations étrangères
Prédécesseur : Antoine de LÉVIS MIREPOIX
Successeur : Valéry GISCARD d’ESTAING
 |
Chef d'État, homme politique, poète, essayisteBiographie
Né à Joal, au Sénégal, le 9 octobre 1906, Léopold Sédar Senghor fait ses études à la mission catholique de Ngasobil, au collège Libermann et au cours d'enseignement secondaire de Dakar, puis, à Paris, au lycée Louis-le-Grand et à la Sorbonne. Il est reçu à l'agrégation de grammaire en 1935.
Tout en enseignant les lettres et la grammaire au lycée Descartes à Tours (1935-1938), il suit les cours de linguistique négro-africaine de Lilias Homburger à l'École pratique des hautes études et ceux de Paul Rivet, de Marcel Mauss et de Marcel Cohen à l'Institut d'ethnologie de Paris. Nommé professeur au lycée Marcellin Berthelot de Saint-Maur-des-Fossés en 1938, il est mobilisé en 1939 et fait prisonnier en juin 1940. Réformé pour maladie en janvier 1942, il participe à la Résistance dans le Front national universitaire. De 1944 jusqu'à l'indépendance du Sénégal, il occupe la chaire de langues et civilisation négro-africaines à l'École nationale de la France d'outre-mer.
L'année 1945 marque le début de sa carrière politique. Élu député du Sénégal, il est, par la suite, constamment réélu (1946, 1951, 1956). Membre de l'assemblée consultative du Conseil de l'Europe, il est, en outre, plusieurs fois délégué de la France à la conférence de l'UNESCO et à l'assemblée générale de l'ONU. Secrétaire d'État à la présidence du Conseil (cabinet Edgar Faure : 23 février 1955 - 24 janvier 1956), il devient maire de Thiès au Sénégal, en novembre 1956. Ministre-conseiller du gouvernement de la République française en juillet 1959, il est élu premier Président de la République du Sénégal, le 5 septembre 1960. Ses activités culturelles sont constantes : en 1966, se tient, à Dakar, le 1er Festival mondial des arts nègres. Réélu Président de la République en 1963, 1968, 1973, 1978, il se démet de ses fonctions le 31 décembre 1980.
Léopold Sédar Senghor est médaille d'or de la langue française ; grand prix international de poésie de la Société des poètes et artistes de France et de langue française (1963) ; médaille d'or du mérite poétique du prix international Dag Hammarskjoeld (1965) ; grand prix littéraire international Rouge et Vert (1966) ; prix de la Paix des libraires allemands (1968) ; prix littéraire de l'Académie internationale des arts et lettres de Rome (1969) ; grand prix international de poésie de la Biennale de Knokke-le-Zoute (1970) ; prix Guillaume Apollinaire (1974) ; prince en poésie 1977, décerné par l'association littéraire française L'Amitié par le livre ; prix Cino del Duca (1978) ; prix international du livre, attribué par le Comité international du livre (Communauté mondiale du livre, UNESCO, 1979) ; Prix pour ses activités culturelles en Afrique et ses œuvres pour la paix, décerné par le président Sadate (1980) ; médaille d'or de la CISAC (Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs) ; premier prix mondial Aasan ; prix Alfred de Vigny (1981) ; prix Athénaï, à Athènes (1985) ; prix international du Lion d'or, à Venise (1986) ; prix Louise Michel, à Paris (1986) ; prix du Mont-Saint-Michel, aux Rencontres poétiques de Bretagne (1986) ; prix Intercultura, à Rome (1987).
Il est docteur honoris causa de trente-sept universités, dont Paris-Sorbonne, Strasbourg, Louvain, Bordeaux, Harvard, Ifé, Oxford, Vienne, Montréal, Francfort, Yale, Meiji, Nancy, Bahia et Evora.
Il est membre correspondant de l'Académie bavaroise (1961) ; membre associé (étranger) de l'Académie des sciences morales et politiques (1969) ; membre (étranger) de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Bordeaux ; membre (étranger) de l'Académie des sciences d'outre-mer (1971) ; membre (étranger) de The Black Academy of Arts and Letters (1973) ; membre (étranger) de l'Académie Mallarmé (1976) ; membre (étranger) de l'Académie du royaume du Maroc (1980).
Il est élu à l'Académie française, le 2 juin 1983, au fauteuil du duc de Lévis-Mirepoix (16e fauteuil).
Mort le 20 décembre 2001.
|
Œuvres de Léopold Sédar SENGHOR
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Discours et travaux académiques
de Léopold Sédar SENGHOR |
|
|
LA GLOIRE PASSÉE DE LA RACE NOIRE
La Gloire De La Race Noire
Par Pianke Nubiyang
(Texte traduit par Bantu kelani avec l'aimaibale authorisation du frère Pianke Nubiyang.)
LES EXPLOITS GLORIEUSES DE LA RACE NOIRE.
Les noirs sont la race originelle sur terre, et c'est á partir de la race noire que tous les autres races sont nées. Sur terre les noirs étaient les premiers peuples à initier une culture internationale et des civilisations developpées. En ce qui concerne le cosmos, il ne serait pas étonnant que les ancients Africains aient déja établis des civilisations dans les autres parties de l'univers.
Il ya 300 ans, des théories racistes ont été inventées pour justifier l'ésclavage et la colonization des noirs à l'échelle Internationale alors qu'en 1600 après J.C et même il ya 20 000 ans, les civilisations des peuples noirs étaient suprêmes et les plus avancées sur terre. Un nombre limité de noirs ont échappé à l'ésclavage et aux successives invasions de leurs terres. Ils ont fuit dans des endroits retirés, et à cause de ça ils ont regressé culturement. La majorité des noirs ont continué à creer et à maintenir des cultures vibrantes à travers le monde. L'ésclavage, la colonisation, et l'opppression ont été des coups fatales qui ont contribué au sous-developement des hautes civilisations Africaines souvent jusqu'a à leurs extinctions.
L'hégemonie de la race noire n'était pas un phénomene qui s'était produit par l'oppression des autres races, mais du fait que la race noire est la première race de nôtre planète ce qui lui donne plus d'éxperience, et aussi parce que la race noire s'est développée sous le soleil. Le pigment qui rend la peau foncée s'appelle la "mélanine." La mélanine peut être considerée comme ayant été la source de l'intelligence et du développement spirituelle de la race noire. En effet la mélanine a permit aux Africains de survivre sous la chaleur du soleil de leur continent et leur donné la possibilité de produire les premières hautes Cultures en Afrique et dans d'autres parties du monde.
QUELQUES FACTEURS QUI ONT CONTRIBUE AUX EXPLOITS EXTRAORDINAIRES DES NOIRS A L'ECHELLE MONDIALE DEPUIS LE DEBUT DE L'HISTOIRE DE L'HUMANITE:
- La mélanine, le pigment de la peau abundent chez les noirs, est un avantage. Les gens qui ont un excès de mélanine ont moins de cancer de la peau comparé aux gens qui ont la peau claire.
- La peau noire ne viellit pas et se ride moins avec l'âge que la peau claire.
- La mélanine contribue à la longetivité de la vie. Les personnes noires de plus de 90 ans, qui ne sont pas maladies,vivent plus longtemps que les personnes des races claires. Ces noirs sont phsiquement plus forts que les gens à la peau claire ayant le même âge.
- La mélanine favorise les prouesses mentales des noirs si aucun fléau n'empêche le dévelopment intellectuelle naturellle des noirs comme: une éducation inferieure et l'éxtrême pauvreté imposé par ceux qui maintiennent les noirs en état pérpetuelle d'oppression.
- La mélanine est résponsible du dévelopment de la race originelle de nôtre planète qui était noire et qui était très développée.
- La mélanine est responsible de la prouesse mentale de la race noire originale, et ceci avant la prouèsse mentale des autres races.
- Les premières civilisations, cultures, technologies,et sciences ont debuté dans les regions les plus chaudes et les plus humides du monde òu les noirs avaient vécues des milliers et des milliers d'années. Les origines des sciences et des téchnologies modernes proviennent des régions anciennement contrôlés par les peuples noirs. Les racines des civilistions, cultures, sciences, technologies,et religions Occidentales ne sont pas "Grèques" mais Egyptienne et Nubienne/Koushites. Les noirs ont dominé la Grèce pendant des milliers d'années avant que les Dories de l'Eurasie du nord envahissent la Grèce, et avant que les Grècs émergent comme un peuple "civilisé."
- 10.000 ans avant J.C, et jusqu'á environ 1.000 apres J.C, les noirs étaient les pionniers dans le domaine de la science, culture, téchnologie, empires et civilisations. Le premiers empires et civilisations noires étaient l'empire préhistorique de ZINGH qui éxistait il y a plus de 15.000 avant J.C, et qui était situé depuis le terrritoire actuelle de la Mauritanie jusqu'au KMT (Egypte Antique) et Nubie-Koush. L'empire de Nubia-Koush lui a éxisté depuis 17.000 ans avant J.C. Ces ancients empires et civilisations éxperimentaient déja la science et la téchnologie. Leurs sciences et technologies étaient si avancées que des hiéroglyphes dans les pyramides, et les légendes des societés indigènes partout dans le monde racontent que des machines volantes étaient utilisés par ces civilisations. Les civilisations noires, comme celle de Kémet (KMT) et celle du Mali ont éxperimenté et ont crée la chimie et la médecine. La chirurgie était pratiquée par les prêtres-médecins á Kemet, au Mali, et en Afrique centrale. En 400 avant J.C, un Pharaon noir nommé PI DI AMEN établissait déja des éxperimentations avec l'aviation. Des siècles après, les noirs Egyptiens ont inventé la poudre à cannon qu'ils utilisaient strictement dans leurs temples et dans leurs écoles mystiques.
Sans utiliser de télescope les Dogons au Mali étaient, et sont toujours, les meilleurs astronomeurs au monde. Ils ont localisé et dessiné avec precision la carte du système stellaire Sirius, ceci bien avant d'autres peuples qui ont réussis à le faire avec l'aide de télescope Hi-Téch. Les Dogons étaient aussi capables de voir les étoiles invisibles a l'oeuil nu, ainsi que tous les astres que les autres peuples ont été incapables de localiser pendant des siècles. Certains peuples Dogons sont toujours des spécialistes astronomeurs. Beaucoup d'autres éthnies Africains sont aussi des éxperts méterologistes juste en scrutant les astres. - Les mathématiques et l'astronomie, nécessares á la fondation des hautes téchnologies comme ceux utilisées dans l'aérospaciale et l'industrie, ont d'abord été crées par les noirs de Kemet (Egypte) et de Koush (Soudan). Ces sciences et ces hautes téchnologies ont ensuite été acquises et ammeliorées par les Sumeriens, les Babyloniens, les Elamites (tous originellement des peuples noirs) puis par les Grèques, les Hébreux, les Romains, et les Arabes. C'étaient aussi les noirs Sabéans du Sud de l'Arabie ( qui étaient une branche de Koushite de la race noire Africaine), qui ont établis les prémières hautes civilisations dans la Pénninsule Arabique des milliers d'années avant l'émergence culturelle des Arabes Bédouins.
- Les Noirs ont construits les monuments les plus larges et les plus impressionants dans l'Antiquité. Ils ont effectués des constructions colossalles, dans l'engénierie également, depuis la préhistoire avec l'empire Zingh, durant les periodes des civilisations du Nile en Egypte et au Soudan, et jusqu'á en Chine avec l'empire Shang qui était une dynastie noire.
- La medicine est née au Kemet (Egypte Anciènne), et plus tard est arrivée en Grèce. Les ancients Grèques ont copié toutes les sciences qui étaient inscrites dans les papyrus des ancients Kémites et des ancients Nubiens.
- Les philosophies religieuses sont nées en Afrique, puis ont été copiées par les Européens, les Sémites, et les autres peuples. Par éxample, le Dieu Noir Kémit AMON est devenu APPOLO en Grèce. Les noirs ont fondé les premières religions au monde. Les dieux et les madonnes dans l'Antiquité étaient tous de couleur noire.
- Tous les conceptes des hautes cultures Kémites, Nubiennes, et Dravidiennes (noirs Hindus) ont été copié par les Asiatiques et les Européens. Les noirs étaient à l'apogée de leurs civilisations quand les Grèques, les Hyskos-Sémites et d'autres peuples originaires des plaines du Caucase en Eurasie ont envahis et occupé leurs terres. Ils les ont inflitré, et ont imposés leurs philosophies religieuses par la guerre, et un lavement de cérveau sévère. Les anciennens civilisations des noirs comprenaient la Nubie-Koush, l'Ancienne Egypte, Sumer, Elam, Canaan et d'autres régions. Tous, éxceptée la Nubie-Koush, ont été envahis par des barbares venus du nord pendant leurs periodes de faiblesses. C'est seulement la Nubie-Koush qui est demeurée puissante jusqu'á la fin du 15è siècle après J.C lorsque les Arabes envahisseurs ont infiltrés leur nation et ont commence à rendre ésclaves les Noirs. Ces envahisseurs sont toujours dans ce pays aujourd'hui. C'est grace á la Nubie et les autres anciennes civilisations noires que les barbares normandes ont appris la haute civilisation. Ils l'ont sûrement pas appris grâce à leur mode-de-vie nomade, pastorale, difficile, et sauvage lorsqu'ils vivaient en Eurasie ou dans les déserts de l'Arabie.
- C'est l'intellect des noirs et leur richesse matérielle qui a contribué au développement des Bedouins Arabes au environ de l'annèe 600 après J.C. Des milliers d'années auparavant, c'étaient les noirs Arabes qui ont developpé la culture et le développement materielle des civilisations Arabes y compris pendant le Moyen Age et pendant l'occupation des Maures en Europe du Sud (L'Espagne et le Portugal). En même temps, les Bedouin Arabes, ou Semites, ont entrepis une politique d'invasions des civilisations Noirs et ésclavage et l'aggression des peuples noirs. Les Arabes ont été benéficiares de la civilisation de Byzantium qui a été influencé par Rome, la Grèce, et originellement l'Egypte noire.
- A partir de 711 après J.C, quand les Maures un peuple Noir du Sénégal, Afrique de l'Ouest et Maroc, ont envahis l'Europe ils ont introduis la science, la téchnologe, la civilisation Maure noire et l'éducation en Europe et ont sortis les Européens de l'Age des Tenebres au environ de 400 après J.C jusqu'en 711 après J.C.
Les Maures noirs ont introduis un système d'éducation avancée en Espagne, similaire á celui qui était present au Ghana et les universités la ville de Jenné au Mali pendant des centaines d'années. Ils ont introduis ces systèmes d'education avancées dans les villes de Toledo, Séville et Cordoba. Ces villes étaient les centre de la civilisation Maure noire et d'érudition de l'Europe entière, ainsi que scientique, et culturelle où les Européens et les autres venaient étudier de nouvelles et superiéures sciences, arts, et technologies. Ceci a initié la Renaissance Européene quelques années plus tard. Les Maures noires ont introduit l'Art, l'architecture, les sciences, la medicine, la domestication animale, et d'autres disciplines avancées en Espange et dans le reste de l'Europe. Ceci était le cataclysme fondamentale de la Renaissance Européene. - Comparé á l'Afrique et l'Asie de l'Est, où les Européens ont appris des technologies des Chinois comme la poudre á connon et les armes á feu, l'Europe de l'Ouest et de l'Est (á l'éxception de Rome, Grèce, etc.) avait peu d'histoire de grande civilisations et de succes avant le Moyen Age. Les Africains et les noirs d'Inde ont eu des brillantes et éxtraordinaires civilisations et contribuaient á la civilisation modiale pendant des milliers d'années. Les Anglais, Français, Espagnols, Néerlandais, Scandinaves, Allemends, Celtes, Russes, Polonais et les autres groupes Européens, qui aujourd'hui déclarent être "supérieurs" aux noirs et les autres, étaient depuis la prehistoire jusqu'en 15è siècle après J.C, économiquement, culturellement, intellectuellement, et scientifiquement ainsi que socialement moins avancées que les nations, les Royaumes et les Empires noirs pendant la meme periode. Depuis le temps que les Romains ont conquis l'Europe au environ de 400 avant J.C jusqu'en 1200 apres J.C, la grande partie de l'Europe du Nord et de l'Ouest était au niveau du barbarisme et le sous-developpement. Les colonies et les cités que les Romains ont construits étaient les seuls endroits culturellement anvancées.
- La déclaration de certaines personnes de leur supériorité raciale par rapport aux noirs n'est basée qu'a leur récent développement, comme le colonialisme et l'oppression planifié contre les noirs mondialement, qui inclus l'ésclavage et la nouvelle forme d'ésclavage dans les Etats-Unis aujourd'hui: l'emprisonement et le système diabolique de "trois faux pas au trou," que seulement des gens qui ont la mentalité de Satan peuvent introduire qui est un plan déstructeur et diabolique contre une race de gens. La poudre á feu et l'utilisation de ruse et plans insidieuse et machiavéliques comme la religion ont été les premières raisons pour lesquelles les envahisseurs des pays noirs ont eu l'occasion de dominer, diviser, et conquerir. Ces téchniques ont été utilisés auparavent comme aujourd'hui.
- L'introduction de la poudre á connon en Europe par les Chinois, á travèrs les Arabes, ont joué un rôle majeur dans l'élevation des Européens au niveau de la superiorité militaire. Cet avantage sur certains Africains ont rendu le colonialisme et le vol des terres des Africains, tout comme la défaite de certaines armées Africaines faciles. Quand les Européens se battaient avec des épées et des lances leurs victores contre les Africains étaient peu nombreuse. Par éxemple, Hannibal l'Africain de Carthage a vaincu les légions Romaines avec aussi peu de 15.000 d'hommes, et a regné en l'Italie pendant plusieurs années. De plus, même pendant la periode moderne avec les armes modernes, les Européens ont également été vaincus sévèrement. Les Nations ZULUS, les ETATS MOSSI, ASHANTI, DAHOMIENS, ETHIOPIENS, HERREROS, et les autres ont battus les Européens dans de nombreuses guerres et batailles.
- Dans plusieurs cas l'utilisation des meilleures armes, plus modernes et plus éfficaces étaient l'élement déterminant de leurs victores. Malgré tout, les Européens ont également conquis les nations non-noires comme la Chine, les nations Sémies Arabes, les Indiens d'Amériques, et les autres. C'est seulement l'utilisation d'armes plus efficaces qui a aidé les Européens, fait important que les peuples noirs devraient se souvenir! Si les nations noires étaient mieux armées, que ce soient les communautes noires aux Etats-Unis, en Indie, en Amérique Latine, en Europe, en Australie, au Pacifique, et en Afrique, en étant sûr qu'ils soient correctement armés á chaque fois ils gagneront la victoire contre les Européens. Ce sont les armes qui maintient les noirs et les autres peuples opprimés jusqu'á ce jour comme dans le passé, au lieu d'une "superiorité" naturelle par rapport á n'importe quelle autre groupe, ou race d'être humains.
- Les Noirs étaient les premiers inventeurs des disciplines qui ont aidés á ammené le monde dans l'ère téchnologique. Les mathématiques, la physique, l'astronomie, la construction en batiment, la metallurgie, et toute l'origine des autres disciplines qui ont contribué á entraîner le monde dans l'âge moderne, ont été commencés par les noirs en Egypte, Nubie-Kosh, Mésopotamie, Saba, et l'Inde noir Naga.
Alors, même si les gens d'origine Européenes ont contribué á l'ammélioration des anciennes téchnologies et les anciennes inventions comme la fusée, l'ordinateur, aérodynamique, les autres les formulas fondamentales et les ancients prototypes ont été inventés par les Africains et les Chinois. Par éxemple, les Chinois ont experimenté l'utilisation de la fusée, les Africains ont inventé le système binaire qui est toujours utilisé par les médiums Yoruba et qui a été copié par un scientifique Allemand, et appliqué pour le programmage de l'ordinnateur. De nombreuses formules en trigonometrie, calculus, et physique aussi bien que la Chimie (Khem mysticisme) viennent des découvertes scientifiques des noirs en Egypte et en Nubie-Koush.
La plupart des découvertes scientifiques Occidentales Européenes ont soit été copiés des découvertes originales des Africains ou des Chinois, ou soit été mis en utilisation pendant les périodes du 16è au 20è siècles. C'est pendant ces périodes cruciales que certaines grandes découvertes scientifiques et technologiques ont été accomplis. Cependant ces decouvertes et inventions ne sont que des ameliorations des anciennes décourvertes faites par les Africains, les Chinois, et les Kushites noirs Arabes. Par éxemple, comme cité precedemment, la poudre á cannon était déja inventé par les ancients Egyptiens et Nigériens (qui utilisaient la noix de Cola pour faire de la poudre á cannon). Les Chinois l'ont réinventé et l'utilisaient pour faire des feux d'artifices et des éxplosives. Le metal était inventé par les Africains en ancienne Tanzanie. LES POMPES HYDROLIQUES POUR SOULEVER L'EAU ET L'IRRIGATION ETAIENT INVENTE PAR LES AFRICAINS EN EGYPTE. Des milliers d'autres inventions ont été inventé par les Africains, y compris d'autres dans les nations Antiques comme la Chine, l'Inde, qui tous les deux étaient originellement des civilisations noires.
Pendant la période de la domination noire face au vol des Européens et des Arabes, et l'ésclavage des Africains, les Africains et les noirs, qui ont contribué á la civilisation mondiale, se battaient pour leur survie. Cétait le cas dans le monde entier. Par éxemple, pendant que les noirs en Afrique se battaient contre les Européens et la colonisation des Arabes et l'invasion de leurs terres, ils se battent tout comme aujourd'hui contre les Malay invahisseurs á l'Est Timor, Iran, Java, et les autres régions de l'Asie du Sud-Est, le Pacifique, et la Malesie. Aux Etats-Unis les nations Aborigènes noires, comme les nations Washitaw, les Caraibes noirs des Antilles, les Indiens Afro-Dariente du Panama, les noirs du Yamasee du Sud-Est des U.S.A, et d'autres nations noires qui exitaient aux Etats-Unis et dans les autres parties des Amériques depuis des milliers d'années avant Christophe Colomb. Ces nations sont devenues victimes du complot internationale concocté par le Pape Catholique dans les années 1400 qui sollicitait l'ésclavage des soit-disant déscendants de "Cham." Cette monstrueuse atrocité était basé sur un des plus grand mensonges jamais concocté. Comme le même mensonge que la terre était plate, ou que que la terre et l'univers n'avait que 6.000 ans. Maintenant, nous savons que ces opinions sont que des mensonges.
Ce sont ces grandes atrocités et l'utilisation la technique "de division pour mieux conquerir" qui a engendré la malheureuse situation où les noirs se trouvent et qui les poussent á se battre contre leur propres frères et soeurs, ce qui a aidé á affaiblir les noirs á travers le monde, á cette époque et de nos jours. En effet aujourd'hui, non seulement les déscendants de ces comploteurs méchants ont detruit et apporté le chaos aux noirs, mais ils sont toujours en train de d'effectuer leurs sales actions. Ils ont contribué á la déstruction de la famille des noirs aux Etats-Unis, ont dupé nos femmes á ne pas avoir beaucoup d'enfants. Une large parite de la population noire est un danger á cause de leur oppression, hostilité, et méfiance.
21. Si les Africains en Afrique, dans les Amériques, dans les nations Arabes, dans l'Empire Washitaw (qui comprenait plus de 15 million d'acres dans le territoire de la Louisiane des Etats-Unis), en Inde, en Sud-Est Asie, en Europe (où les noirs Maures ont introduit la civilisation mais ont été éxpulses de l'Europe en 1492), étaient restés dans des conditions de liberté et laisser libres de continuer á se developer, ils auraient été aujourd'hui les peuples les plus développés économiquement, politiquement, et militérement. Le système de caste raciste en Inde a été introduit par l'infiltration des Aryans et qui ont changé les ancients livres sacrés des Koushites pour leurs désirs racistes. Selon les écrivains comme Drucilla Dunjee, Runoko Rashidi (Dalit: The Black Untouchables of India) et Ivan Van Sertima/Runoko Rashidi (African Presence in Early Asia), les noirs d'Inde ont été forcés au caste par les doctrines religieuses et les tricheries des envahiseurs qui ont utilisé les anciens traditions tribales et qui ont crée un syteme de caste basé sur la couleur de peau "varna" pour subjuguer les Indiens Noirs Koushites d'origines Africaines. Les Indiens Africains Koushites sont les premiers habitants de l'Inde et ce sont eux les premiers qui ont crée une des plus grande civilisations lá-bas. Aujourd'hui leurs déscendants sont appellés les "intouchables," ou les Dalits, et ils sont du même type raciale, origines, type sanguin, couleur de peau, traits facials, et language que les Koushites qui se trouvent á travers l'Afrique de l'Ouest jusqu'au sud de l'Arabie, en Inde et au Cambodge, et qui constituent la population la plus nombreuse de l'Inde et l'Asie du Sud.
Les noirs en Afrique éffectuaient des progres scientifiques, éducationelles, sociales, et economiques avant les invasions des Arabes et des Européens. Leur developpement téchnologique, scientifique, éducationel, religieux, et culturel s'est interrompu á cause du racisme et du colonialisme des Européens et des Arabes ainsi que de l'ésclavage. Dans autres parties du monde les peuples qui ont se sont acharné á resister aux invasions des Européens dans leurs terres et qui voulaient developer leurs propres technologies ont reussi á le faire et aujourd'hui ils sont parmis les nations les plus avancés materiallement et téchnologiquement. Les Japonais sont un exemple typique.
Les noirs dans le monde entier auraient pû continuer leurs traditions qui remontent á plus de 10.000 ans avant J.C, l'époque où parait-il qu'Ausar (Osirus) a écrit des milliers des livres traitant des sujets de l'Art, la religion, les sciences, et la téchnologie, comme le "Pyminder Divine," le Kaballion" et la "Tablette d'Emeraulde." il ya plus de 10.000 ans et qui sont á l'origine de la culture contemporaine (á lire "African Civilisation Revisited" by Ivan Van Sertima, Transaction Plubications, Rutgers University, New Bruinswick, NJ 08903).
Ausar, qui était un pure-noir Africain, est honoré pour avoir inventé la civilisation. Durant son époque, les noirs ont ammelioré et avaient precedemment inventé les sciences et la téchnologie qui existaient depuis plus de 10.000 années en Afrique Centrale ainsi que dans le corridor du Sahara, et dans la Vallée du Nile. En fait d'après Wayne B. Chandler une civilisation aquatique composée de noirs qui éxistaient dans la region qui est maintenant le Sahara et dans d'autres parties de l'Afrique de l'Est et de l'Ouest. Ces endroits étaient couverts d'eau et les Africains avaient construits des navires et des vaissaux pour voyager en mer avec lequels ils traversaient le Sahara á l'epoque où l'humidité remplissaient d'eau les lacs, l'ocean Atlantique et l'Ocean Indien (ces derniers étaient appellés "La Mer Ethiopienne" par les Ancients). Ce sont les ancients Hawaiens, les Melanésiens et les autres peuples négritiques d'Asie, en incluant les Aborigènes d'Australie qui sont tous des émigrés qui viennent de l'Afrique de l'Est pendant la période qui remontent á 100. 000 et récemment 2.000 avant J.C.
PEU DE NOIRS ONT VECUES DANS DES CONDITIONS DE SOUS-DEVELOPPEMENT AFIN D'ECHAPPER AUX INVASIONS DE LEURS TERRES ET A L'ESCLAVAGE IMPOSES PAR LES AUTRES PEUPLES.
Le soit-disant "sous-dévelopment" de quelques groupes de noirs isolés dans certaines parties du monde étaient dû á des facteurs importants: les invasions de leurs terres au cours des guerres, et les captures, et ésclavage de leurs peuples par les envahisseurs. Les dures conditions de l'environement, l'isolation, et le manque de resources ont également contribué á l'inabilité de leur developpement au modèle de la majorité des Royaumes, Etats, Empires et des societés noires Africaines. Ce development retardé naturel á cause de l'environement et des facteurs humains a été utilisé par des racistes pour representer la race noire comme comme étant naturellement "sous-developpée." A cause de ceci toutes les cultures et civilisations noirs ont été jugées en fonction des rares qui ont été isolées et qui ont regressé alors que jadis ils étaient des grands peuples. Cette hypocrisie raciste est telle que même en Inde dont les noirs Dalits, les noirs Nagas, et les autres peuples Koushites, ont batis et developpés des civilisations avant l'arrivée et les invasions des barbares nomades qui venaient du nord de l'Eurasie et dont les déscendants continuent de classifier certains des ces Noirs Koushites comme une "caste d'arrierés."
Ceci sont quelques facteurs qui ont été negligés par les historiens et les scientifiques racistes lorsqu'ils critiquent les cultures noires qui ont semblé avoir regressé materiellement et culturellement:
- Les noirs marginaux qui vivaient á la périphérie des grandes civilisations et cultures noires sont peu nombreux, mais les historiens et scientifiques Européens ont insisté et continuent á dire qu'elles representaient la totalité des cultures et l'apogée des noirs.
- La plupart des cas, la situation de ces noirs étaient dû aux invasions éxterieurs et aux attaques continuelles sur eux (comme c'est le cas des peuples pure-noir du Soudan les Dinka, les Nubaa, les Nuers et les Nubiens qui jadis étaient les maîtres de l'Egypte Antique et de la Nubie-Koush, mais qui sont oujourd'hui chassés comme des chiens et marginalisés par les Arabes-envahisseurs du Sudan).
- Il éxiste beaucoup plus de personnes de race Mongoloide qui vivent et continuent de vivre de façon marginale ou dans des conditions "primitives" en Amérique et en Asie qu'il ya des personnes noires qui vivent dans de telles conditions en Afrique ou en Asie. Pourtant personne affirme que les Mongoloides, ou les Asiatiques, sont des arrierés parce que la culture de certains de leurs peuples n'est pas aussi avancées que ceux des populations Chinoises ou Japonaises.
- Les blancs Européens qui vivent dans certaines regions rurales de la Russie ont vecu, et vivent encore, dans des conditions plus primaires que certains peuples isolés en Afrique ou en Melanésie. Ces Russes sont pauvres. Leurs maisons sont pauvrement batis et ils vivent de la chasse et de la ceuillete qu'ils pratiquent dans la forêt et dans la tundra.
La difference entre les Africains et les blancs qui vivent á la péripherie de leurs cultures et sociétes blanches les plus developpés ou qui vivent dans des villes et des centres culturelles est que certains Africains s'habillent en fonction de la chaleur, de l'humidité, du climat ensoleillé où ils vivent en Afrique et dans les tropiques, tandis que les paysans Russes et les Mongoloides s'habillent de manière appropriés pour se proteger du climat froid et glaciale du Nord. Mais, ce sont les Africains et les noirs des tropiques qui ont eu des cultures ayant un plus haut niveau que les Russes blancs et de certains peuples Mongoloides qui vivent dans les forêts de l'Amérique du Sud et en Asie, et de certains Polynésiens qui vivent de façon marginale ou "primitives." Peu d'Africains, ou d'autres noirs, sont marginalisés de façon similaire. Les Asiatiques, ou les Mongoloides, ou les Européens sont jugués en fonction des achivements des cultures retardés de leur race, mais en fonction des plus hautes achivements de leurs cultures les plus developpées. Par conséquent, les propagandes racistes qui ont été diffusées depuis le debut l'ésclavage institués par les Européens et les Arabes, et les propagandes contemporaines sont utilisés pour montrer que les noirs sont des arrierés dans le monde entier.
La verité demeure que les progres scientifiques, téchnologiques, et culturelles, et les contributions accomplis par la race noire surpassent plusieurs fois les contributions plus mineures des peuples qui n'auraient pas fait mieux si ils avaient dû faire face aux types d'obstacles placés devant eux par les Arabes et les Européens.
Mission de l'éveil de la Conscience de la race noire par Ammafrica World
L'HISTOIRE DU KONGO A TRAVERS SES ROIS
L'HISTOIRE DU KONGO A TRAVERS SES ROIS
Drapeau du Kongo. Introduit avant 1482
PREAMBULE
Le nom : selon le dictionnaire encyclopédique Universalis, “un empire est un ensemble de territoires dirigé par un empereur et, par extension, tout grand État multi-ethnique dont le pouvoir est centralisé et accessible à une partie seulement de la population“. Le Kongo est logiquement plus un empire qu'un royaume, car ce dernier vocable n'intègre pas la dimension de multi-territorialité. Si nous avons choisi ici de désigner ce pays par “royaume”, comme cela s'est répandu, nous ne taisons toutefois pas la revendication de rebaptiser cette entité de façon plus conforme à sa réalité, c'est à dire, Empire du Kongo.
L'écriture : Les mots et noms autochtones sont écrits selon l'alphabet Lingala (voir Dzokanga, Le dictionnaire du lingala). Il faut lire par exemple gi pour gui, u pour ou, ou encore e pour é. Les pluriels français sont exclus, pour respecter la pureté du mot qui dans certains cas se déclinera avec son pluriel en kongo (exemple: “bakongo” au lieu de “kongos“), mais aussi pour permettre un référencement plus facile sur internet. Kongo s'écrira “koongo” lorsqu'il s'agit d'un adjectif.
LES ROIS DU KONGO
![[Ima_Blo.jpg]](https://1.bp.blogspot.com/_WTVMy-GZq58/SW9nV5fQCII/AAAAAAAAAe4/Lgqk-CGUTOY/s1600/Ima_Blo.jpg)
Les biographies royales sont principalement tirées de Giovanni Antonio Cavazzi da Montecuccolo(1621-1678) un missionnaire capucin italien, célèbre pour son “Istorica Descrizione de 'tre regni Congo, Matamba ed Angola (Bologne, 1687). 10 volumes suivront dont le dernier n'a été publié qu'au XXè siècle. Lire aussi “Oliver, Roland et Atmore Anthony: “Medieval Afrique, 1250-1800″ Cambridge University Press, 2001 Cambridge University Press, 2001 - Thornton, John (2001). “The Origins and Early History of the Kingdom of Kongo, 34 (1): 89-120. ISSN 0361-7882. Published by Boston University . Heywood, Linda M. et John K. Thornton: “Les Centre-africains, les Créoles Atlantique, et la Fondation des Amériques, 1585-1660″, page 142. Cambridge University Press, 2007 Cambridge University Press. Thornton, John. Warfare in Atlantic Africa, 1998. London: University College of London Press. -bibliographies à compléter
ROIS LEGENDAIRES
vers 350 Nsasukulu a Nkanda (prophète)
vers 420 Kodi Puanga (prophète)
vers 520-530 Tuti dia Tiya (prophète)
NB: Ces rois légendaires sont sans doute des guides ayant conduit les peuples pré-kongos, voire pré-bantous (ou protobantous) durant le long exil à la recherche d'une patrie agréable. Les légendes attribuent à beaucoup d'entre eux des pouvoirs surnaturels invraisemblables.
ROIS SEMI-LEGENDAIRES (A partir de 690 à 1370

Narmer ou Nimi*
Nimi ya Lukeni, le Père Fondateur.
Dans le petit Etat de Mpemba, situé au sud de Matadi, une dynastie de princes se construit le long de la vallée du Kwilu (ou Kouilou, écriture la plus répandue de nos jours). Le cimetière sacré à Nsi Kwilu*, la capitale de Mpemba, où furent enterrés ces monarques, est resté un haut lieu saint koongo jusqu'au XVII ème siècle. Vers le VIIè siècle un prince de Mpemba (Nimi) conclu une alliance avec le Prince (Nsakulu?) de la principauté voisine de Mbata de l'autre côté du fleuve Kwilu, pour s'unir et se sécuriser contre leurs ennemis communs, c'est à dire les peuples sauvages du sud, les Kabunga (ou kahunga) qui vivent sur la montagne de Mwene Mpangala au sud, à partir de laquelle ils attaquent les villages de Mbata et Mpemba en vue de les piller. Les princes des deux terres civilisées (pratiquant l'agriculture, l'élevage, la forge etc.) s'entendent pour assurer leur succession l'un dans la lignée de l'autre. Au bout de quelques générations, les princes décident de sceller un mariage entre leur deux lignées. Le 3è descendant régnant en sera Nimi ya Lukeni.
Une fois au pouvoir, Nimi poursuit l'expansion de son royaume. Il conquiert le sud et soumet Mwene Mpangala à son autorité. Pour y marquer la pleine intégration des kahunga conquis, il implantera sa capitale sur la montagne chère aux Mpangala. Et, afin de lever toute ambiguïté, débaptise Mwene Mpangala en “Moongo Koongo”, la montagne “des rives unies”* et la capitale tout au dessus s'appelleraMbanza Kongo qui signifie, le siège du l'union, de la fédération ou simplement du le siège du pays.

Mbanza Kongo. Gravure du XVIè siècle.
Sous son règne, plusieurs petits Etats ou groupuscules autonomes tomberont sous l'escarcelle Koongo. Contrairement à l'esprit d'union des autonomies qui a prévalu à la création de ce pays, Nimi mettra en place une administration ultra centralisée, laissant aux chefs de provinces conquis, adhérents volontaires ou nommés, le pompeux titre de Mwene (”mani” est la traduction portugaise) qu'il porte lui-même, mais en réalité, sans en leur laisser le moindre pouvoir. Des sous administrateurs seront nommés pour trois ans avec pour rôle de circuler régulièrement à travers le royaume, pour collecter l'impôt, rendre la justice, transmettre des directives, entretenir des relations avec les voisins du royaume et renseigner le roi. Il a jeté les premières bases du pays.
*Toutefois, son côté légendaire vient du fait que plusieurs des actions qui lui sont prêtées ont été accomplies en une période trop longue pour que ce soit le fait d'un seul. Plusieurs rois se sont sans doute succédés durant des générations pour accomplir cette oeuvre. Mais la mémoire collective n'a retenu que le plus grand d'entre eux, Nimi le Grand. Il n'est pas impossible non plus, vu les similitudes mythologiques, que Nimi ne soit autre autre Narmer, premier roi de Kama, l'Egypte antique, dont l'image de “père fondateur de civilisations” a traversé les ages. Sans doute, les rois suivants ont été parmi les bâtisseurs des structures de ce royaume:
- Muabi Mayidi
- Zananga Mowa
- Ngongo Masaki
- Mbala Lukeni
- Kalunga Pun
- Nzinga Sengele
- Nkanga Malunda
- Ngoyi Malanda
- Nkulu Kiangala
- Ngunu Kisama.
*Nota: Koongo signifie aussi “rive”. On peut évoquer d'autres hypothèses. En effet, Kongo peut se saisir aussi par “union fédérale” car constitué de trois parties, ou “trois rives”. Et pourquoi pas, le peuple de la panthère “Ba-nkua-Ngo“, puisqu'il est avéré que cet animal est l'emblème du roi. Ka-Kongo est le nom d'une étoile à qui plusieurs légendes koongo prêtent d'avoir été le berceau de ce peuple, avant d'être déchu du monde des dieux et d'échouer sur terre. Or Ka-kongo a été une province qui recouvrait celle de Mbata, berceau légendaire des Kongo, plus que Mpemba. Les ba-zoulous (qui signifie “peuple du ciel”) sous groupe Koongo aujourd'hui habitant majoritairement l'Afrique du sud s'en revendiquent plus que tous les autres. Toutes ces pistes qui ont leurs adeptes sont plus ou moins plausibles et rien n'exclut de les associer toutes pour se reprocher de la vérité conceptuelle de ce mot. L'approche politique du mot “Koongo” n'est pleinement traductible qu'en allemand, par “bund“, utilisé tantôt comme “union”, tantôt rendu par “fédération” ou encore “national”; il concentre la même complexité. Surtout lorsqu'on sait qu'en langue Koongo, bundu signifie justement l'union, l'assemblée, le regroupement. Le Bundu dia Kongo mouvement politico-religieux fondé en RDC par Ne Muanda N'semi en 1969 pour ressusciter le royaume du Kongo utilise le même mot “Bundu”, qu'il traduit par “royaume”.
*Nsi Kwilu: de “nsi” = pays, et kwela = alliance, ce qui donne “la terre de l'alliance”.
ROIS REELS (Vers 1370),
- Nganga Makaba
- Nkanga Nimi
- NKuvu Mutinu. On sait peu de chose sur lui, sauf qu'il a accepté d'être roi après que ses deux cousins se soient désistés. On lui prête d'être le père de Nzinga Nkuvu.
Jean Ier, Nzinga a Nkuvu avant 1482-1505 (ou 1507),
Portrait de Jean Ier Nzinga Nkuvu.
En portugais, João ou Dom João, d'où il est aussi appelé en koongo “Ndo Nzuawu” par intégration linguistique.
Gouverneur de la province septentrionale de Nsundi et de Nzaza Vumbi (connu sous le nom de “Plateaux batéké” aujourd'hui), il s'était forgé une grande expérience militaire, en luttant sans cesse contre lesnziku (anzique en français, aujourd'hui appelés tékés. Nziku signifie “invité” en kongo). Cela lui permit d'arriver au pouvoir par coup d'Etat quand l'occasion se présenta.
Son règne allait connaitre des bouleversements inédits. En effet, c'est à son époque que l'explorateur portugais Diogo Cão (plus correcte que “Diego” qui s'est répandu, et pour le nom, Cao, lire “con“) arrive à l'embouchure du fleuve Congo en 1482. Il rencontre le roi à Mbanza Kongo et y réside une année. Après ce premier contact, le portugais repart laissant quelques soldats sur place et emportant avec lui des membres de la famille royale koongo. Il les place dans des couvents au Portugal où ils vont étudier la langue portugaise, le latin, les maths, les sciences physiques et la théologie durant près de 8ans. En 1491 il les ramène au Kongo en s'accompagnant de prêtres et de divers artisans. Le roi et sa famille acceptèrent le baptême le 3 mai 1491, se baptisant Jean pour le roi, en hommage à son homologue portugais, Eléonor son épouse et Alphonse (Afonso en portugais) pour son fils.
Aquarelle signée du père Bernadinio Ignacio, un capucin, en 1740
Deux ans plus tard, il refuse de gouverner son pays selon les principes de la Bible qui lui est expliquée. Pour des raisons politiques, notamment au sujet de l'interdiction de la polygamie. En effet, sa couronne tenait d'un certain nombre d'alliances conclues avec des princes intérieurs et alentours qui lui donnèrent soeurs et filles en épouses à lui et à sa cour, de sorte que les descendants matrilinéaires régnassent. Y renoncer serait dissoudre tous les fondements du royaume. Divisant les notables entre progressistes chrétiens et conservateurs koongo, il mourra sans avoir résolu la question.
Le plus progressiste fut son fils Mbemba dit Afonso, tandis que l'aile des conservateurs était mené par son neveu (fils de sa soeur et héritier potentiel), Mpanza qui jouissait du soutien de la plupart des notables et même du peuple. Nzinga Nkuvu Ndo Ndzuau Jean Ier repoussa en le nommant gouverneur de Nsundi. Ce dernier s'y retira avec la plupart des missionnaires portugais, ainsi que des nobles locaux du camp des progressistes.
Le roi Jean profitera des armes portugaises pour infliger une ultime correction aux tékés qui lui avaient donné tant de fil à retordre. Muni de ces outils, il allait agrandir considérablement le royaume sur une ligne allant de Kinkala à Vinza en passant par Madigou-Kayes, soumettant plus fermement les kakongo (au sein desquels les loango), les ngoyo, les Yombé restés quasi sauvages et les Mpumbu à l'est (actuel Kinshasa), jusqu'au désert du Kalahari, les différentes Cités-Etats dont la plus puissante Ndongo, lui était déjà soumise. Il avait une telle autorité et un tel rayonnement dans son royaume et autour de lui, que Diogo Cão ne cessa d'en faire l'éloge parfois surréaliste à la cour du roi du Portugal.
Alphonse ou Afonso Ier, Mbemba ya Nzinga (1505-1543).
Comme son père, il fut nommé gouverneur de la province de Nsundi. Cette province qui enjambait le fleuve Congo au nord est du royaume (actuel sud des régions de la Bouenza et du Pool) avait une signification particulière: elle était le lieu d'origine de la ligné du roi, à tel point qu'elle était considéré comme la propriété personnelle et privée de la famille du roi; aussi, c'est de Nsundi et des voisins téké, que venait l'essentiel du fer utilisé dans le royaume. Avec le fer on forge des armes, avec les armes on fait la force du pays. D'ailleurs le métier de la famille royale était celui de Ngangula, en français forgeron. Donc une province stratégique. L'habitude faisait que le futur roi devait y avoir fait ses preuves. La simple nomination comme gouverneur de Nsundi signifiait déjà, successeur désigné du roi! Sans compter la réputation de ses femmes et de ses guerriers, excellents athlètes dont beaucoup faisaient la garde rapprochée du Mwene Kongo.
A la mort du roi Jean Ier Nzinga Nkuvu, la mère d'Alphonse craignant que Mpanza et les conservateurs (restés majoritaire à Mbanza Kongo) ne prennent le trône, dissimula le décès le temps d'avertir son fils. Si bien que lorsque la nouvelle fut officiellement annoncée, Mbemba était déjà aux portes de la capitale avec l'ensemble de ses troupes, les plus nombreuses et les plus expérimentées du royaume à l'époque. Il fut élu roi malgré les protestations de son frère Mpanzu et grâce aux armes des portugais qui soutenaient le progressiste qu'ils voyaient en lui. Une fois roi, Mbemba gouverna avec des prêtres portugais qui le radicalisèrent dans sa foi et dans l'occidentalisation du pays. Son cousin maternelMpanza, opposé à la christianisation, leva une armée pour prendre le pouvoir avec le soutien de tous les conservateurs anti-occidentalisation alors majoritaires. Lors de la bataille qui s'ensuivit entre les troupes des deux frères, Mpanzu fut vaincu, parait-il grâce à l'apparition de Saint-Jacques-le-Majeur dans le ciel, venu au secours de Mbemba qui l'avait invoqué en prière. Ce qui mit les armées de Mpanzu en débâcle. Afonso Ier MBemba Nzinga immortalisera cet évènement par un blason que les rois du Kongo utiliseront pendant 3 siècles au cours des guerres, jusqu'en 1860.
Blason militaire d'Afonso Ier
Outre le fait que c'est sous son règne que les portugais commencèrent l'esclavage (sur des voisins, ennemis du Kongo ou prétendus sauvages) son règne fut celui d'un érudit. On dit qu'il lisait tous les jours jusqu'à épuisement. Il créa dès 1509 une grande école à Mbanza Kongo, l'Ecole royale, avec 400 étudiants triés parmi les nobles et qui dès 1516 comptait plus de 1000 étudiants. On y apprenait les lettres, les mathématiques, et la théologie. Plus tard elle aura un rôle plus universitaire, cédant à d'autres écoles moyennes implantées dans les provinces le rôle de la formation de base. Une de ses soeurs ouvre à la même époque une école pour les filles. Une autre partie de l'élite (quelques dizaines d'individus) est formée au Portugal. Son fils, Henrique (Henri en français), alla étudier dans un séminaire au Portugal dès 1508, fut prêtre puis élevé évêque d'Utique (Tunisie, près de Bizerte) le 5 mai 1518. Il regagna le Kongo en 1520 ou il fut nommé gouverneur de Mpangu tout en exerçant sa charge ecclésiastique jusqu'à sa mort en 1531. Un autre, neveu du roi, étudia à Lisbonne et y fut professeur des humanités (particulièrement en linguistique et philosophie kongo).

Poste de missionnaires en pays Kongo, Probablement peint par un kongo autochtone en 1740 (Turin, Bibliothèque civique. ).
Il est le premier roi africain reconnu par une nation européenne et par le pape d'où il eut le droit d'avoir son propre ambassadeur auprès de ce dernier. Il construisit des églises, modernisa son administration fiscale et tenta de créer des manufactures locales. On connait les moindres détails du règne de Mbemba ya Nzinga Afonso 1er, grâce aux très nombreuses et longues lettres qu'il envoyait au roi du Portugal pour expliquer ses besoins, mais aussi se plaindre du comportement de nombreux fonctionnaires portugais. Ces lettres témoignent de la croissance des appétits portugais sur son royaume, et aussi de sa propre boulimie du développement par les produits européens, qui a favorisé la dépendance de son pays et de la sous-région à l'esclavage. C'était la seule monnaie d'échange qui intéressait les portugais. Lorsqu'il se plaint de la dépopulation et du fait que les portugais enlèvent des enfants purs kongos et des fils de nobles issus de ses vassaux (le mot vassal se dit “protégé” en koongo), il est trop tard. Il se bat pour organiser et règlementer chaque activité des portugais, mais il ne tient que difficilement, ceux ci s'étant bien implanté sur l'île de Sao Tome et commencèrent même à prendre racine au sud du royaume, l'Angola. En 1539 Afonso subit un attentat qui tua deux notables. Les coupables sont portugais. Il meurt en 1543.
Pierre (Pedro) Ier, Nkanga Mbemba (1543-1545).
Fils d'Alphonse 1er il fut immédiatement contesté. D'abord parce que la succession filiale introduite par son père selon les habitudes portugaises n'était pas coutumière au Kongo, et aussi parce que le pays était divisé entre les conservateurs et les modernistes, chrétiens et ancestraux, pro-portugais et xénophobes, en y ajoutant le fait que certains notables étaient anti-chrétiens, mais commerçant aisément avec les portugais, tout en s'opposant à l'esclavage…! Pierre, pro portugais, fut vaincu par ses rivaux, qui le renversèrent en 1545, il n'eût la vie sauve qu'en se réfugiant dans une église. Subterfuge intelligent, sachant que son principal rival, qui n'est autre que son neveu Jacques (fils de sa soeur) qui se prétend chrétien - mais ce dont il ne croit pas - n'oserait pas venir profaner une église pour l'y déloger. Son frère François assura une courte régence, pour retenir les ardeurs de Jacques (Diogo, chrétien mais anti portugais). Pierre, pu quitter discrètement Mbanza Kongo et s'enfuit vers Sao Tome. De là il tenta d'organiser plusieurs coups d'Etat avec l'aide des portugais pour reprendre le pouvoir, appelant jusqu'au soutien du roi du Portugal et du Saint-Siège dans plusieurs courriers.
François Ier. Régent.
Jacques Ier, Nkumbi Mpudi ya Nzinga (1545-1561).
Diogo en portugais. Chrétien opportuniste, il veut utiliser l'église pour servir ses ambitions commerciales, et pas pour convertir la mentalité de son peuple. Comme le fit son arrière grand père Nzinga Nkuvu. Mais son règne fut marqué principalement par son souci de conserver le pouvoir. Il envoya un ambassadeur extraordinaire auprès du pape (menée par un créole, Diogo Gomes, né et ordonné prêtre à Mbanza Kongo) pour solliciter l'envoie de “nouveaux missionnaires de bonnes moeurs“, selon ses termes, mais en revanche exige que le port de Mpinda dans la province de Soyo reprenne son rôle de port unique sur la côte Kongo. Il reçut des missionnaires, mais en expulsa aussi beaucoup, même l'évêque de Sao Tome. Sous son règne, l'église catholique est à peine toléré, et chaque construction d'église ou enseignement d'école, donne droit à une marchandage serré avec le roi qui impose en retour un avantage commercial pour son pays. En 1555 à la suite d'une querelle avec des marchands Kongo, il expulse quasiment tous les européens de Mbanza Kongo. C'est dans cette quasi clandestinité que le catéchisme est rédigé en Kikongo en 1557 par des franciscains, ce qui en fait le premier ouvrage connu publié dans une langue bantoue.
Les portugais essayèrent longtemps de remettre sur le trône son oncle Pierre. Mais Jacques déjoua tous leurs plans et réseaux de soutien. Le roi mourut le 4 novembre 1561.

Dames de la cour
Alphonse II Mbemba ya Nzinga (1561).
On sait peu de chose sur lui. Selon les légendes, il serait le fils illégitime de la soeur de Jacques Ier, voire le fruit incestueux entre celle-ci et son frère le roi Jacques qui par souci ultrasécuritaire craignait jusqu'à être empoisonné par une femme s'il introduisait une étrangère dans son intimité. D'où le fantasme de lui prêter une relation incestueuse avec sa soeur, de laquelle serait né Alphonse II.
Aussitôt le roi Jacques mort, Alphonse s'autoproclama successeur, mais les notables refusèrent de l'introniser parce que pion des portugais et soupçonné de la mort de Jacques. Après des semaines de palabres sans issue, les portugais décidèrent de l'introniser eux-mêmes, dans l'église. Puisque le pays vivait une véritable dualité de culture, entre la kongo et l'européenne, avec des partisans de part et d'autres, cela pouvait passer. Mais le peuple se souleva et massacra de nombreux européens, et Alphonse II périt dans les émeutes.
Bernard Ier (1561-1566)
Son lignage n'est pas certain. Son règne fut troublé par le chaos causé par la traite négrière mais aussi des yaka (souvent mentionnés par Jaga dans les livres d'histoire à cause de l'inscription hollandaise qui prend J pour I), peuplades peu organisées que les koongo allaient razzier pour les livrer en esclavage auprès des portugais, et qui réussirent à résister plusieurs fois, voir à mener des contre-offensives dévastatrices. Le roi lui-même s'obligea à conduire ses armées vers eux pour une bataille qui promettait un butin riche en “bois d'ébène” (esclaves). Il fut tué durant les combats. Après sa mort, les Yaka réussirent à détruire une bonne partie orientale du royaume par des pillages à répétition et des incendies.
Henri Ier (1566-1567)
Henrique en portugais. Comme son prédécesseur, il fut tué au combat en allant guerroyer, cette fois-ci contre les téké du royaume d'Anziko (à l'est). Il avait laissé son fils adoptif comme régent.
CLASSES PAR KANDA (Dynastie ou clan)
A cette période, pour éviter l'arrivée au pouvoir des personnages aux lignages flous, la société koongo connait une restructuration profonde des lignages, des clans, de la noblesse et du mode de fonctionnement qui se rapproche de celui du moyen âge européen et de la féodalité.
Kanda dia KWILU Alvare Ier, Nimi Lukeni lua Mbemba (1568-1587) LE ROI LION 
Blason monarchique d'Alvaro Ier
De père inconnu, sa mère était la seconde fille d'Alphonse Ier, qui épousa son cousin Henri Ier. Régent de son père adoptif, Alvare 1er fut élu par les grands électeurs du royaume pour succéder à Henri une année plus tard. Mais peu après, à cause des invasions Yaka qui dévastèrent la capitale et à la brûlèrent, il abandonna le rocher pour se réfugier sur une île du fleuve Kongo avec plusieurs nobles. A partir de là, il demanda l'aide du roi du Portugal (Sébastien) pour revenir au pouvoir. Ce dernier lui envoya 600 soldats depuis São Tome où il tenait une prospère comptoir d'esclaves, sous les ordres de Francisco Gouveia Sottomaior. Le Portugal donna à ce dernier l'instruction d'aider le prince déchu mais aussi d'obtenir sa vassalité avant de le réinstaller au pouvoir.
Alvare signa l'accord de vassalité. Sottomaior le conduit d'abord à Luanda ou des troupes kongo réunis par les portugais l'attendaient. A cette époque, Luanda n'est pas inclus dans le royaume du Kongo, et les portugais en ont fait leur base principale sur cette partie du continent. Une fois à Luanda, Alvare fit assassiner Sottomaior, avant de regagner seul Mbanza Kongo avec ses troupes. Le Portugal ne crût pas à une mort accidentelle de Sottomaior et encore moins à la ruse d'Alvare qui consistait à nier avoir jamais entendu parler d'un accord de vassalité, et surtout pas de l'avoir signé. Le Portugal n'y cru pas un mot, et menaça directement Alvare. Ce dernier, ayant refait ces forces et repris Mbanza Kongo, monta une armée assez impressionnante qui dissuada le Portugal de toucher à sa souveraineté.
Dans un premier temps, le Portugal décida alors de créer officiellement la colonie d'Angola, pays au sud du royaume du Kongo, afin d'enraciner sa présence et de ne plus dépendre des structures administratives et humaines de Mbanza Kongo. Son premier gouverneur fut Dias de Novais. Pour montrer sa bonne foi et son désir de coopérer pleinement avec le Portugal sous cette nouvelle organisation dont Alvare trouvait l'avantage de ne plus voir sa souveraineté inquiété, le roi kongo porta souvent main forte au Portugal a pour combattre des roitelets voisins et assoir leur puissance, élargissant Luanda pour voir créer l'Angola. En somme, pour garder son trône, Alvare fit perdre beaucoup de couronnes à ses voisins. Un certain roi Ndongo lui posa beaucoup de fil à retordre, et plusieurs kongos moururent en combattant ses troupes.
Alvare premier poursuivit l'oeuvre d'européaniser le Kongo, et en fit plus qu'aucun roi ne l'avait fait avant lui. Flatteur zélé, c'est lui qui rebaptisa Mbanza Kongo en San Salvador (Saint Sauveur, une des appellations catholiques de Jésus, et aussi nom de la cathédrale de Mbanza Kongo, construite en 1517 par Afonso 1erMbemba Nzinga) afin d'obtenir les grâces du pape qui devait tenir le Portugal en laisse et lui offrir les moyens de son développeement.

Ruine de la cathédrale San Salvaror à Mbanza Kongo, de nos jours. Sera classé patrimoine mondial de l'UNESCO en 2010.
Finalement, les portugais avaient plus gagné en le gardant souverain, que s'ils avaient envahi le Kongo juste à la réinstallation du roi après l'exil, comme il était prévu. Alvare envoya un premier ambassadeur qui mourut en mer, avant de recruter un second, portugais cette fois ci qui devait porter un message de la plus haute importance à Rome chez le pape. Ce dernier, appelé Duarte Lopès, arriva fort tard, et Alvare Ier mourut avant d'avoir reçu la réponse. Toutefois, c'est Duarte Lopès qui raconta tout ce qu'il savait du royaume, de son histoire et de ces voisins, à Pigaffeta, qui le compila pour rédiger son célèbreRelazione del reame di Congo le plus célèbre livre sur le royaume du Kongo, publié en 1591. Alvare Ier fut un grand roi, extrêmement zélé et diplomate, travailleur et cultivé. Son message au pape était qu'il souhaitait placer le Kongo, directement sous l'autorité du pape. Parce qu'il sentait que le Portugal lui serait difficile à vaincre, ou à empêcher de grignoter toujours un peu plus sur sa souveraineté.
Alvare II, Nkanga Nimi (1587-1614).
Fils du précédent. Il monta au trône après une bagarre physique et directe avec son frère qu'il vainquit. En effet, les deux parties ayant des armées, décidèrent de ne pas faire couler le sang du peuple qu'ils désiraient tant diriger. Ils sortirent de San Salvador pour un chevaleresque corps à corps, en ayant prévenu les habitants de la capitale que le premier à revenir sera votre roi. Ce fut Alvare II. Entre 1590 et 1591 il fera face à une guerre civile à l'intérieur du royaume, assez dévastatrice mais encore mal connue. par les historiens. Hélas, car plusieurs princes gouverneurs et nobles du royaume commenceront à partir de cette guerre à réclamer des parts plus importantes d'autonomie. Pour calmer le jeu, il dut accepter virtuellement l'indépendance de la province de Soyo.
S'il est avéré qu'Alvare II commença son reigne avec le soutien des portugais dont son père calma les relations, c'est aussi très vite qu'il joua la diplomatie de son père: faire semblant d'être l'allié des portugais, et rechercher dans le même temps, des partenaires divers en Europe, notamment le pape. Il réussit dans cette diplomatie à faire de San Salvador un évêché, obtint de nombreux prêtres-ouvriers en plus, et même d'envoyer une ambassade kongo permanente au Vatican, en la personne de Antonio Manuel ne Vunda, conseiller du roi en matière religieuse, grand ordonnateur et grand prêtre du royaume. Sa lettre de mission auprès du Pape Paul V est sans ambiguïté: Alvare II réclame les mêmes privilèges que les autres rois chrétiens du monde. Demande que l'évêque du Kongo reste dans les limites de son autorité. Exige que l'évêque ne soit pas portugais parce que s'il l'est, il s'alignera aux positions de l'Angola. L'ambassadeur connaitra les mêmes déboires que ceux envoyés par Alvare 1er. En effet, parti en 1604, Antonio Manuel fut d'abord pillé par des pirates, avant d'arriver au Portugal puis en Espagne, ou il fut longtemps retenu, puis accosta enfin en janvier 1608 à Rome, pour y mourir le surlendemain. Il eût tout de même le temps de livre son message.

Buste en l'honneur de l'ambassadeur, dans la basilique Sainte Marie-Majeure au Vatican
Les relations d'Alvare II avec les portugais, souteneurs des rebellions et des revendications autonomistes dans son royaume étaient exécrables. Depuis Luanda ou l'île de Sao Tomé choisi par les potugais pour élever leurs métisses et diriger le commerce des esclaves, ils orchestraient les rebellions et les mouvements indépendantistes au sein des territoires du royaume, comme à Soyo. Son règne fut long, mais ne connu que peu de prospérité à cause de l'instabilité politique.
Bernard II Nkanga Nimi (1614-1615).
Fils du précédant. Il ne régna qu'un an, sans trop qu'on ne sache pourquoi.
Alvare III Nimi ya Mpanzu (1615-1622).
Fils d'Alvare II et frère cadet de Bernard II son prédécesseur. Ancien gouverneur de Mbamba. Son règne fut sans fait marquant particulier. A sa mort, il laissa un fils nommé Ambroise, et jugé par le conseil des grands électeurs comme étant trop jeune pour régner. Ce qui interrompit le règne de la dynastie des Kwilu.
Kanda (dynastie) dia NKANGA Ya MVIKA
Pierre II, Nkanga ya Mvika (Pedro en portugais, et “Mpika” au lieu de Mvika selon les accents du royaume) .(1622-1624). LE GRAND STRATEGE
C'est un sundi. D'abord chef du canton de Wembo (Marquis, selon la traduction portugaise et le nouveau code de la noblesse qui en est calqué), il fut ensuite gouverneur de la province de Mbamba (Duc). Avant d'être roi, il fut un des administrateurs les plus proches de Alvare III, mort en laissant un fils trop jeune, et des oncles trop agés. C'est sous Alvare qu'il modernisa les finances du royaume, en imposant notamment que chaque denier public dépensé comme récolté soit désormais noté sur un registre, et donc imposant des fonctionnaires obligatoirement lettrés. Il avait une sainte horreur de l'esclavage, et n'hésitait pas à accorder asile aux esclaves fuyant Luanda en Angola.
A la mort d'Alvare III et vu l'extinction de la lignée, le gouverneur portugais d'Angola Correia de Souza, profitant de l'incertitude politique leva une armée en direction de Mbanza Kongo affirmant qu'il avait le droit de choisir le futur roi pour s'assurer du bon voisinage. C'est ainsi que Pierre II, passant déjà pour le premier ministre du roi défunt, fut choisi précipitamment par les notables, comme par compromis pour faire face à la menace portugaise. Malgré son élection, la bataille contre l'Angola aura lieu. A Bumbi. Les portugais s'étant alliés avec les imbangala, un peuple du sud-est réputé cruel, formèrent une armée de plus de 20.000 soldats qui affrontèrent les troupes levées et menées pour le Kongo par les gouverneurs de Mpemba et de Mbamba pour le compte du roi. Les autres provinces kongos ayant passés des alliances secrètes avec le Portugal, et refusant de participer à la bataille, rendant les troupes du Kongo deux fois moins nombreuses. Malgré une bataille acharnée et menée avec un courage salué par les témoins portugais, les kongos furent vaincus et les deux nobles conduisant les troupes tués et mangés par les Imbangala. Les portugais annexèrent les territoires du sud du royaume à la colonie d'Angola.

Pedro II fou de rage pour la défection surprise de certains de ses gouverneurs, refusa d'en rester là. Il déclara la guerre à l'Angola et, sans hésiter, au Portugal tout entier. Il démit les gouverneurs qui ne s'étaient pas engagés au combat, en fit exécuter 4, regroupa lui même toutes les armées du royaume et fonça sur Luanda. Il rencontra les forces montées par le gouverneur de l'Angola Correia de Souza pour l'accueillir au combat, à Mbanda Kasi. Les koongo avec leur roi à la tête des troupes combattantes écrasèrent les troupes portugaises et alliées imbangala, avec une hargne devenue légendaire. Les portugais durent quitter totalement le royaume.
Le roi Pierre qui ne décolérait pas, refusa de signer par écrit l'acte de reddition de l'Angola portugaise, ne reconnaissant même plus cet Etat, et écrivit de vigoureuses lettres de protestation au Pape et au roi d'Espagne (en ce temps-là roi du Portugal aussi) pour se plaindre du comportement du gouverneur d'Angola Correia de Souza qui ne respectait aucun accord, aucun engagement et ne cessait de déstabiliser son pays. “Il n'a aucune noblesse, ni de coeur ni de manière” s'exclamait le souverain Koongo à son homologue au sujet du Gouverneur portugais d'Angola dont il exigeait d'être relevé. La plupart des portugais du Kongo (commerçants, artisans, instituteurs, religieux), étaient restés fidèles à Pedro et l'avaient soutenu. Il eut gain de cause, mais à condition qu'il livra 2000 esclaves. Il en céda 1200 et le gouverneur Joao Correia de Sousa fut relevé de ses fonctions et tomba en disgrâce. Il fut remplacé par Antonio Da Silva.
Toutefois, Pedro convaincu que le gouverneur ne faisait qu'appliquer le plan de Lisbonne de plus en plus machiavélique, s'empressa de conclure une alliance secrète avec les hollandais, contre les portugais. La Compagnie hollandaise des Indes orientales approuva ce plan qui consistait à attaquer Luanda: les hollandais auraient attaqué par la mer et les koongos par les troupes terrestres. Malheureusement Pierre mourut sans réaliser ce projet déjà signé, et qui ne verra le jour qu'en 1641.
Son règne fut court, mais si héroïque que le nom de Pierre, Petolo en kongo, devint un nom de famile très répondu en son honneur, et existant encore de nos jours. Très organisé et très cultivé, il passait beaucoup de temps avec les européens de son royaume, qu'il traitait avec tant d'autorité si bien qu'on le surnommait le roi des blancs. Il fut sans doute empoisonné par l'un d'eux, le frère Marco.
Garcia Ier ou Je Garcia, Mbemba ya Nkanga (1624-1626).
Fils du précédent. Il avait succédé à son père alors que nombre de notables considéraient le règne de Pierre II comme une simple régence. Son arrivée semblait affirmer le règne d'une dynastie Sundi. Etant dans la même vision que son père, Garcia laissa se dérouler le plan secret avec les hollandais. Mais tandis que la flotte hollandaise se déployait près de Soyo pour saisir Luanda, le gouverneur da Silva intercepta la délégation. Puis, feignant d'ignorer l'existence de l'alliance kongo-hollandaise, il réussit à convaincre les soldats de la Compagnie hollandaise des Indes orientales que la politique de Garcia Ier depuis sa prise de pouvoir était la paix entre le Portugal et le Kongo. Les hollandais se retirèrent. Le gouverneur de Nsundi, le métis Manuel Jordão (un troublion né d'un père Sao Toméen et d'une mère bien de Soyo), se servit de ce raté pour accuser le roi de traitrise et lancer l'assaut sur San Salvador. Garcia s'enfuit à Soyo avec sa femme et sa grand-mère. Jordão réussit à imposer Nkanga Nimi, fils d' Alvare III jadis jugé tros jeune pour gouverner et qui avait laissé sa place à Pierre II. Il réinstalla ainsi la dynastie Kwilu.
Kanda dia KWILU II
Ambroise Ier, Nkanga Nimi (1626-1631)
Fils d'Alvare III. Très vite il se défait de son encombrant bienfaiteur, Manuel Jordão qui l'a porté au pouvoir. Il le relève de son poste de gouverneur de Nsundi, tente de le faire arrêter, mais celui-ci s'enfuit et se réfugie sur une île. Le roi prit par une sorte de paranoïa, se mit à soupçonner tous les nobles de vouloir le renverser. Un climat de complot permanent s'installa durant tout son règne, jusqu'à ce qu'il fut assassiné en Août 1631. Un autre clan pris le pouvoir, les Mpanzu.
Kanda dia MPANZU
Alvare IV (1631-1636)
Ce fut un enfant de 13 ans. Sans règne fut sans fait marquant.
Alvare V (1636-1636).
A peine élu, Daniel da Silva gouverneur de Mbamba contesta son mode d'élection. Ils se livrèrent bataille près de Soyo et le roi faillit perdre, acculé au bord du fleuve dans un siège rude. Deux frères lui vinrent en aide: Nimi et Nkanga. Il s'agissait de deux ressortissants de la vieille noblesse, issus par leur mère des rois du Kongo et par leur père, du Nlaza, territoires orientales, allant au delà du royaume du Kongo, et à cheval sur les pays téké orientaux et au delà. Ils réorganisent les troupes et réussirent à vaincre le gouverneur rebelle. Le roi les récompensa en nommant le premier gouverneur de Mbamba, et le second chef du canton (marquis) de Kiova, un petit territoire sur la rive sud du fleuve Kongo. Puis aussitôt, il tenta de les faire assassiner. Ceux-ci en réchappèrent et réussirent à prendre le roi et à le décapiter. Le frère ainé devint roi, sous le nom de Alvare VI, installant du coup, une nouvelle dynastie, celle des Nlaza.
Kanda dia NLAZA
Alvare VI Nimi ya Lukeni ya Nzenze ya Ntumba (1636-1641).
Le 21 janvier 1641 il meurt dans des circonstances mystérieuses.
Garcia II, Nkanga ya Lukeni ya Nzenze ya Ntumba (1641-1660).
L'ALLIANCE HOLLANDAISE
Frère du précédent il était aussi le second fils de la princesse Lukeni, elle même fille de la princesse Nzenze, elle même fille d'Anna Ntumba troisième fille du roi Alphonse Ier du Kongo. Il étudia avec son frère au collège Jésuite de San Salvador (ouvert en 1620) et intégra la fraternité laïque de Saint Ignace. Chef du canton de Kiova (marquis) à la mort de son frère, il entra avec ses troupes dans San Salvador, obligeant le conseil des notables à le proclamer roi. Ce qui fut fait, mais le conseil posa la condition qu'il ne puisse nommer les hauts fonctionnaires. Car son caractère d'étranger, bien qu'uniquement paternel, posait quelques réticences. Il accepta.
Garcia II relança les pourparlers avec les hollandais qui, quelques semaines après son élection, lancèrent leur attaque sur Luanda. Conformément à l'alliance scellée par Pierre II en 1622, le roi Garcia II mis ses armées en ordre de marche sur Luanda pour porter assistance à ses alliés. Il réussirent à chasser les Portugais de Luanda. Le roi et les néerlandais ouvrir des négociations pour un accord d'amitié. D'abord, il rejeta l'idée néerlandaise de recevoir des pasteurs calvinistes. Le roi réaffirma sa foi catholique et celle de son peuple. La raison réelle était que Garcia craignait que les protestants n'ayant pas de pape, n'aient aucun pouvoir politique. Ensuite, le roi du Kongo désirait que les hollandais l'aident à jeter tous les portugais hors d'Angola. Les hollandais en étaient plus réticents. Ils désiraient juste prendre Luanda, établir un comptoir sur la côte et laisser les portugais continuer à déployer leurs activités à l'intérieur du continent. Toutefois, les hollandais consentaient à aider Garcia II à vaincre une rébellion dans le sud, sur le territoire de Nsala, à condition que les vaincus leurs soient donnés en esclaves comme paiement de cette aide. Ce qui fut fait en 1642.
Pour ne pas avoir écouté le conseil de Garcia qui était de reprendre la souveraineté de Luanda aux Portugais, les hollandais durent rapidement subir des attaques des portugais de l'intérieur et d'autres venus de la mer, pour récupérer Luanda. Sans l'aide du Kongo (handicapé par Daniel da Silva duc de Soyo qui refusait de donner ses troupes) les hollandais ne pouvaient pas tenir bien longtemps. Les forces portugaises à la recherche de troupes locales dans des royaumes du sud et de l'est de l'Angola, vont provoquer la colère de la reine Nzinga du royaume de Ndongo et Matampa qui entrera en guerre contre eux. Elle espérait sans doute une aide néerlandaise et Kongo qui ne viendra jamais. Les deux estimant qu'ils avaient plus à perdre car les armées de la reine étaient fragiles. Pourtant, après une première défaite honorable à Kavanga en 1646, le courage des troupes de la Reine Nzinga poussa les hollandais à envoyer une aide pour la seconde bataille.

La reine Nzinga
Ainsi, en 1647 à Masangano, le seul rapport qu'on a de cette bataille est écrit par un hollandais, qui affirme que leur rôle était juste de se montrer pour impressionner les portugais et que ce sont les troupes de la reine Nzinga seules, qui ont écrasé les portugais. Ils assiègeront même deux villes portugaises au delà de Masangano: Mutsima et Mbasa. Les Portugais pour réussirent à reprendre le dessus durent faire venir d'impressionnants renforts du Brésil, balayant et les troupes de Nzinga, et les hollandais qui se retirèrent définitivement de Luanda en 1647.
Forts de cette victoire, les Portugais préparèrent un accord drastique envers le roi du Kongo. Il prévoyait des concessions de terres, notamment Bengo et l'ïle au large de Luanda, la propriété sur toutes les mines du Kongo, et un droit de passage sur un certain nombre de lieu. Le Roi refusa de signer et de payer le moindre droit en trouvant à chaque fois des subterfuges politiques et militaires, notamment en fomentant de fausses rebellions ou attaques de peuplades sauvages menaçant et Luanda et Mbanza Kongo. Garcia foutait le trouble dans ses affaires intérieures pour faire croire aux portugais que de vraies raisons l'empêchaient d'exécuter leurs accords.
Dans ce chaos, il fit venir des missionnaires capucins d'Italie et d'Espagne qu'il pris comme conseillers, avant de les accuser de complot en 1652. Il fit arrêté Dona Léonora, une dame âgée de la cour de la dynastie précédente, fort respectée, qui moura en prison, brisant sa popularité. Il dû engager aussi de nouvelles guerres vers Soyo, ou Daniel da Silva redevenu gouverneur (après avoir été évincé un temps) se comportait en indépendant. Bien que les portugais aidaient le régime de Soyo, Garcia II réussit à les vaincre tous deux, à Soyo, dans une bataille qui ne fut pas sans rappeler celle de Bumbi en 1622. Deux des fils de Pierre II de la dynastie Sundi tentèrent également de le renverser. Il les vainquit en 1655, et obtint l'allégeance du reste des nobles sundis.
Premier roi à introduire une couronne dans une cérémonie d'intronisation au Kongo, Garcia II mourut en 1660 laissant une réputation de sa grandeur qui avait atteint le monde entier.
Procession au Kongo (1670)
Antoine Ier Mvita ya Nkanga (1661-1665). LA BATAILLE DE MBUILA
Fils de Garcia II le Grand, Antoine Ier ne pouvait que poursuivre la politique étrangère de son père, l'anti-portugalisme.
Depuis plus de 30 ans les deux pays étaient quasiment en guerre constante. Le portugal soutenait n'importe quel mouvement indépendantiste du royaume. Voici que la petite principauté de Mbuila, récemment souveraine, va avoir un conflit de succession entre un homme soutenu par le Portugal, et sa tante soutenue par le Kongo. Comme il était de coutume à l'époque, les deux nations rivales vont se fixer un rendez-vous pour la bataille. Ce sera la célébrissime bataille de Mbuila (ou Ambuila dans la transcription européenne). Vu l'enjeu (assez périphérique) et plus diplomatique que réellement politique, les koongo ne s'étaient que peu préparés à la bataille, mais plus à la négociation qui allait s'ensuivre, selon que l'on soit vainqueur ou perdant. Ils avaient emmener une kyrielle de notables ainsi que le roi, prêts à signer ou à obtenir des engagements, parcelle par parcelle, dans et autour du royaume, avec les portugais. Il fallait pour eux, régler un grand nombre de problèmes d'autorités qui secouaient les deux grandes nations locales, l'Angola (pays portugais) et le Kongo.
Les portugais par contre, avaient levé la plus forte armée jamais vue en Afrique. Ce 29 octobre 1665, les koongo subiront la plus écrasante défaite de leur histoire, voyant la mort de 5000 hommes, y compris le roi, ses deux fils, ses deux neveux, quatre gouverneurs, les différents fonctionnaires de la cour (95 titulaires) et 400 autres nobles. La province indépendantiste de Soyo, en a par la suite profité pour dévaster complètement Mbanza Kongo, surnommé par eux, Mbanza n'kuyu (le siège du diable). Les dynasties de Kinlaza et de Kimpanzu seuls survivantes de Mbuila pour n'y avoir pas été, se livrèrent ensuite une guerre acharnée pour le trône, entrainant une guerre civile qui dura plus de 40 ans et finit par morceler le grand royaume du Kongo.

Le Kongo au XVIIè siècle.
PERIODE D ANARCHIE

Portrait d'un roi Kongo en 1685. Sans doute imaginaire
Plusieurs rois régnèrent sur une partie du pays, se prétextant chancun “roi de tout le kongo”.
A Mbanza São Salvador
Alphonse II (1665). Membre de la dynastie Mpanzu, il fut mis au pouvoir par le prince de Soyo, anti royaume. Il fut renversé par la dynastie de Nlaza, un mois seulement après son arrivée. Il fonda le petit royaume de Nkondo d'ou il tenta d'organiser un retour au pouvoir en vain, jusqu'à sa mort en 1669.
Alvare VII (1665-1666)
Alvare VIII (1666-1669)
Pierre III Ntsimba Ntamba (1669; règne ensuite à Mbuula/Lemba). De la dynastie Kinlaza. Il fut chassé par les Mpanzu au bout de 5 mois de règne, et se retira à Lemba. En 1678 il tenta de reconquérir Mbanza Kongo par la force. Il tua le roi en place, Daniel Ier, et détruisit la ville. Il repartit à Mbuula/Lemba qui devint sa capitale. Manuel, frère de Daniel Ier monta un stratagème pour l'attirer. Il convainc le prince de Soyo de prétendre qu'il désirait donner sa fille à Pierre III afin que les descendants régnassent sur Soyo aussi. Pierre III fit le déplacement, entra dans la case ou l'attendait la mariée couverte d'un voile, mais ce fut en réalité Manuel sous le voile qui assassina Pierre III.

Ruine de San Salvador
Alvare IX (1669-1670)
Raphael Ier (1670-1673)
Alphonse III Mbemba ya Nimi (1673-1674). Roi de Nkondo jusqu'en 1673. Puis du Kongo durant un an.
Daniel Ier (1674-1678) Voir Pierre III
Abandon de São Salvador (1678-1709).
KIMPA VITA

Pendant près de 40 ans, le royaume se vautrait dans la guerre civile. São Salvador en ruine, les dynasties rivales avaient installé leurs bases dans l'arrière pays, à Lemba pour les uns, Kibangu pour les autres. A la fin du XVIIè siècle, apparut une jeune femme, Kimpa Vita, baptisée Dona Béatrice,affirmant être possédée par l'esprit de Saint Antoine. Il lui aurait donné mission de réunir le pays. En 1702 elle se rapproche de Pierre (Pedro) IV, régnant à Kibangu à l'est de la vieille capitale, l'enjoignant de remplir le rôle d'unificateur. Il lui aurait suffit selon elle, qu'il se réinstalla à São Salvador et saint Antoine aurait protégé son trône. Après le refus de Pierre IV, le trône de Mbanza Kongo étant devenu synonyme de déclaration de guerre pour quiconque l'occupe, elle se rabattit sur son rival Jean III (Nzuzi Ntamba) de Lemba appelée aussi Mbuula (les mannes), au sud du fleuve Kongo. Ce dernier qui n'osa lui non plus prendre le risque, avança pour prétexte qu'il était le roi légitime du Kongo, et que désormais la capitale serait chez lui à Mbuula/Lemba. D'ou la célèbre réplique de Pierre IV son rival, “Nkombo ka ghanda lemba, ndozi ngo kondo pele“, à savoir “si le bouc hérite du trône, il ne peut s'empêcher d'être troubler par des cauchemars sur le lion”). Elle prit son courage à deux mains et alla s'installa elle-même dans la capitale ruine, en prêchant sur son passage la renaissance du royaume grâce à sa révélation. Bientôt elle fut rejointe par des milliers de convaincus qui s'installèrent à Mbanza Kongo. Elle y développa sa pensée religieuse aujourd'hui connue sous le nom de doctrine des antoniens. [Le témoin qui rapporte le sens de cette doctrine faisant partie de ses bourreaux, l'historien doit prendre l'interprétation qu'il en fait avec des pincettes et non au pied de la lettre. Par crainte de mauvaise foi, ou simplement d'incompréhension d'un contexte philosophique Kongo]. A l'en croire, Jésus, Marie et saint François seraient selon Kimpa Vita, des Koongo. Bethleem se trouverait en Nsundi tandis que Jérusalem ne serait autre que Mbanza Kongo. “C'est notre propre religion qu'ils ont travesti et qu'ils essaient de nous revendre“, clamait la prophétesse.
Elle avait réussit très vite à ramener la vie et la paix à Mbanza kongo/Sao Salvador, mettant dans l'embarras les deux prétendants rivaux au trône. Mais en 1706, celle qui se disait vierge accoucha d'un petit garçon dont on attribua la paternité à Jean, son plus fidèle lieutenant. Les prêtres catholiques portugais en profitèrent pour l'accuser d'hérésie et faire douter ses adeptes de sa pureté, et donc, de sa sincérité. Ils donnèrent l'occasion à Pierre IV (qui n'avait pas digéré que la prophétesse eut recours à son rival) d'entrer dans la ville, de la saisir et de la laisser juger par les prêtres européens qui la condamnèrent pour hérésie et la brûlèrent au bûcher. Son action fut décisive à la réhabilitation et la réunification du royaume.
*Nota: Il faut relever qu'il n'existe aucun témoignage affirmant que Kimpa Vita eu une grossesse, ni qu'elle se cacha durant une période suffisante pour dissimuler une grossesse. Sachant qu'elle n'avoua pas non plus la maternité (elle aurait pu prétexter que c'est l'enfant mystique conçu par saint Antoine et qu'il sera roi), il semble probable qu'elle recueillit un orphelin. Le reste n'étant que prétexte pour récupérer le trône de la part du roi Pierre IV et empêcher une concurrence du culte pour les missionnaires locaux qui déployaient une énergie féroce afin de tuer la religion autochtone.
Pierre IV N'samu Mbemba (1709-1717) règne auparant à Kibangu, et est souvent qualifié de Pierre III, car beaucoup d'historiens réfutent que le IIIè Pierre prétendument régnant à Kimpanzu l'ai jamais fait. En février 1709, il s'installe à Sao Salvador grâce à Kimpa Vita qu'il a fait condamner au bûcher, et retrouva peu à peu la reconnaissance de son pouvoir au sein des populations. Les provinces et royaumes acceptèrent également de se soumettre à sa couronne selon les niveaux d'autonomie qu'ils avaient avant le trouble. Le royaume était d'utilité économique, politique et culturelle vitale pour toute la région. En 1716, son principal rival accepta de le reconnaitre, ayant passé un accord qui instituait une rotation au pouvoir entre les Kimpanzu et les Kinlaza. Après donc 51 ans de chaos remontant à la défaite d'Ambuila, Pierre IV par le sacrifice de Kimpa Vita réussit à restituer les frontières du royaume de Nzinga Nkuvu. D'où l'expression de “pays, fils ou descendant(s) de Nzinga Nkuvu” qui a survécu jusqu'à nos jours et se dit quand un Kongo veut affirmer sa fierté ou sa longévité inébranlable. “Moi, descendant de Nzinga Nkuvu, même la mort ne me pliera pas“, juraient les soldats Koongo.
Pierre Constantin da Silva, prétendant, tué en 1709
Entre-temps, à Kimpangu (ville appelée aussi Agua Rosada ) régnèrent aussi:
Garcia III (1669-1678)
André Ier (1678-1690)
Manuel Ier mort en 1693
Alvare X (1690-1694)
Pierre III (1695-1709)
A Nkondo
Alphonse III (1669-1673)
A Mbuula/Lemba
Pierre III Nsimba Ntamba (1669-1683)
Jean II Nzuzi Ntamba (1683-1716)
LA REUNIFICATION

Le Kongo en 1711
Pierre IV (1709-1717) (déjà cité).
Manuel II (1718-1743).
Son règne fut tourmenté. Son pouvoir resta très limité à cause de celui trop fort des comtes de Soyo. Les Sundi au nord se sentant délaissés dans l'accord du partage du pouvoir se comportaient plus ou moins comme indépendants, n'hésitant pas à provoquer certains troubles dans le royaume, affaiblissant sans cesse l'autorité du roi. Dans la province de Mbamba une guerre éclata en 1730, et le roi ne put que constater les dégâts. Il réhabilita la mémoire de Kimpa Vita. La cathédrale devant laquelle fut exécutée la prophétesse (construite en 1549) fut surnommée Nkulumbimbi, et une statue de la “Vierge-à-l-enfant” représentant une Marie noire et un Jésus aussi noir fut érigée en son intérieur.

“Sainte Vierge et l'enfant roi”
Inspirée de Kimpa Vita
D'ailleurs une classe d'artisans fabriquant des oeuvres religieuses représentant les personnages bibliques en nègre se développa dès cette époque. En 1992, le pape Jean Paul II donna une messe dans cette cathédrale, mais le clergé refusa d'évoquer la réhabilitation par l'Eglise de Dona Béatrice Kimpa Vita, et moins encore de sa canonisation.
Garcia IV (1743-1752).
Descendant des Kinlaza, donc successeur de Pedro IV dans cette lignée, conformément à l'accord conclu en 1716. Seulement, il existait plusieurs branches des Kinlaza et d'autres avaient refusé d'appuyer Pedro IV dans son accord de partage avec les Kimpanzu. Garcia était dans la lignée des fidèles. Ses cousins des autres lignées qui depuis 1716 s'étaient réfugiés dans le centre du royaume à Matadi, Lemba et aux bords de la rivière Mbizidi, finirent par faire sécession et fondèrent de petits royaumes.
Nicolas Ier (1752-1758)
Alphonse IV
Antoine II
Sébastien Ier
Pierre V (1763-1764).
Jusque là, la rotation des deux clans au pouvoir s'était passée sans problème. Mais Pedro V fut chassé du pouvoir par un Kinlaza et dû s'exiler à Luvata. Il y créa, ainsi qu'à Sembo, un tribunal royal, ou il exerçait cette attribution du roi. Ce qu'il pouvait encore faire, même en exil, auprès de ceux qui le reconnaissaient comme véritable souverain. Il ne reconnût jamais l'usurpation de son trône. Après sa mort, il eût même un successeur qui persista à revendiquer le trône des Kimpanzu volé par le Kinlaza Alvare XI.
Alavare XI (1764-1778).
Par son coup d'Etat renversant Pedro V, il rompait une alliance entre les dynasties Kinlaza et Kimpanzu qui avait survécu à 8 rois durant 38 ans. A sa mort Les kimpanzu se déchirèrent pour lui succéder, favorisant l'arrivée d'un autre Kinlaza.
Joseph Ier (1778-1784).
Kinlaza, de la branche qui refusa de signer le pacte de partage du pouvoir avec les kimpanzu en 1716 et qui se réfugia dans la vallée de Mbizidi. En succédant à Alvare XI, non seulement il ne reçut pas le soutien de ses cousins issus des non signataires, mais ils refusèrent aussi de soumettre leurs principautés au royaume du Kongo et du coup, annoncèrent leur séparation définitive de la fédération du Ntotila. Leur indépendance en somme. Affaiblit par le défection de ceux sur qui il comptait s'appuyer en premier, il dû accepter le défit de guerre que lui lança le successeur du kimpanzu Pierre V, désigné en exil. La bataille eût lieu en 1781. Joseph (José en portugais) mis en place une solide armée de 3000 hommes bien équipés qui réussit à battre son rival. Pour montrer son mépris à l'armée défaite, le roi José les enterra en position couchée sur le ventre. Faute du soutien de sa famille, il ne réussira pas à prendre d'assaut le territoire de Luvata ou s'étaient refugiés les Kimpanzu, qui s'y comportaient en concurrents et rebelles de son pouvoir. Les autres territoires importants qui lui échappaient, sont les terres autour du Mont Kibangu ou Pierre IV (celui qui profita de Kimpa Vita) fut réfugié en son temps. Ils étaient occupés par la famille dite Agua Rosada (Kimbangu), qui prétendait descendre à la fois des Kimpanzu et des Kinlaza. Avec de telles prétentions et si près de la capitale, Joseph ne pouvait dormir que d'un seul oeil. Mais tenant tellement à instituer une longue dynastie des Kinlaza sur le Kongo et pensant que ce sont ses mauvais rapports personnels avec le reste de la dynastie qui l'empêchait, Joseph préféra abdiquer en faveur de son frère cadet pour donner une chance à son projet.
Alphonse V (1784-1788).
Frère du précédent. Son règne bref (certains auteurs disent 1785-1787) se termina par son empoisonnement. S'ensuivit alors une guerre trouble et floue qui vit plusieurs rois se succéder, généralement sans lignage précis. On dit même qu'un Yaka voire pire (pour la conception Kongo de l'époque), un Imbangala l'occupa.
Joseph II (1788-17??)
Alexis Ier (17??-1793)
Henri II (1793-1802). Après les troubles, le pouvoir échoua à Henri II. D'origine très incertaine, il réussit tout de même par ses troupes à occuper Mbanza Kongo. Pour mettre fin à la guerre, il était prêt à se contenter d'une portion du royaume, donnant à ses deux principaux rivaux (un Kinlaza et un Kimpanzu), la plaine souveraineté sur un tiers du territoire chacun.
Garcia V (1802-1814).
Il accepta le morcellement du territoire proposé par Henri II, et en reçut un tiers. C'était un accord stratégique pour lui car la petite paix lui permit de se reposer, refaire ses troupes, et repartir à la reconquête du royaume, ce qu'il réussit en 1805. Pour corriger la chronologie, on peut dire qu'il est co-roi avec Henri de 1802 à 1805, et roi effectif du Kongo à partir de 1805. Il semblerait que Garcia avait abdiqué en 1814 pour laisser régner d'autres rois, dans le but de réhabituer le royaume à la rotation entre Kimpanzu et Kinlaza, sous la surveillance de lui-même Garcia et de ses troupes. D'où il n'est pas rare de lire qu'on lui prête d'avoir régné jusqu'à sa mort en 1830.
André II (1814-1825).
Issu de la famille nord de Kinlaza, les rebelles de Matadi (dont la capitale s'était transférée entre temps à Manga) qui voulaient faire sécession du temps de Joseph Ier en 1778, et qui depuis leur refus à Pierre IV en 1776, n'avait finalement plus participé au pouvoir au nom de toute la famille depuis la guerre d'Ambuila, soit depuis 149 ans du temps d'Antonio Ier. Sa prise du pouvoir réhabilite de nouveau le royaume.
André III (1825-1842).
Il succède à André II, mais est renversé par Henri III de la branche des Kinlaza de Mbizidi, qui depuis le temps s'est particularisée en tant que maison nobiliaire des Kinlaza de Matadi-Manga. Et par mariages successifs, ils se revendique maintenant des Kinlaza descendant de Pedro (ou Pierre) IV ! André III s'installe accompagné de ses fidèles partisans et sa famille, pas trop loin de Mbanza Kongo, dans le village de Mbanza Mputu ou logeaient jadis les missionnaires européens. Il y restera jusqu'à mort, avec ses fidèles, perpétuant ses revendications, et plus tard ses descendants en faisant de même.
Henri III (1842-1857). Après le renversement d'André, il régna dans un pays avec beaucoup de poches d'indépendance. Il signa le premier traité de vassalité du Kongo envers les portugais. La dépendance qui était jusque là politique, va devenir juridique. Vous comprendrez pourquoi en lisant la suite. Henri III mourut au pouvoir.
Alvare XIII (1858-1859). Il revendiqua le trône au nom des Kinlaza de Matadi (s'étant déplacé à Manga), en ignorant complètement ceux de Mbanza Mputu. Il pu s'installer au trône. Une fois mis au parfum des affaires, il refusa d'admettre le traité signé par son prédécesseur et cru avoir les moyens de s'opposer aux portugais. Ils livrèrent bataille avec le poulain des portugais Pierre VI qui l'emporta. Alvare XIII cracha le fameux “moi, fils de Nzinga Nkuvu, même la mort jamais ne me pliera” et s'en alla créer une base à Nkunga, non loin de Sao Salvador, comme le fit en 1842 son cousin André III non loin de là, à Mbanza Mputu.
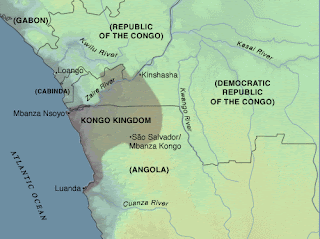
Dernière carte du Royaume avant dislocation
Pierre VI Leelo (1859-1891). Pour ce chapitre très important, voir John Thornton: “Early history” P 110; Tshilemalema Mukenge: “Culture et coutume du Congo”
Descendant d'une faction Kinlaza de Mbizidi, plus exactement installée à Mbembe. Il dut guerroyer fort avec un autre Kinlaza pour parvenir au pouvoir, sans d'ailleurs trop de pouvoir.
En 1839 L'Angleterre fit pression sur le Portugal pour arrêter la traite des esclaves. S'il faudra attendre encore 1851 pour que le Portugal admette officiellement la fin de ce commerce (en Afrique subéquatoriale). Il faudra encore deux ou trois décennies plus tard pour voir l'économie en Afrique centrale se convertir vers l'exportation de la cire, de l'ivoire, puis le commerce d'arachide et de cahoutchouc. Le grand témoin de cette époque sera Pierre VI. Ce changement bouleversa énormément les structures économiques (on s'en doute) mais surtout politiques du royaume.
En effet, contrairement à la traite négrière qui était en grande partie sous l'autorité de l'Etat, ce commerce nouveau permet à tout le monde, roturiers ou princes de transporter sa production jusque sur les côtes et d'en tirer un juste profit. Cela a permis la création de nouveaux regroupements humains, unis non pas au nom d'une allégeance à un prince, mais pour des intérêts strictement économiques. Ces villages riches et en mouvement devenaient incontrôlables. Les princes se sont révélés plus pauvres que certains bourgeois de leur contrées, et l'accroissement des impôts pouvait pousser le commerçant à choisir de les payer directement au roi et de demander la tête du gouverneur gourmant et sans doute fainéant. C'est la grande époque de la naissance du Kongo commerçant, et de la propagation du munsambu, poisson salé séché, car il permettait d'avoir des vivres conservables longtemps, durant les voyages du commerçant. La ville la plus plus puissante de ce renouveau commercial de la seconde moitié du XIXème était Makuta. Fondée vers 1855 par un riche commerçant du nom de Kuvo qui a fait fortune dans l'esclavage et la vente des étoffes européennes, elle prit une nouvelle dimension lorsque ce dernier s'associa à un autre grand du nom du commerce, Garcia Buaka Matu, qui lui était issu du nouveau négoce agricole qui proliférait. Ils créèrent un marché privé, dans leur village privé, avec leurs artisans privés, et on leur payait des taxes privées, à un carrefour devenu privé et stratégique! Il en a suffit de quelques années pour que Buaka Matu fasse vasciller le pouvoir du roi et menace même les portugais de se payer une armée entière pour les combattre, s'ils l'emmerdaient encore avec leurs histoires d'impôt. Il mourut en 1880 et Makuta (qui signifie “les fanfarons”) devint un marché et un village ordinaire. Nous ignorons si on s'en inspira pour nommer les subdivisions d'une monnaie au Congo Kinshasa.
Changement social également car c'est à cette époque que naissent les makanda traductible par “clan”, qui regroupent des familles prétendant descendre d'un ancêtre commun, reconnu par les “mivila”, le lignage. Ce sont des imitations par les gens du peuple de la structure familiale jusque là réservée aux nobles. Ces Makanda se présentent comme autant de réseaux commerciaux et solidaires reliant des gens par pure affinité en y ajoutant un fondement lignager totalement fictif. Selon des témoins des faits, à une époque ou nait l'anthropologie, ces clans suivent des tracés de routes commerciales: de Soyo à San Salvador, de Boma à Loutété, de Ndongo à Kimpumbu (actuel Kinshasa). Dans cette société désormais en mouvement, les “mvila”, au delà de la solidarité, ont servi aussi à planter des attaches et à indiquer des sources sur l'individu. Comme autant de noms de famille, d'appartenance à une commune d'origine et de rattachement, ils ont précédé le principe de la fiche d'identité. Et jusqu'à ce jour, les kongo se définissent selon l'appartenance à ces lignages qui n'ont plus leur fonction.
A la même époque, une nouvelle tradition orale à propos de la fondation du royaume (souvent attribuée à Afonso Ier d'ailleurs), voit le jour au sein des masses populaires. Elle décrit comment ce roi obligea les fondateurs de chaque clan à se disperser dans les 4 coins du royaume, chacun avec sa mission. Aujourd'hui, ces légendes mythologiques racontant souvent les épopées de ses chefs fondateurs, mythiques ont remplacé dans la conscience collective l'histoire réelle du royaume telle que rédigée depuis 5 siècles. Hélas!
Ce sont ces révolutions brutales qui effriteront le royaume sous les pieds de Pierre VI, “Petolo” en koongo, dont les chansonnettes moquant son impuissance se chantent encore dans les campagnes du Congo, de la RDC et de l'Angola. La conférence de Berlin, dont il signera et reconnaitra les conclusions en 1888 achèvera le travail. Par cet acte, Petolo signera la vassalité du Kongo au Portugal.
C'est le début de la grande migration des originaires de la province de Nsundi, le Ba-sundi, vers le nord, l'actuel Congo Brazzaville. Les sundi du nord (Mpangala) étant d'immigration plus ancienne datant de Nzinga Nkuvu, tandis que ceux du sud (Louingui, Bouenza), bien qu'issus de la même province, n'arriveront qu'à cette période, et formeront les actuels kongos (laris, sundi, bahangala etc…) du Congo Brazzaville. La royauté ne sera plus que symbolique.

Alvare XIV Mfutila,
succéda à son père en 1891 à Mbanza Kongo (San Salvador)
ROIS SYMBOLIQUES
- Alvare XIV Mfutila d'Agua Rosada, (1891-1896)
- Henri IV (1896-1901)
- Pierre VI (1901-1912)
- Manuel III (1912-1914). Suite à un complot contre le Portugal, suivit d'une révolte, l'occupant qui était devenu colon, mit fin à sa reconnaissance du royaume, même symboliquement.
Continuation clandestine par des Rois titulaires
- Alvare XV (1915)
- Alphonse Nzinga (1915-1923)
- Pierre VII Alphonse (1923-1955)
- Antoine III Alphonse (1955-1957)
- Isabelle Maria de Gama (1957-1962); régente
- Pierre VIII (1962)
- Alphonse Mansala (1962)
- Isabelle Maria de Gama (1962-1975) régente
Depuis 1975, indépendance de l'Angola et fin des persécutions contre les représentants du pouvoir royal du Kongo, tous les descendants de toutes les factions se disputent la légitimité de la couronne.
Mani Kongo.
Les Rois (ou Empereurs) du Kongo (”Mintinu mia Kongo” en kikongo) portent le titre de Mwene Kongo. Manikongo est une déformation portugaise de Mwene ya Kongo. “Mwene” est aussi le titre porté par le responsable administratif d'une province du Royaume du Kongo. On peut ainsi parler de Mwene ya Kongo, Mwene ya Soyo, Mwene ya Loango, etc. Dans le nord (au Kakongo, Nsundi et Yomba) on ditMane. D'ou le mani des portugais. Les loango prendront les deux appellations, en avalant les dernières syllabes comme l'exige leur langue: Ma' pour désigner la fonction, le titre (exemple: Ma' Loango, Ma' Kaya) et Mwe pour désigner l'individu titré du Ma' (exemple: Mwe Poaty, Moé Mbatchi). Le titre de Mwene existe aussi chez les mbochis du nord Congo. Le roi porte le même titre que le gouverneur de région. Preuve qu'à l'origine il s'agit de vassaux qui ont perdu définitivement leurs pouvoirs. Mais en gardant ainsi les titres, symboliquement le roi est diminué car il n'est qu'un administrateur comme les autres, sauf que lui, son champ de pouvoir englobe celui des autres “mwene”. “Ntotila” est le titre que lui donnent ses vassaux et qui signifie celui fait l'unité, qui ramasse des désoeuvrés pour les réunir autour de sa protection. Car le terme kongo rendu par vassal peut se traduire par “protégé”. C'est pourquoi “Kongo dia Ntotila” sous-entend l'ensemble des peuples Kongos, jusqu'aux extrémités de son influence. Plus tard, l'absolutisme du pouvoir durant les guerres de dynasties fait apparaitre le titre deN'tinu qui signifie roi au sens de celui que l'on doit craindre. Le détenteur de l'autorité étatique.
Depuis 1512, puis 1535 les rois du Kongo ont gravé dans le marbre les titres qu'ils portaient intégrant les vassaux. Ainsi, Afonso Ier était Roi du Kongo, de Mbundu et du Kongo dia Nlaza; Seigneur de Kakongo, de Vundu et de Ngoyo. Sachant que chacun de ses royaumes avait ses propres vassaux non cités dans le titre royal, mais sous-entendu sous le principe voulant que “le vassal de mon vassal est mon vassal”. Le royaume Mbundu de 1512 incluait les royaumes de Ndongo, de Kissama et de Matamba. Toutefois, il semble que certains titres étaient des prétentions non avérées. Surtout dans le sud, après 1600. Le Kongo avait une influence beaucoup plus forte au nord et à l'est, qu'il ne l'avait au sud. Ces zones commerciales et historiques s'y trouvaient. Ce qui facilita d'ailleurs l'implantation des Portugais à Luanda (sud du pays, hors du Kongo) en faisant immédiatement une colonie.
Administration du Kongo
Le royaume du Kongo était composée d'un grand nombre de provinces, variant selon les époques de 6 à 15 pour les principales, ayant des tailles très variées. Il y'avait également de plus petites localités qui avaient des statuts assez divers. Lors de l'européanisation des titres, la plupart furent appelées “marquisat”. C'est le cas de Mpemba, ou Kiuvo. Nkusu, petite cité regroupant quelques 4 milliers d'âme non loin de la capitale avait le statut de “Pays”. Le statut du chef de province était en principe accordé par le roi pour des durées variables mais limitées dans le temps. Mais il arrivait qu'un seul individu puisse diriger une province durant toute sa vie, voir rendre sa charge héréditaire. Généralement cela survenait à cause de la situation politique complexe qui empêchait de modifier son statut. Il fallait mieux contenir un duc rival en laissant sa “maison” gouverner une province plutôt que ne rien lui laisser et risquer de le voir arriver à la capitale avec des troupes.
Ces provinces devenaient des monarchies par la forme du gouvernement mais demeuraient tout de même soumises à l'obligation de fournir ses fils pour soutenir un effort de guerre, à l'impôt provincial, à l'impôt individuel, et l'impôt commercial. Un visiteur hollandais nous rapporte que cet impôt avait atteint pour le trésor royal en 1640 la somme de 20 millions de nzimbu, la monnaie locale. Sachant qu'une vache coutait 80 à 100 nzimbu et 2 à 5 nzimbu pour un poulet. Le royaume avait aussi des taxes directes, prélevées sur les différents produits commerciaux échangés à travers la sous région. Il s'agissait du cuivre, des métaux ferreux, du raphia, des textiles (du Kongo dia Nlaza notamment), de l'ivoire, du cuir, ou encore du sel.
Duarte Lopes lors de son voyage à la fin du XVIè siècle identifia 6 provinces importantes.C'est sa liste qui est le plus souvent répétée dans les manuels d'histoire. Il s'agit du N'sundi dans le nord, Mpangu au centre, Mbata au sud, Soyo dans le sud-ouest, Mpemba au centre-est et Mbamba au sud-est qui est la plus grande de toutes les provinces avec 6 sous-provinces. Mpemba était petit et ne connaissait aucune subdivision. Mais au vu de son rôle historique, il avait un statut à part. La capitale était sous la diection directe du roi. Elle comptait 500.000 habitants en 1600.
*Nota: Kongo dia Nlaza, ou Mumboadi (7) Nom donné par les Koongo à la partie orientale du pays, qui regroupait 7 Etats, provinces et royaumes vassaux. Particulièrement réputés pour leur grande production de textile avant l'arrivée des portugais et encore pendant, jusqu'au XIXè siècle.
LES FORCES ARMEES

Guerrier kongo, de l'époque de Nzinga Nkuvu
Elle était composée de 30.000 soldats permanents, et pouvait recruter en plus jusqu'à 50.000 hommes en âge de combattre pour une campagne ponctuelle. Du temps de Nzinga Nkuvu, près de 5.000 soldats stationnaient dans la capitale, le reste autour des points sensibles, des frontières et sur les routes commerciales. A partir du XVIIème siècle, les guerres civiles étant devenues plus importantes que les guerres contre les nations étrangères, autant que les invasions barbares s'atténuaient, Mbanza Kongo hébergeait pas moins de 20.000 soldats consacrés à la défense du coeur du royaume. Quoique certaines sources prétendent qu'Antonio Ier réunit 70.000 soldats à Ambuila (sérieusement contredites par d'autres de la même époque), il était difficile de réunir une armée de plus de 10.000 soldats pour une longue campagne, à cause des difficultés logistiques.
Les archers étaient majoritaires. Ils étaient renforcés par des fantassins armés de lances, d'épées et de boucliers. Vers 1580, elle se compléta de mousquetaires, essentiellement recrutés parmi les métis. Il en servit 360 dans la bataille de Mbuila.
Les techniques de combats étaient propres à la culture Congo. Si peu de témoignages du combat à main armée nous sont parvenus, celui à main nu enseigné s'appelait la force de la panthère (animal totémique privilégié des Kongo),ou “ngo-lo”.
Figures de Ngolo.
La capuera brésilienne s'en est largement inspiré. Ce qui témoignage d'ailleurs que comme pour le latin, la périphérie culturelle a souvent mieux conservé les souvenirs culturels que le centre. (Batsikama: L ’ancien Royaume de Congo et les BakongoL'HARMATTAN - 1999 / Le geste Kongo MUSEE DAPPER - 2003)
SAO TOME
L'Ile offrant un position exceptionnelle aux navires portugais, fut la première implantation véritablement souverraien du Portugal. Proche du kongo, mais aussi inaccessible par les moyens de navigation de ce pays, ce comptoir reçu dès 1499 un titre officiel comme territoire portugais, son gouvernement dirigé Fernand de Mello se vu accorder par le roi Manuel du Portugal le droit à la succession héréditaire. Pour le Portugal, les affaires du Kongo dépendaient directement de Sao Tomé. Mais très vite les abus du gouverneur furent de très haute ampleur. Il pouvait ponctionner jusqu'à la moitié de la cargaison d'un bateau en provenance du Kongo ou du Portugal vers le Kongo, au titre de taxes et douanes, pour revendre les mêmes biens au Kongo. Si bien que le commerce extérieur du royaume s'en trouvait sérieusement affecté. En 1512 alors que commençait le trafic des esclaves, les rois Manuel du Portugal et Afonso du Kongo se mirent d'accord que le gouvernement de Sao Tome entravait leur deux nations. Manuel décida d'envoyer un ambassade permanente à Mbanza Kongo, pour négocier directement. Le convoi fut intercepté par le gouverneur de Sao Tome qui s'opposa catégoriquement à cette entreprise, arguant que Afonso désirair acquérir un bateau de haute mer battant pavillon Kongo. Ce qui “tait vrai:Afonso Nzinga Mbemba avait même chargé son neveu Rodrigo de négocier l'achat d'un navire au Portugal! à lui en partance de par l permettait un comptoir de la plus de la plus haute. Ainsi, s'échapper du contrôle de Sao Tome, aurait permis au Kongo développer ses relations commerciales avec d'autres nations européennes.
Le roi du Portugal adhéra à l'argument de Fernand de Mello, et renonça de lui retirer le droit de contrôle sur le passage des navires. Le successeur du roi Manuel, Joao III, lui retira l'hérédité de sa charge de gouverneur en 1522, nommant et relevant lui même le gouverneur.
SOYO
La province de Soyo bien que périphérique et sans aucune importance avant l'arrivée des colons, deviendra capitale par la suite. En effet, englobant l'embouchure du fleuve, cet estuaire permettait un accostage facile des grands navires de haute mer. C'est d'ailleurs au même endroit, jadis appelé Mpinza, que la RDC est entrain de construire son nouveau port en eau profonde, Banana. En 1491 lors du premier retour des colon portugais, le chef de Soyo, petite province est le premier à recevoir le baptème. Avant le roi. Il profitera de cette position de primauté dans le commerce extérieur devenu capital pour l'Etat Kongo, pour revendiquer de plus en plus de pouvoir et de droit, voir une autonomie.

Jeunes filles de Mbanza Kongo, de nos jours.
LE KONGO ET LE DEVELOPPEMENT
Le Kongo a nourri très vite des appétits de développement, autant que le Portugal a nourri ceux de tirer le plus profit des terres kongolaises. Dès 1510 il y'a en moyenne 5 bateaux par an qui accostent à Mpinda le port national. 10 ans plus tard il y'en a 3 fois plus. Depuis Afonso 1er Mbemba, les demandes en ouvriers (maçons, charpentiers, forgerons) étaient les plus insistante de la part des rois du Kongo. Ainsi, Alvare II insistait pour qu'à chaque homme d'église envoyé, corresponde un ouvrier dans la même cargaison. Mieux, il demanda que des familles entières quittent le Portugal définitivement pour s'installer en son royaume, avec des jeunes filles pouvant se marier avec ses sujets. Dans les conseils du gouverneur portugais de Sao Tome ou de celui d'Angola auprès du roi du Portugal on peut lire: “On ne doit pas lui envoyer des ouvriers; il ne convient pas qu'il ait dans son royaume des gens sachant faire le travail de la pierre, de la chaux ou du fer parce que ce serait pour lui l'occasion de désobéir à Votre Altesse (…) Il serait préjudiciable à votre Altesse que ce roi ait des sujets blancs, parce que grâce à eux, il sera si puissant qu'il se passera de vous.” La cupidité portugaise était telle que les hommes d'église s'intéressaient plus aux affaires qu'à tout autre chose. Sous prétexte que le roi le spayaient en Nzimbu, une monnaie non utile au Portugal, il l'échangeait immédiatement en achetant des biens et des services sur place. Ainsi, le clergé portugais possédait sur place des terres ou se cultivait le tabac, les céréales, des légumes et des fruits, ils avait des élevages opulents, des manufactures de tissus, et des travailleurs quasi esclaves qui y travaillait. On parle d'un d'entre eux, le père Ribeiro, qui vendit des objets liturgiques, pour s'acheter des esclaves! D'où la difficile implantation du christianisme à cette époque. les moines, les prêtres
AlvareII demanda aussi l'envoie de familles entières dans
e la forge epremier, ne cessait d'écrire à son homologue portugais pour solliciter l'envoi d'ouvriers dans tous les secteurs. A ceci
DIVISION DU TEMPS.
Le calendrier basé sur la “semaine” de quatre jours était en vigueur; trois jours ouvrables et un jour pour le marché:
- “Semaine” = 4 jours
- Mois = 7 “semaines”
- Année = 13 mois + 1 jour de fête à la fin.
Outre celui du marché, il y a un calendrier agricole Kongo qui comporte six saisons :
- Kintombo (octobre-décembre) = saison des premières pluies, celle des sémailles ( ntombo ). On la nomme également ma-sanza , “nourriture”.
- Kyanza (janvier-février) = deuxième saison des pluies, celle de la récolte du vin de palme. On l'appelle aussi mwanga
- Ndolo (mars à mi-mai) = dernière saison des pluies.
- Siwu ou Kisihu (mai-août) = première saison sèche, marquée par les vents froids.
- Mbangala (mi-août à mi-octobre) = seconde saison sèche, caractérisée par de fortes chaleurs, notamment à partir de juillet. Mini mia mbangala expression courante signifiant “coups de soleil intenses”. Période des brûlis, mpyaza.